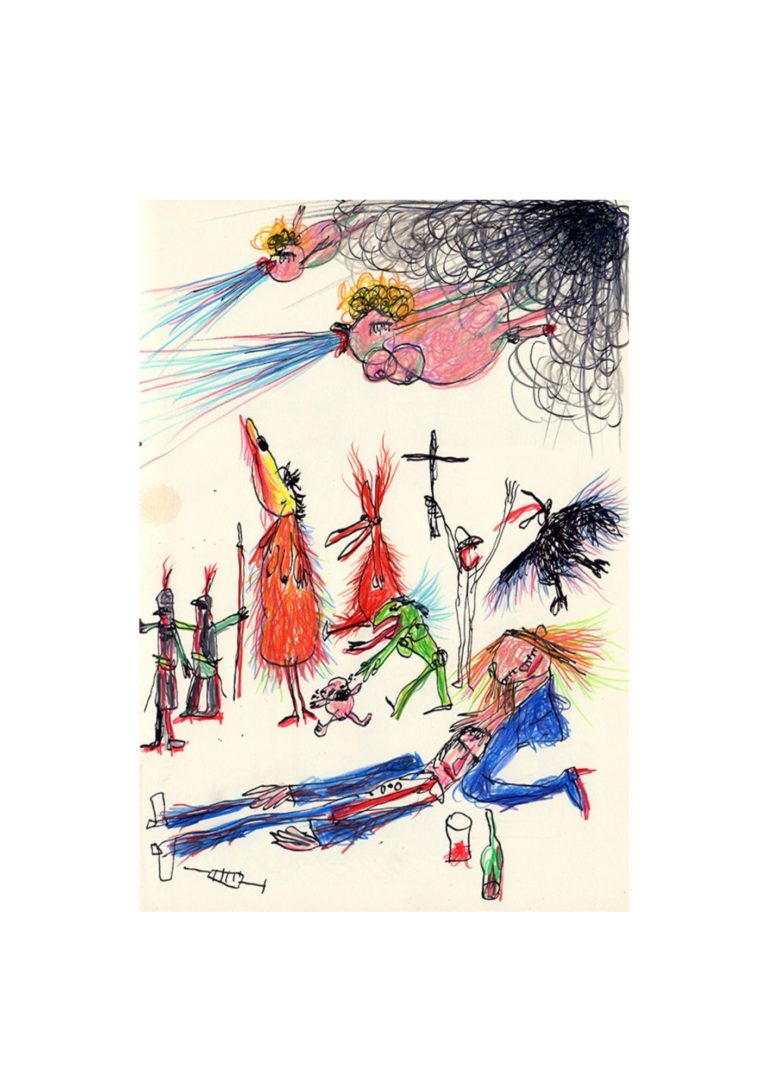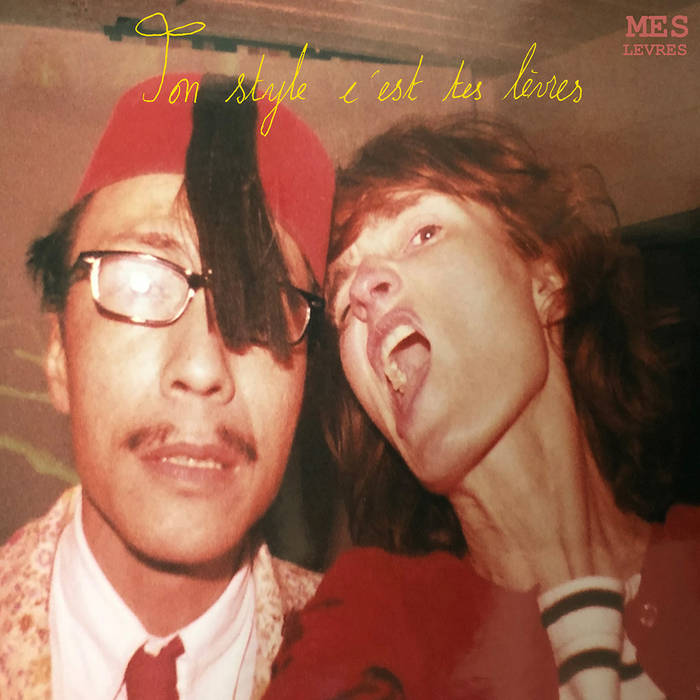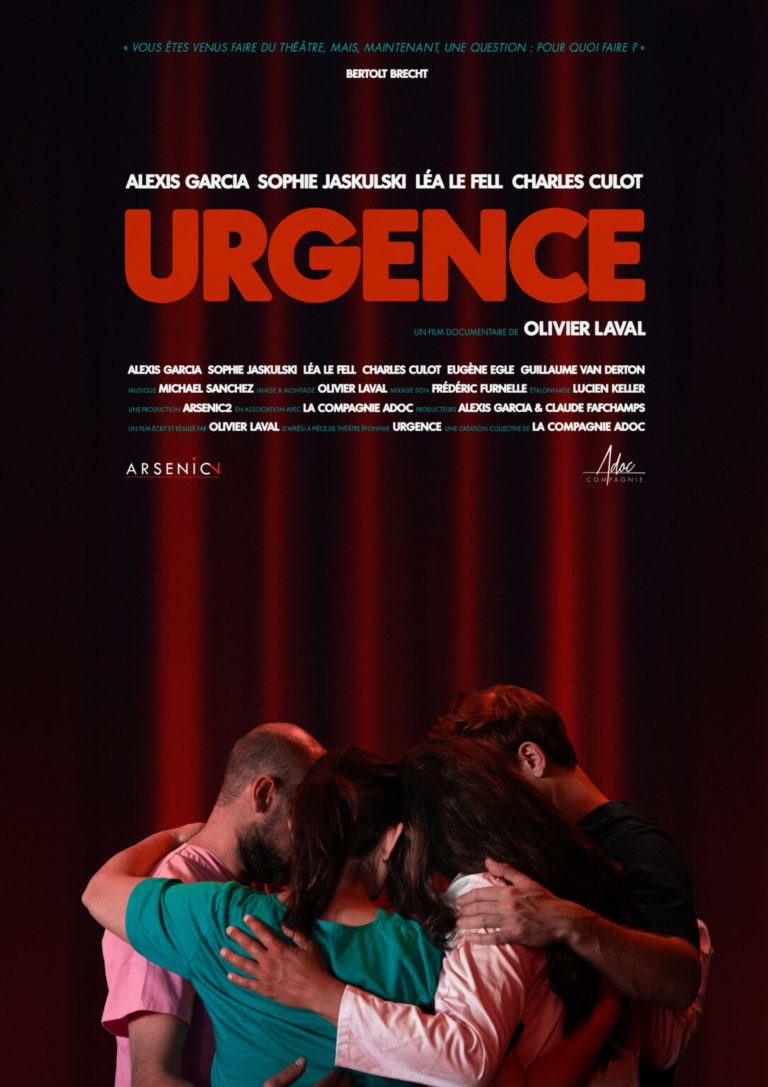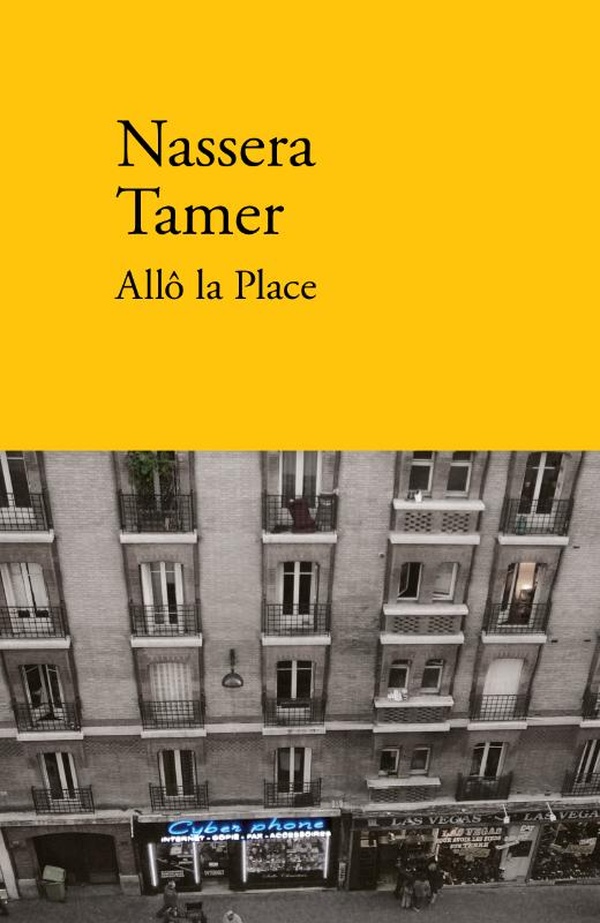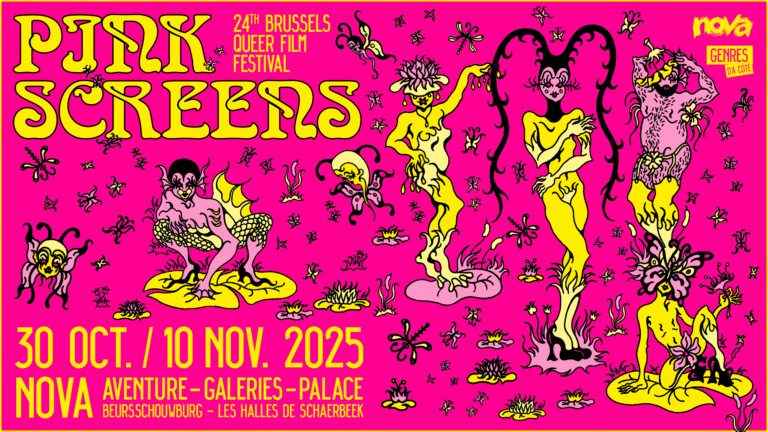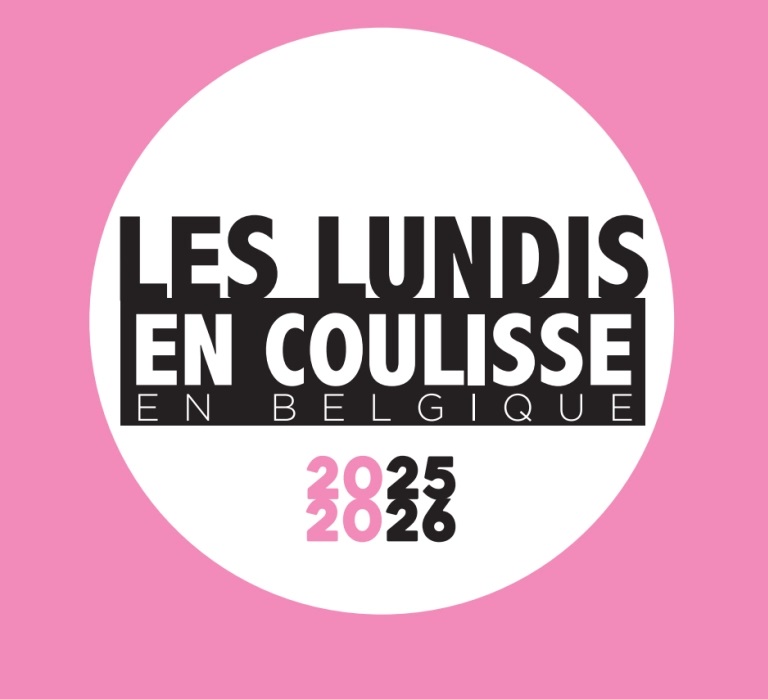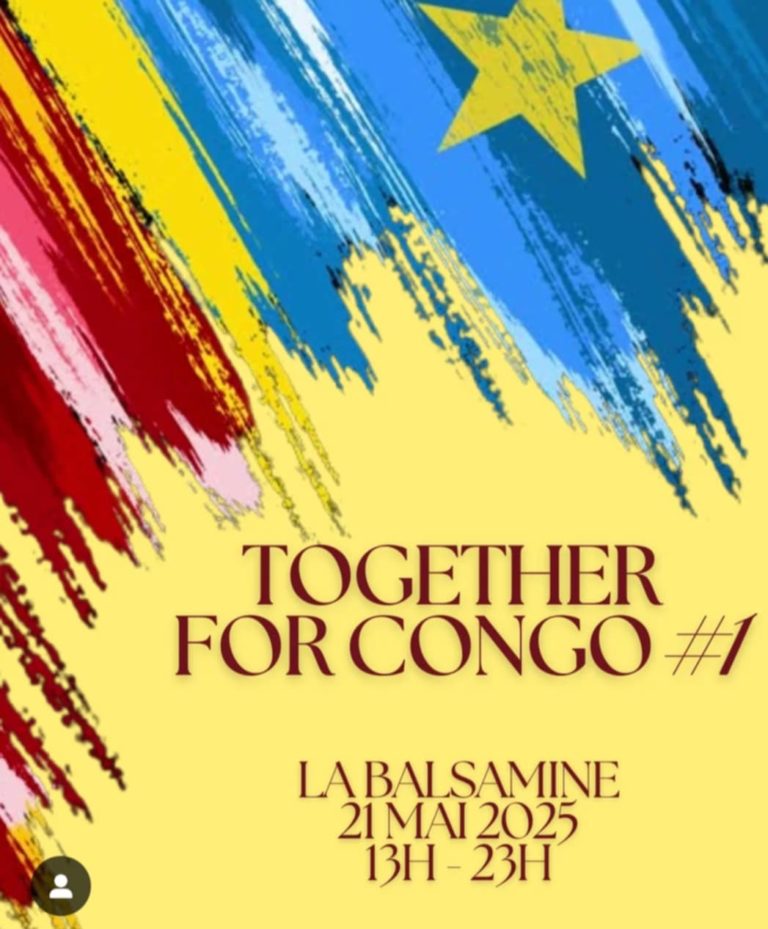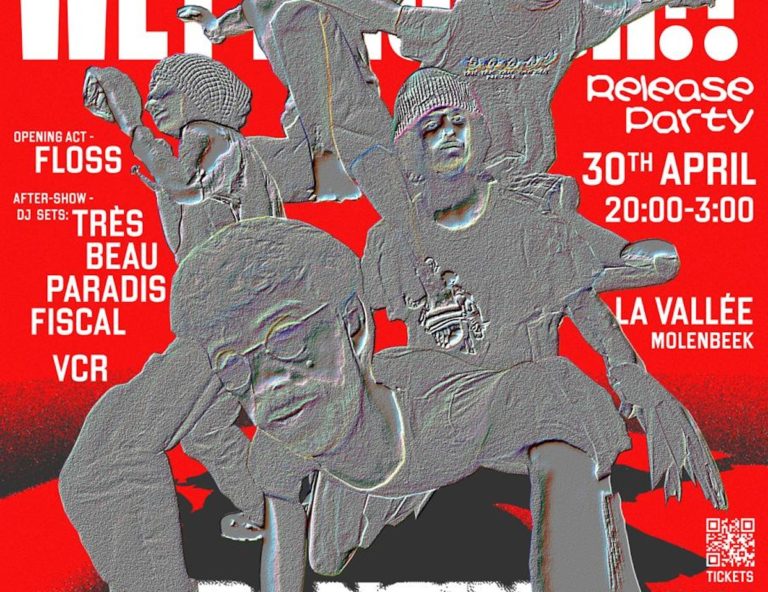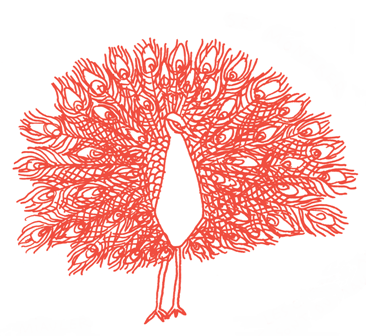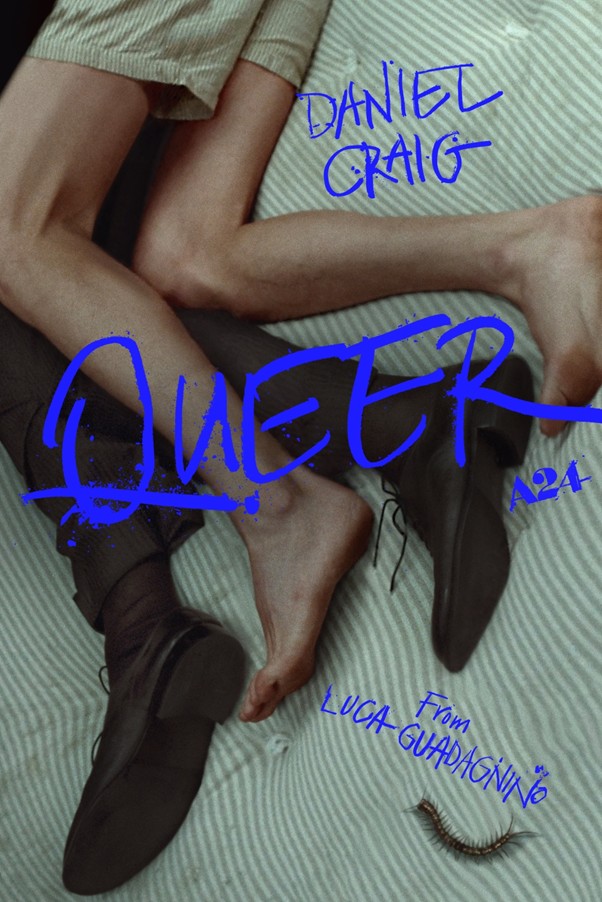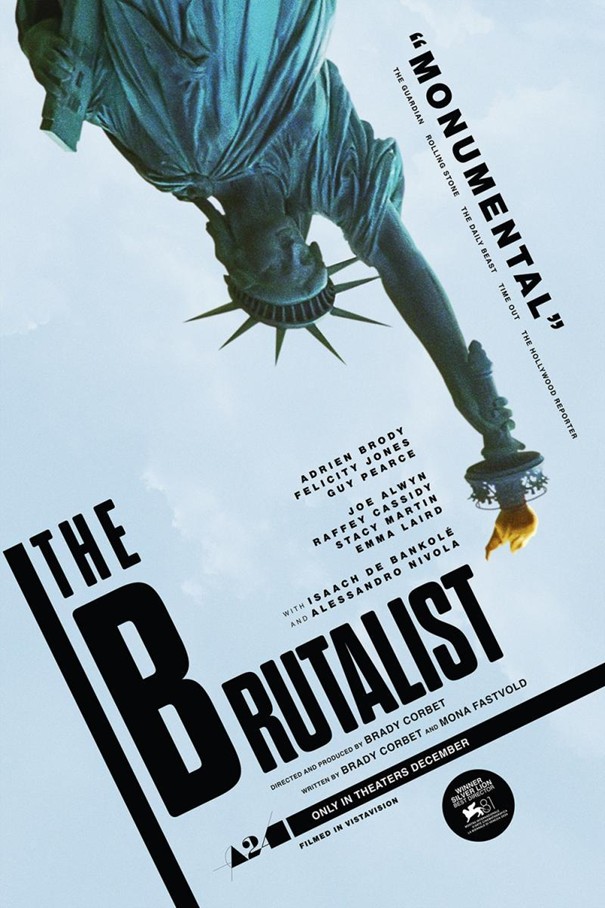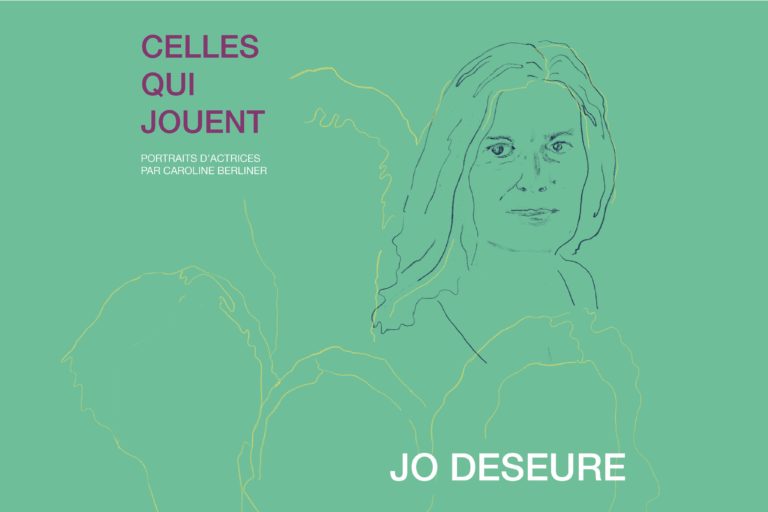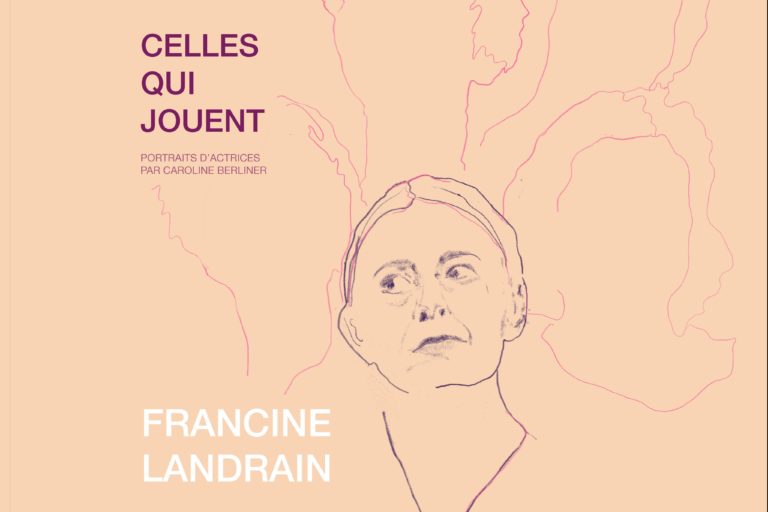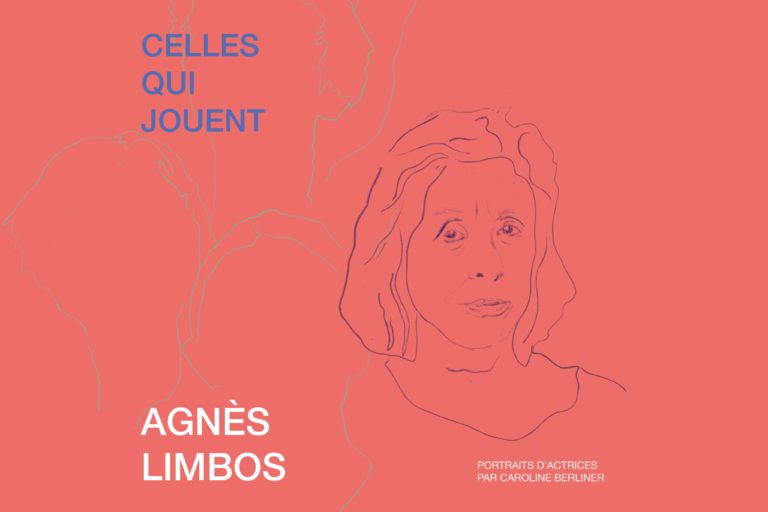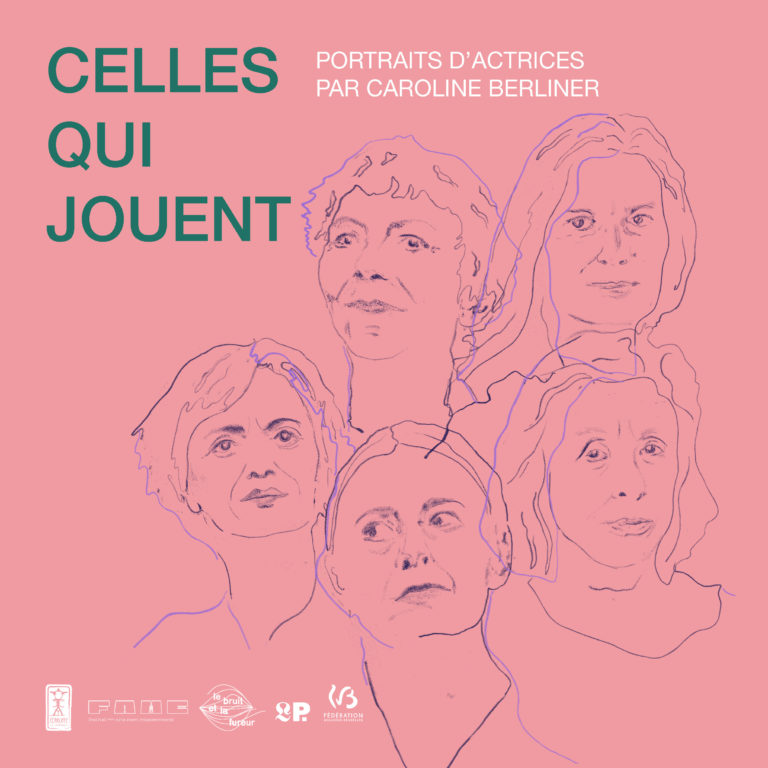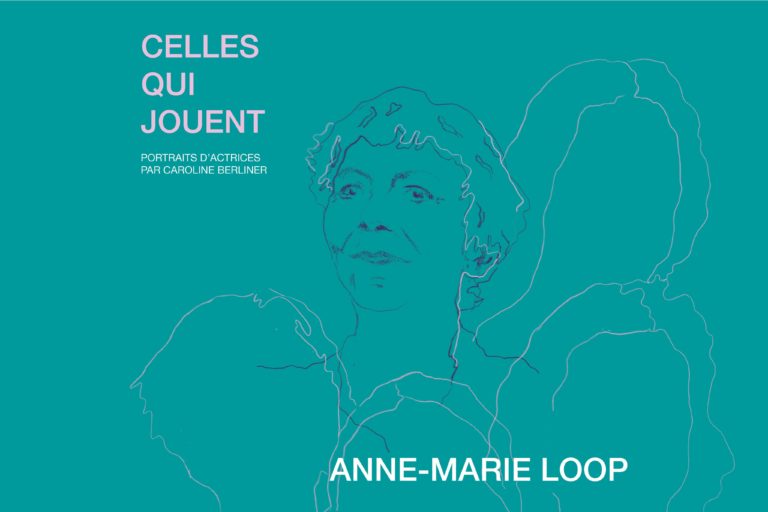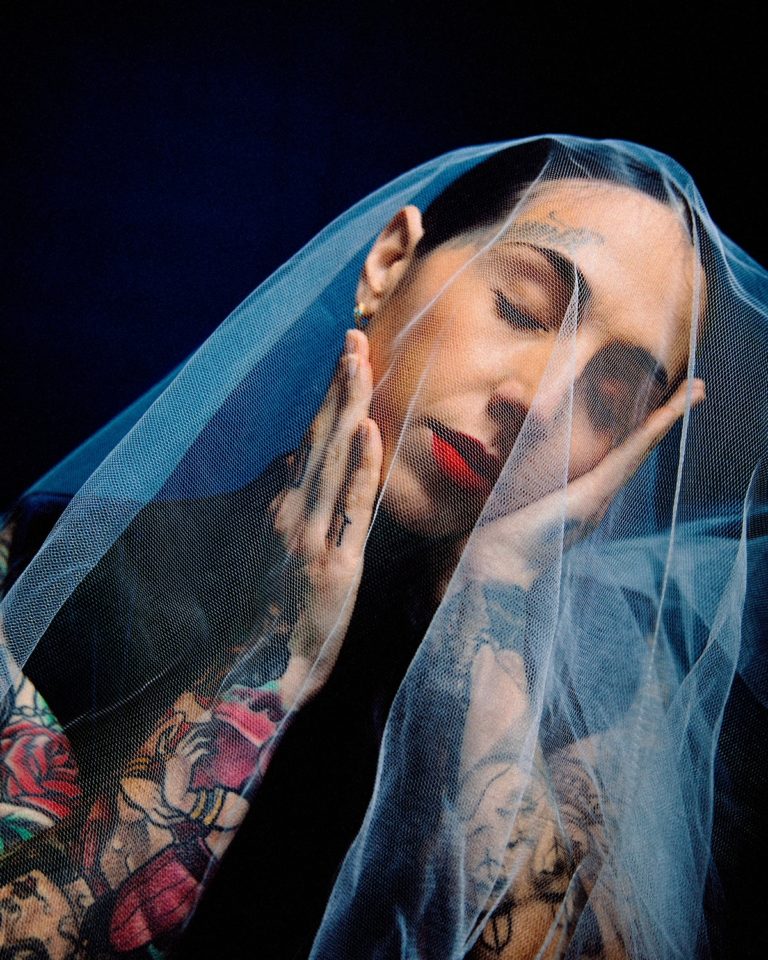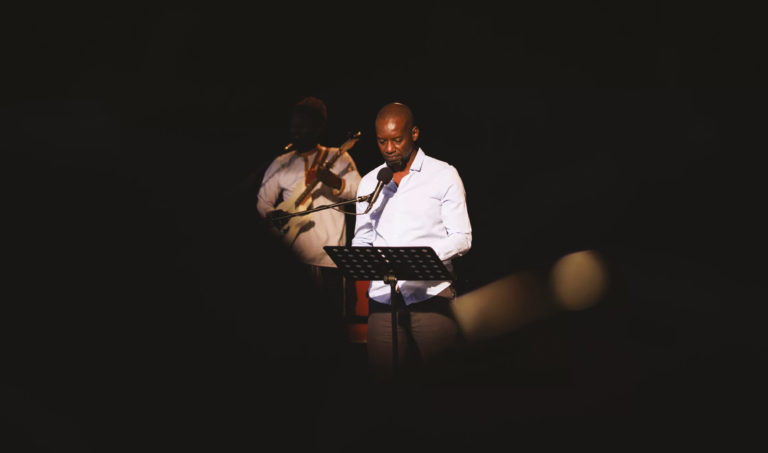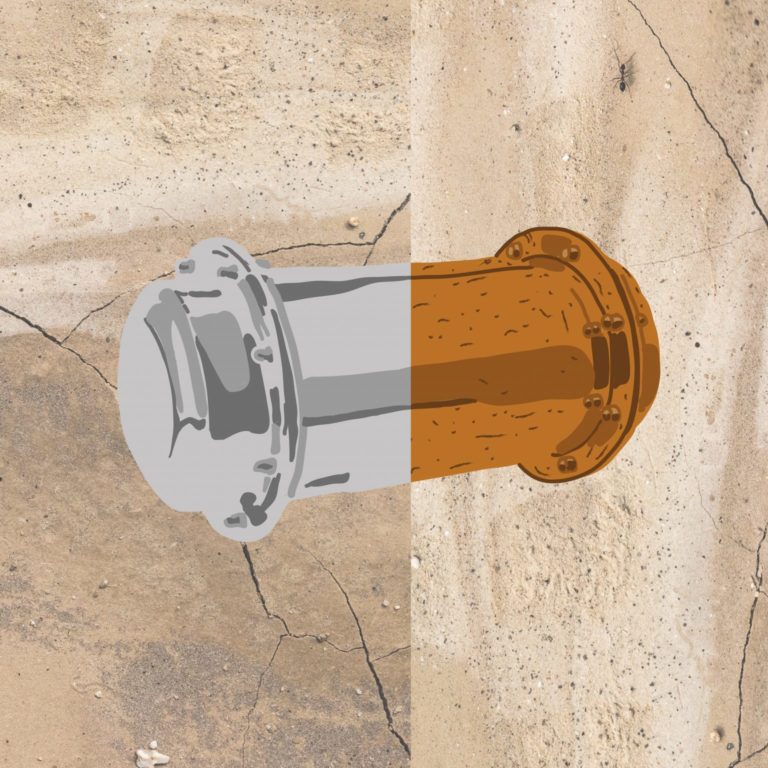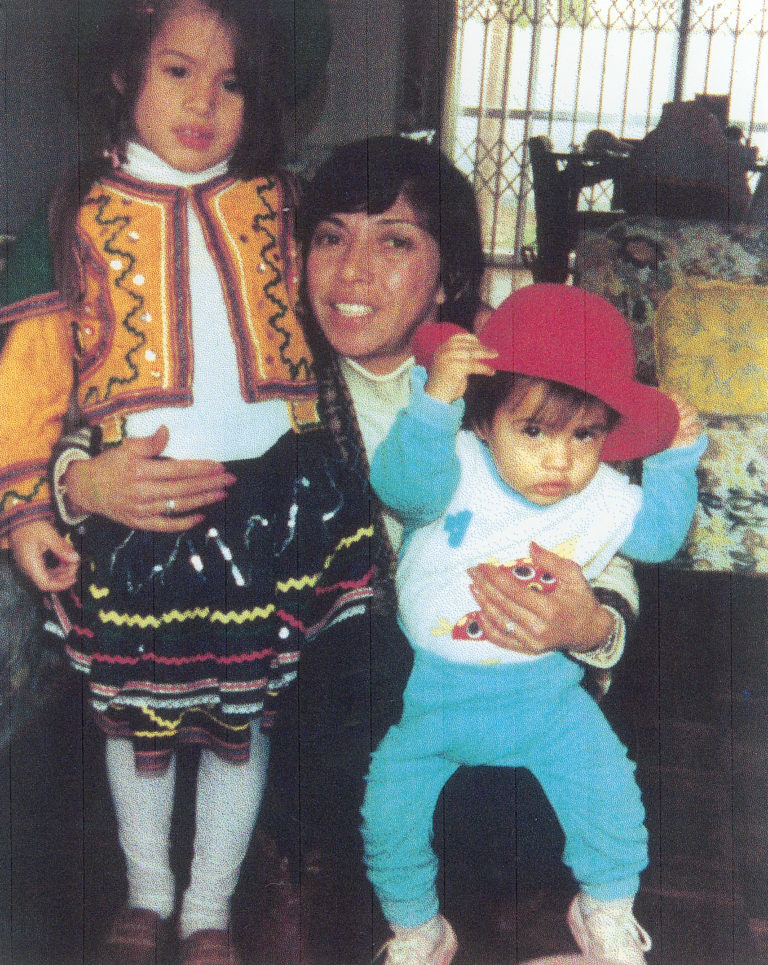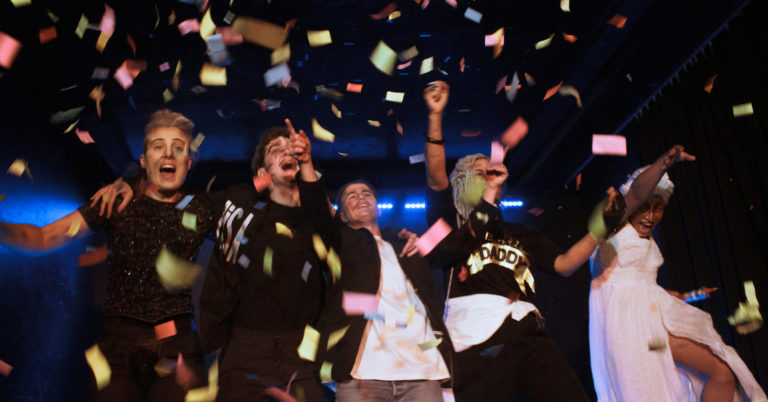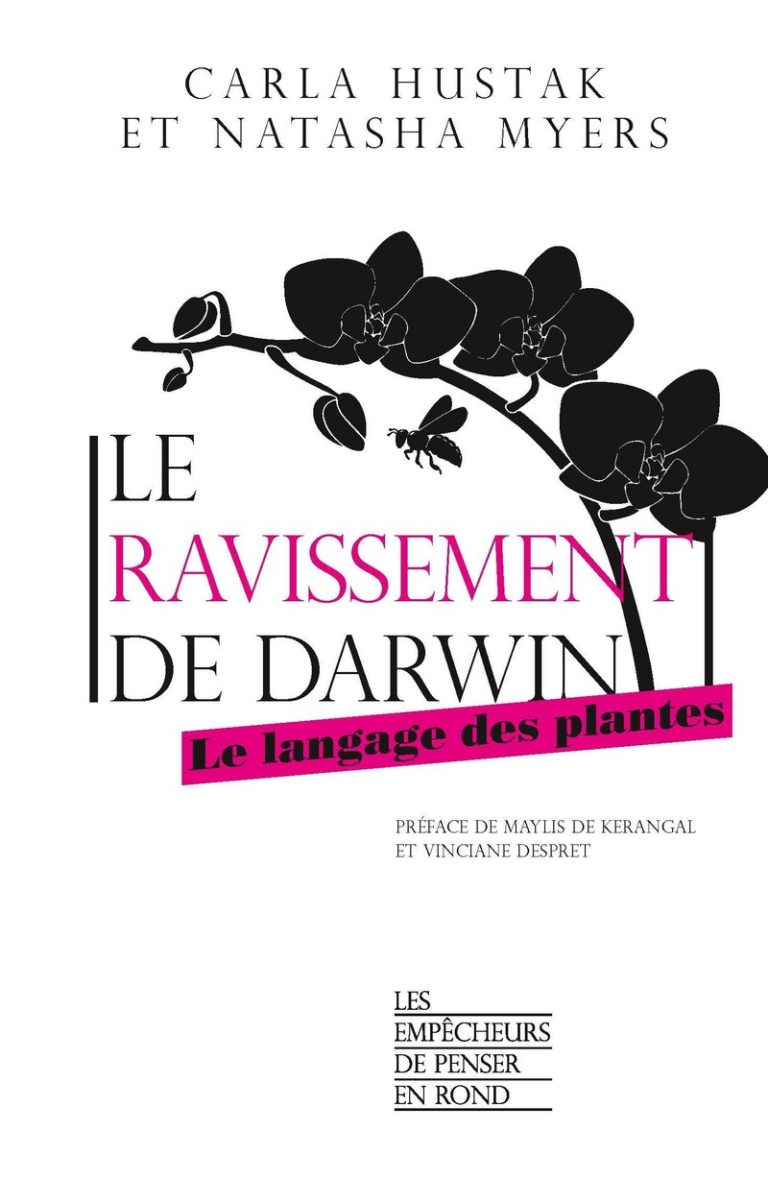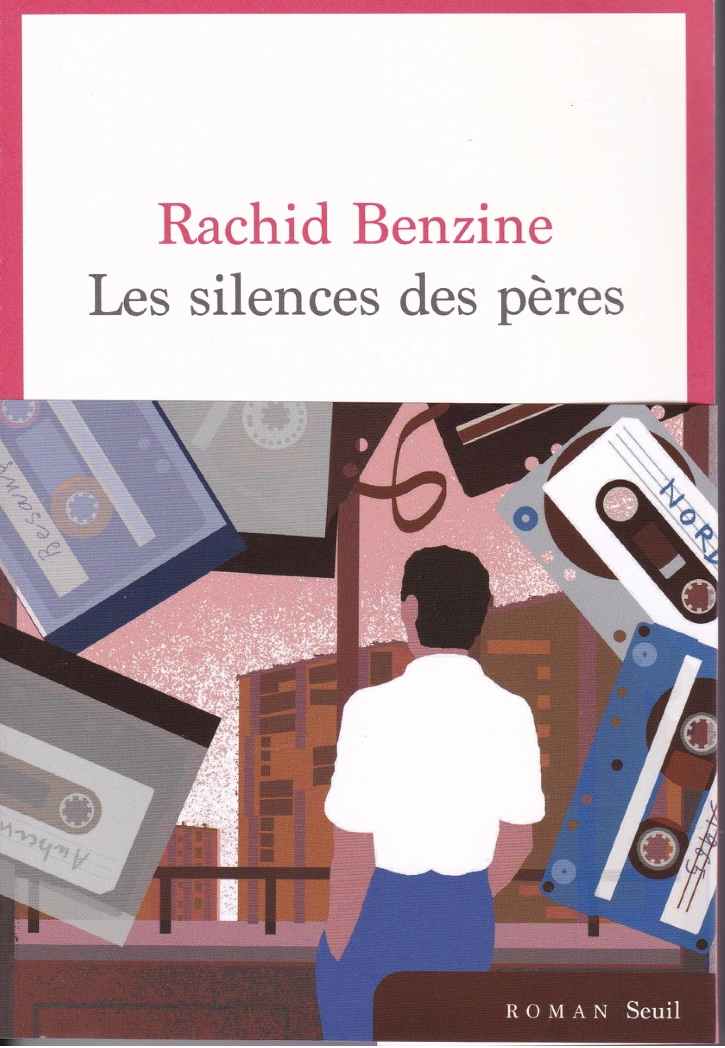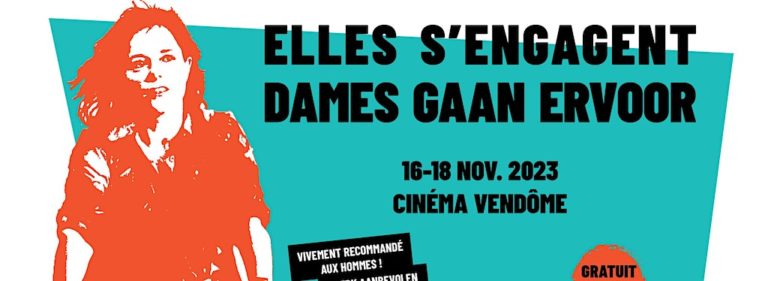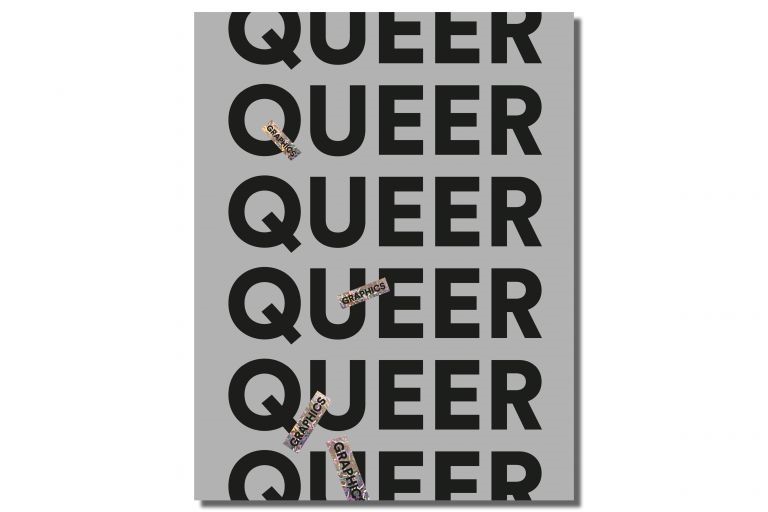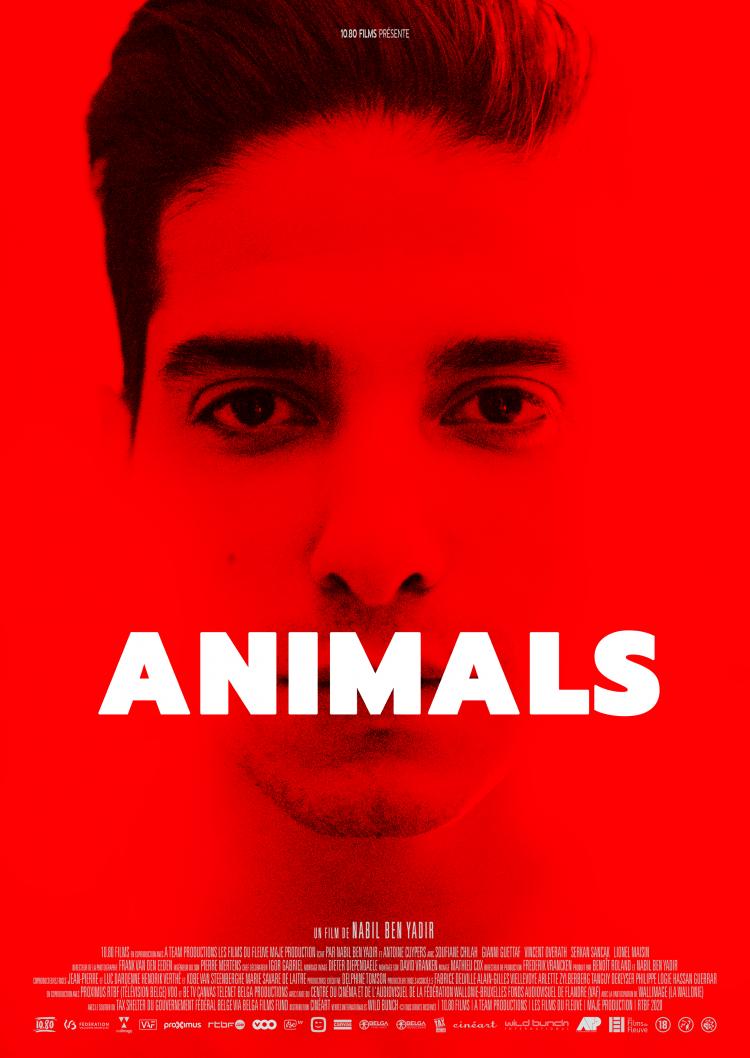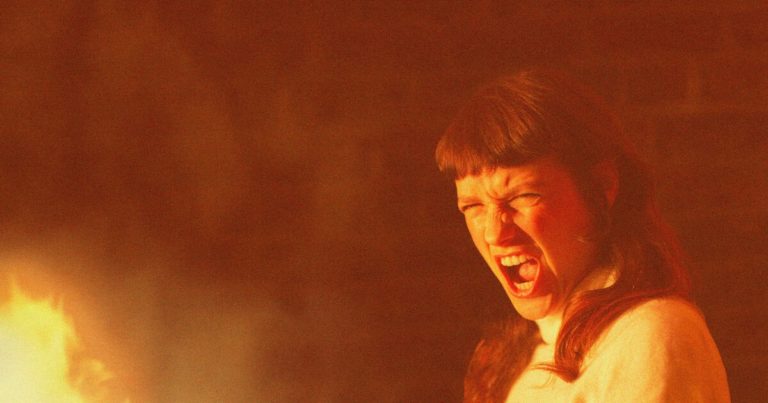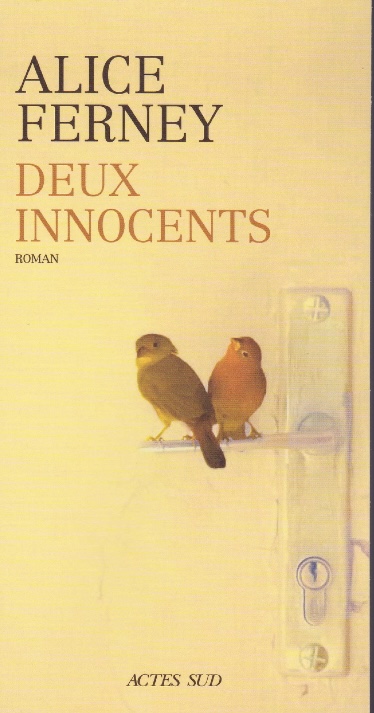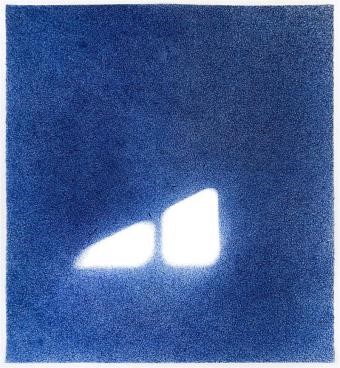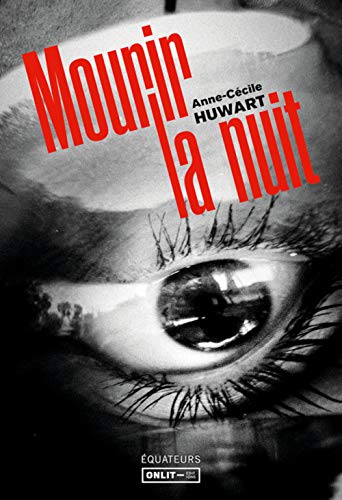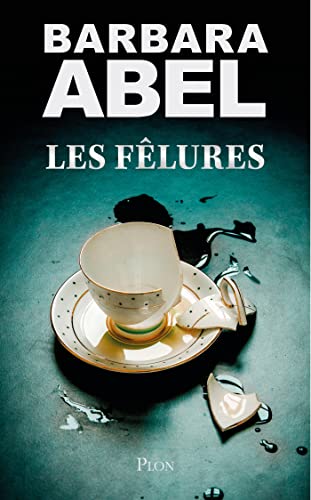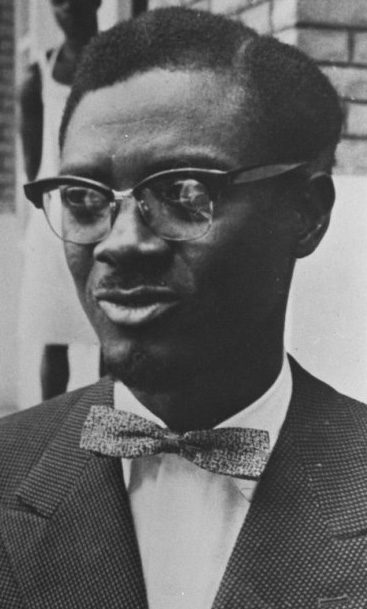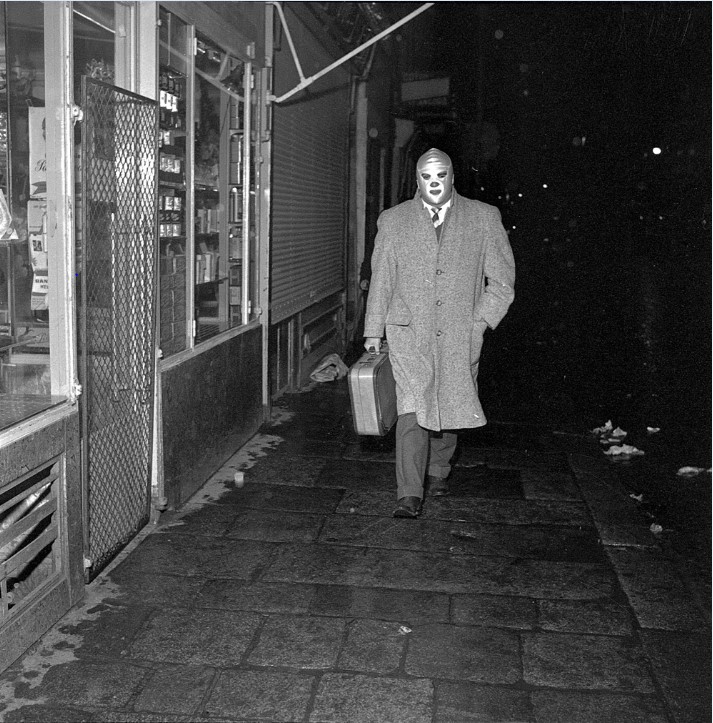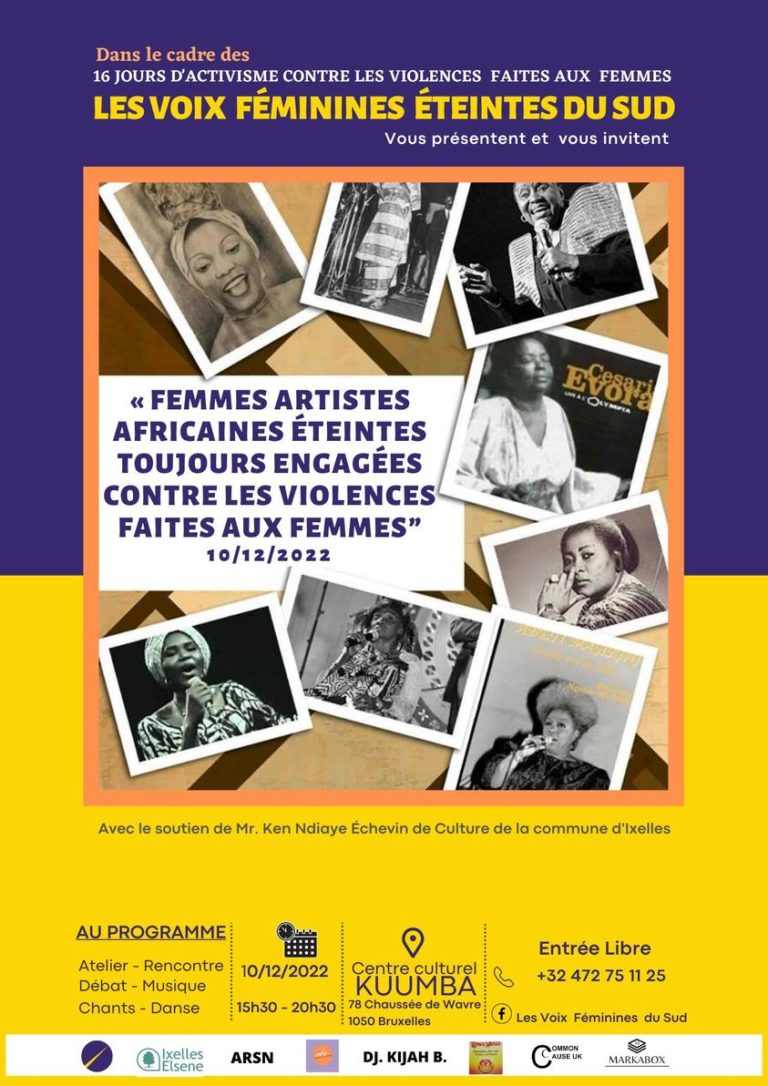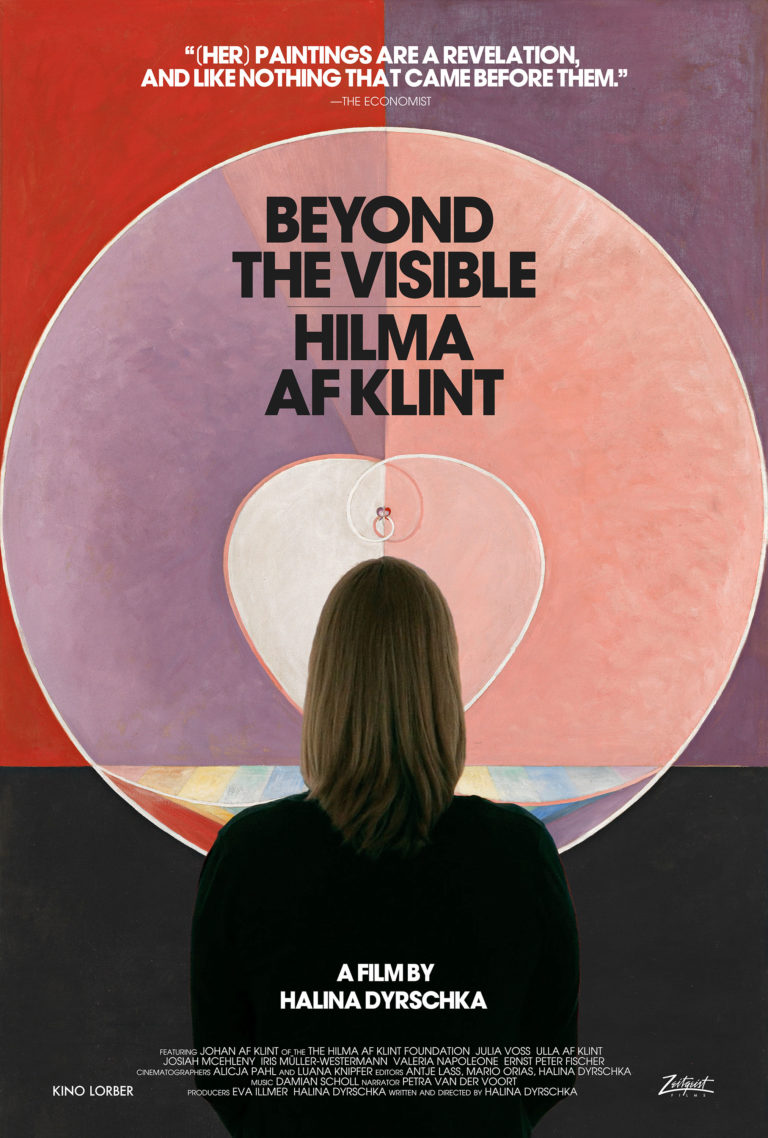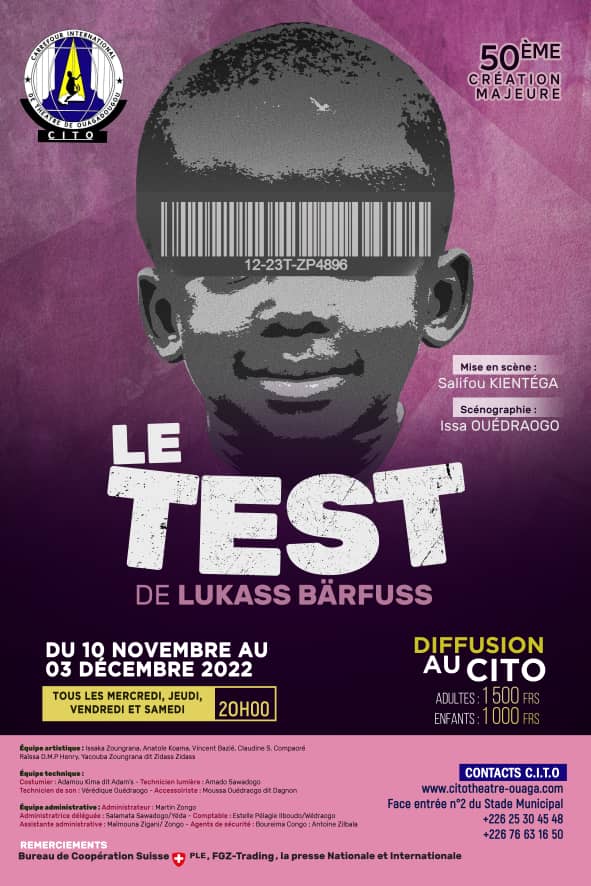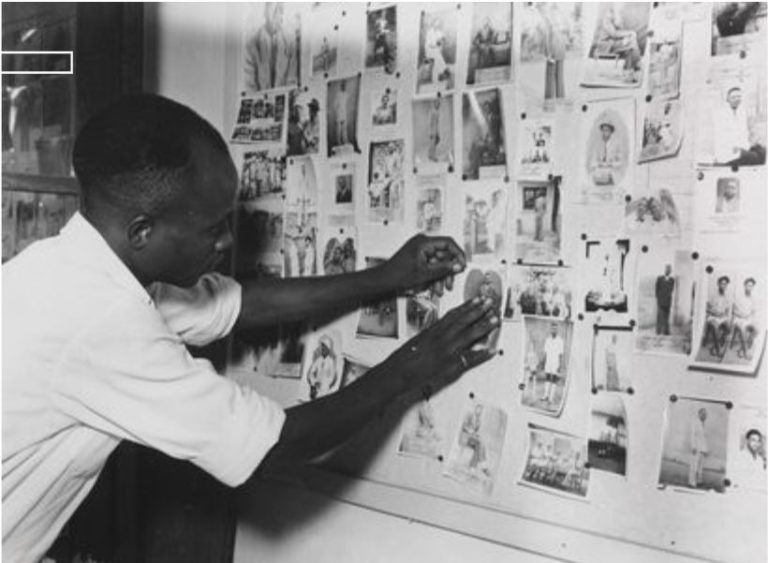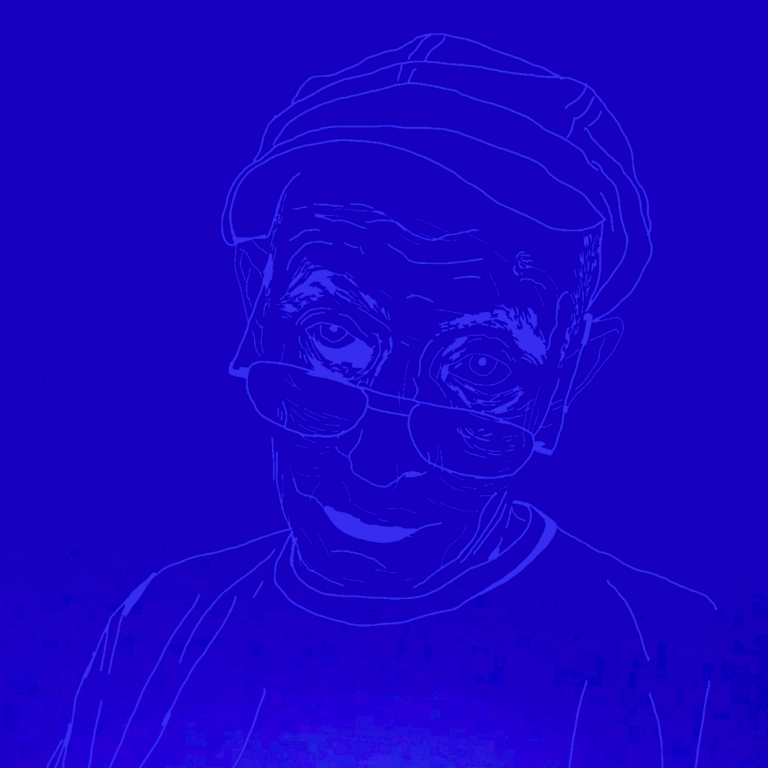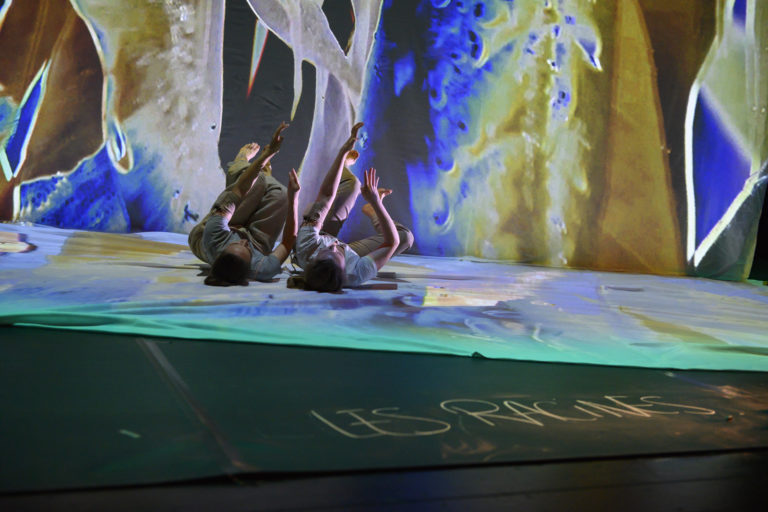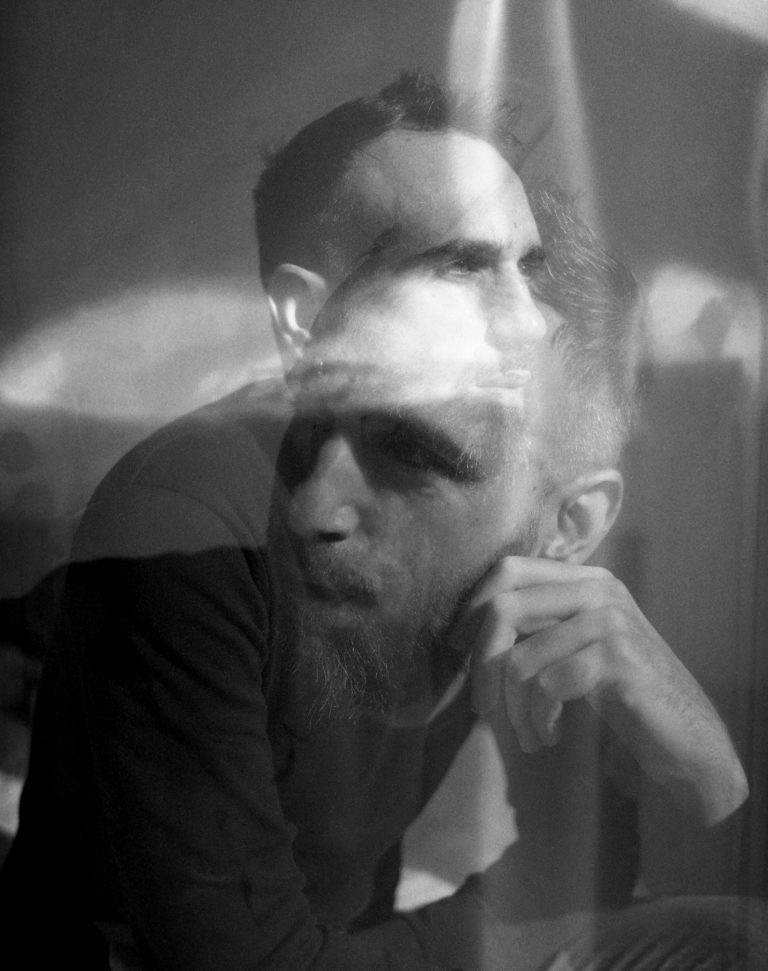Trouble #13: Invocations et évocations
Grand Angle12 juin 2025 | Lecture 6 min.
Pickels, qui en est encore le programmateur, a la réputation de choisir des artistes et des sujets controversés. La treizième édition de cette manifestation incluait des performances relatives aux agressions sexuelles, à la répugnante histoire de l’empire colonial belge ou encore aux effets d’une bactérie intestinale devenue incontrôlable. Plusieurs performances se sont déroulées dans la rue et ont été vues par des publics inattendus, dont la police. La performance qui clôturait le festival était donnée par Rocío Boliver, une artiste mexicaine, connue pour avoir été mannequin pour des couches pour adultes, avoir cousu son vagin et avoir déféqué en public.
Trouble #13 s’est ouvert sur Viol caché, paroles libérées de Ras Sankara Agboka, une pièce forte nous mettant face aux violences sexuelles, présentée dans la vitrine du Studio Thor. Ras Sankara a investi l’espace, un tissu blanc noué autour de la tête, et entrepris de laver un vêtement blanc selon un rituel tandis qu’était diffusé un enregistrement de voix de femmes racontant leurs histoires. Les hommes présents dans le public étaient invités à participer à des actes rituels de purification et de communion – boire du vin rouge et compléter une installation mêlant dessin, écriture et sous-vêtements. En 1972, Judy Chicago, Aviva Rahmani, Sandra Orgel et Suzanne Lacy avaient présenté Ablutions, l’une des premières œuvres d’art traitant explicitement du viol. La performance de Ras Sankara est quant à elle l’une des premières réalisées par un homme (africain/togolais) et impliquant d’autres hommes.

Plus tard dans la soirée, Natacha Nicora a joué Haïssez(-moi), une pièce provocante et déstabilisante. Nicora a essayé de pousser le public à la haïr: elle l’a insulté et lui a distribué des légumes pourris et des objets dangereux – allumettes et essence à briquet par exemple – qu’il pouvait ensuite utiliser contre elle. Un spectateur a même essayé de la brûler avant que d’autres interviennent. La performance a dégénéré quand Nicora a enduit de Nutella ses organes génitaux et tenté de persuader un chien de les lécher. L’animal, manifestement perturbé, n’en a rien fait, et la performance – sur le point de déraper, à l’instar de Rhythm 0 proposée en 1974 par Marina Abramovic – a pris fin.

La deuxième journée de Trouble s’intéressait aux invocations, soit le fait d’appeler à l’aide un esprit. Pongo Pete de Romuald Dikoume se présentait comme un rite de purification mêlant le corps de l’artiste couvert d’une peinture argentée ainsi que de l’eau, du vin, des citrons, du charbon et des bougies. Pongo Pete est une expression de la langue diouala signifiant «acte de répétition». C’est par la répétition que les rituels gagnent en force. Le rituel, la répétition et la simplicité caractérisaient également le magnifique Ballet cosmique de Kimia Nasirian et Nazanin Yalda, inspiré par le Bundahishn, un recueil de textes zoroastriens sur la création du monde. Au moyen de miroirs, de la lumière, d’ombres et de son propre corps, Nasirian a créé un environnement mystique, accompagnée par le paysage sonore créé par Yalda au sitar et au piano.
Pongo Pete s’est révélé être un prélude à la performance Afro-Renaissance de Dikoume, un véritable tour de force qui a commencé dans la cour des Abattoirs d’Anderlecht le lendemain. Afro-Renaissance peut signifier tout à la fois un retour aux racines et une projection dans l’avenir. Dikoume a été porté dans la cour et déposé au sol, le corps couvert d’un linceul. Une prêtresse, le corps enduit de peinture argentée et portant un vêtement noir, a déversé de l’eau colorée en vert et en bleu sur l’artiste, qui tressaillait et grelottait à ce contact. Libéré de son linceul et oint de peinture argentée, Dikoume est revenu à la vie et s’est dressé sur les échasses fixées à ses pieds, dansant et invitant avec force gestes le public à le suivre. La prêtresse d’argent, bras grands ouverts, a montré le chemin vers la sortie des Abattoirs et la rue Heyvaert, précédant Dikoume, une apparition hors du commun qui attirait les foules. La marche s’est terminée à la Grande Halle du canal, où Larissa Ebong a donné COND’ART-NÉ, un rituel de purification évoquant un traumatisme d’enfance et la perte d’un parent. Ebong portait des bottes et une tenue noire couverte de miroirs qu’elle a retirées et tendues à des spectateurs et spectatrices – un geste symbolique de soutien et d’aide.

La performance Minerais de sang s’est déroulée au Parc du Cinquantenaire, un lieu aménagé par Léopold II pour marquer les 50 ans de l’indépendance de la Belgique, et financé avec les bénéfices de l’extraction du caoutchouc par l’entreprise ABIR via le travail forcé imposé aux Congolais. Ras Sankara y a abordé l’histoire sanglante du colonialisme. Il a d’abord installé au niveau de la Fontaine du parc des gants en latex plongés dans de la peinture noire – une allusion à la conviction selon laquelle l’arcade a été construite sur les mains coupées de victimes congolaises. Portant une chemise blanche au dos de laquelle était inscrit le mot «liberté» et faisant tinter des bracelets de cheville en cauris, il a claudiqué pieds nus vers l’arcade en tirant un grand fardeau blanc enchaîné à lui. Arrivé au niveau de l’édifice, il a diffusé un enregistrement parlant d’Alice Seeley Harris, la missionnaire dont les photos documentent les atrocités commises par ABIR. Laissant là l’enceinte, Sankara a poursuivi son chemin vers le Monument aux pionniers belges au Congo – un hommage néoclassique au colonialisme – où il a terminé par un rituel de feu et d’eau visant à libérer le Congo du joug belge.

Du parc, il n’y avait qu’un pas vers La Balsamine, où s’est déroulée une autre performance de rue, The Pocket History of Polish Trauma [L’histoire de poche du traumatisme polonais], Marta Bosowska a employé des comptines et chansons polonaises ainsi qu’un trampoline pour démontrer pourquoi les Polonais continuent de souffrir d’un traumatisme intergénérationnel. Enfants, on leur proposait une collation, une activité divertissante et une dose malsaine d’idéologie par le biais de comptines et chansons. Le trampoline était accessible à ceux et celles disposés à chanter la chanson polonaise.
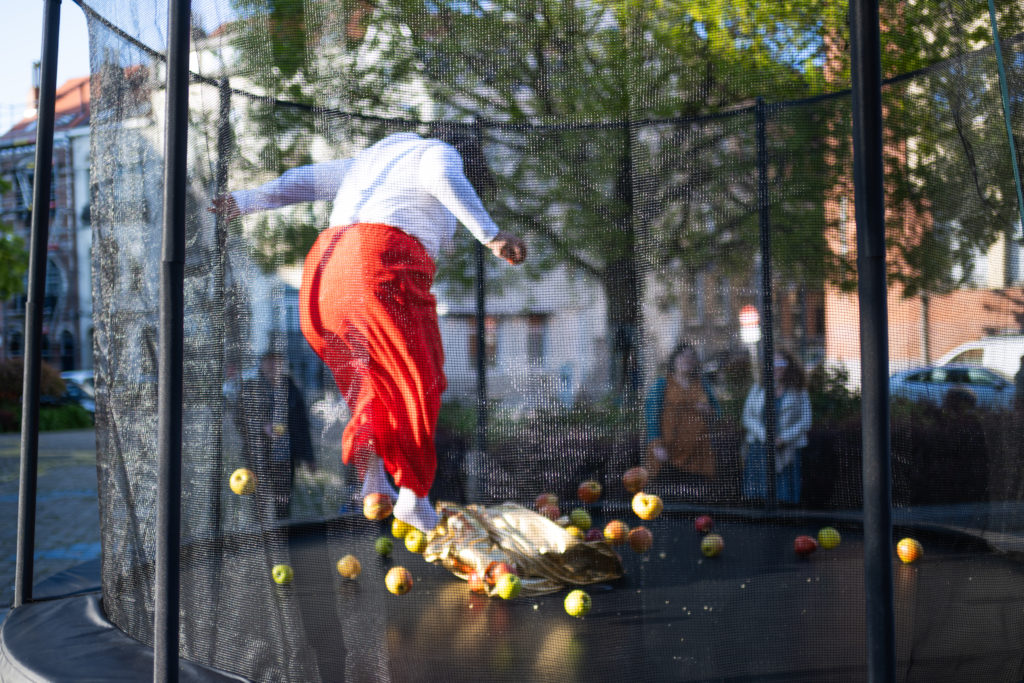
Deux autres performances ont été remarquées : The Fatal Obedience of the Image [L’obéissance fatale de l’image], où Day Magee explore à la fois le deuil provoqué par la perte du père et la représentation de soi, en se muant en autoportrait vivant délimité par un grand cadre blanc; et Inner Monologue [Monologue intérieur], où Wojtek Ziemilski, gisant au sol, converse avec les bactéries de son intestin. Après avoir passé huit ans à lutter contre la CBCG (colonisation bactérienne chronique de l’intestin grêle), il a placé un microphone contre son abdomen afin de négocier avec ces microbes – des entités vivantes entrant en conflit avec sa santé.
Dans ce festival mettant à l’honneur invocations et évocations, l’artiste Ana Mendieta, décédée en 1985, a été convoquée quarante ans après sa mort. Mendieta occupe une place particulière dans l’histoire de l’art: cette belle jeune femme caribéenne est morte des suites d’une chute depuis la fenêtre de son appartement, au 34e étage. Son mari, l’artiste Carl Andre, a été largement soupçonné d’avoir provoqué cette chute – mais sa culpabilité n’a jamais été prouvée. Les premières performances de Mendieta traitaient des violences sexuelles; ses œuvres ultérieures s’intéressaient aux femmes, à la nature et à la Déesse Mère. Aujourd’hui encore, des féministes se rassemblent à l’entrée des expositions consacrées au travail d’Andre, et mettent en scène des performances de protestation telles que Tears for Ana Mendieta [Larmes pour Ana Mendieta].
Véronique Danneels a organisé en hommage à Mendieta un colloque intitulé Moment réflexif: Vases communicants. En l’honneur de Mendieta et d’Annabel Guérédrat, dont le travail a été influencé par Mendieta. La partie la plus intéressante était la présentation de Guérédrat et l’entretien que Carol Laurent a effectué avec elle. Les deux performances de Guérédrat dans le cadre de Trouble #13 adoptaient des idées similaires à celles de Mendieta, mais dans une perspective postcoloniale et intersectionnelle, plaçant Mendieta et Guérédrat dans une vase toxique saturée d’algues postcoloniales. Guérédrat avait donné la veille, à La Raffinerie, MamiSargassa 5.0, une pièce enracinée dans l’afrofuturisme et l’écoféminisme radical. Contrairement à Afro-Renaissance, cette performance rejette toute vision nostalgique du passé pour plutôt dresser le portrait d’une déesse dystopique née de l’exploitation coloniale et de la sargasse, une algue toxique. Guérédrat a invité les participantes et participants du colloque à assister à sa performance Let’s Go Back to the River [Retournons à la rivière], qu’elle a présentée le dernier jour du festival avec sa collaboratrice Chloé Timon; ce rituel de purification de deux heures était inspiré par la vision de plénitude de Mendieta. Le public a été invité à s’allonger et se reposer, et Guéredrat et Timon ont tendrement lavé les mains et les têtes avec de l’eau parfumée, et invoqué la Mendieta des rituels caribéens plutôt que celle des attaques sexuelles et du meurtre.

Le dernier jour de Trouble #13 a été chargé d’énergie. D’abord avec Faire poing commun, une collaboration entre le danseur camerounais Zora Snake et un groupe de femmes bénévoles. Snake a dirigé un rituel public faisant honneur à la cosmogonie des Bamilékés, qui associe le corps de la femme à un pont entre les mondes visible et invisible.
La procession a connu son apogée lors d’une danse rituelle sur la place Saint-Josse, où la police est brièvement intervenue. Avant cela, Snake avait descendu la route en sprint, évitant de peu une ambulance, invitant les danseuses à investir l’espace – l’une d’elles s’est même allongée sur un passage piéton, et d’autres ont marché sur elle pour atteindre la place du marché. Ce même après-midi, Le Botanique, le parc néoclassique doublé d’une station de métro, a abrité plusieurs performances, dont une parade par Studio LDB+ et EDUBE par Dikoume, qui s’est terminée par la mise à feu d’une croix le Samedi Saint. Aimé⸱es Rossi, portant des bottes à talon rouges et une veste faite de vestiges de leur passé, ont entraîné à travers la ville un défilé de carnaval sous les traits d’un Makoumè – un symbole de la masculinité déviante – avant de mettre le feu à leur costume.

Et pour terminer, Rocío Boliver, aka La Congelada de Uva (MX), a réalisé la performance Resonance, qui abordait le vieillissement et le combat mené pour ne pas y céder. Durant une trentaine de minutes, Boliver, allongée nue sous un drap blanc, a semblé lutter contre un adversaire invisible qui la faisait trembler comme si un esprit avait pris possession d’elle et la contraignait à exposer son corps vieillissant d’une façon inconvenante. Cette performance était l’évocation d’un esprit/d’une idée qui entraînerait Boliver vers l’interdit, l’obscène, le pervers et le censuré – un plongeon délibéré dans la folie qui a abouti à une lucidité et une clarté d’esprit accrues. Les évocations peuvent être dangereuses, déclencher quelque chose d’incontrôlable. S’y confronter peut être extatique, jusqu’à transcender même la mort.
Article traduit de l’anglais par Émilie Syssau
Vous aimerez aussi

Une lessiveuse extratemporelle
Émois16 janvier 2026 | Lecture 6 min.
épisode 5/5

David Murgia & Odile Gilon
Grand Angle21 décembre 2025 | Lecture 2 min.
épisode 9/9

Réinventer... soi, sa production, son projet
Grand Angle12 décembre 2025 | Lecture 8 min.
épisode 3/3

Du plaisir du théâtre
Grand Angle18 novembre 2025 | Lecture 1 min.
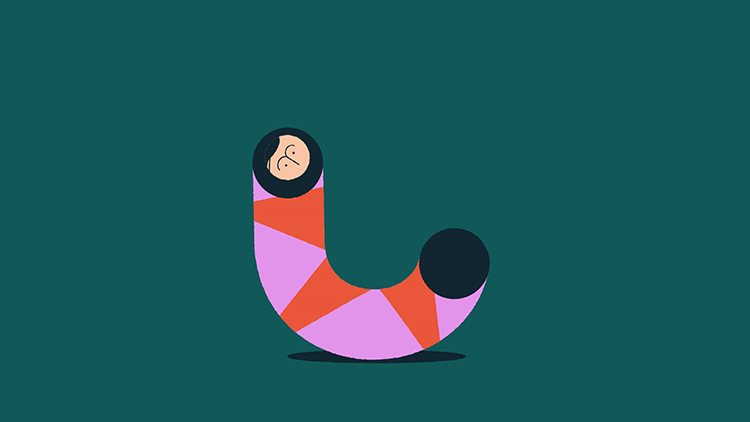
Le design: une chorégraphie d’idées
Au large17 novembre 2025 | Lecture 10 min.

Du design plus féministe
En ce moment2 novembre 2025 | Lecture 1 min.

Kassia Undead
En ce moment2 novembre 2025 | Lecture 3 min.

Créer toujours plus… Avec toujours moins?
Grand Angle29 octobre 2025 | Lecture 7 min.
épisode 2/3
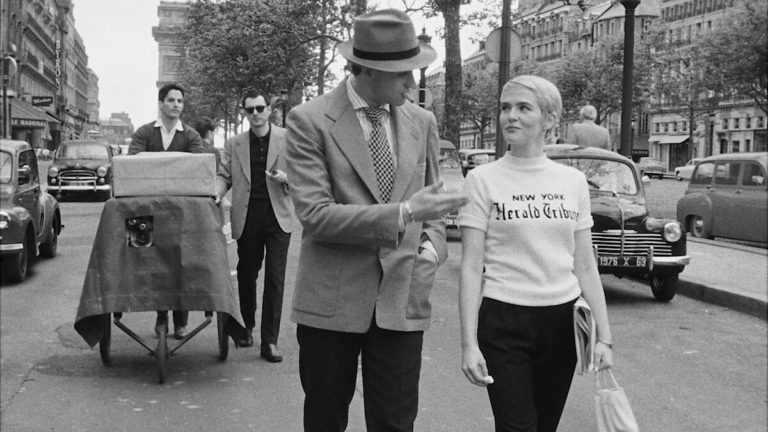
Nouvelle Vague
Émois17 octobre 2025 | Lecture 4 min.

Un retour en Yougoslavie
En ce moment10 octobre 2025 | Lecture 2 min.

Les étincelles de la saison 24-25
En ce moment6 octobre 2025 | Lecture 4 min.

Sortir du cadre... Pour mieux créer?
Grand Angle29 septembre 2025 | Lecture 8 min.
épisode 1/3

Soutenir les désirs artistiques, à quel prix?
Grand Angle26 septembre 2025 | Lecture 2 min.
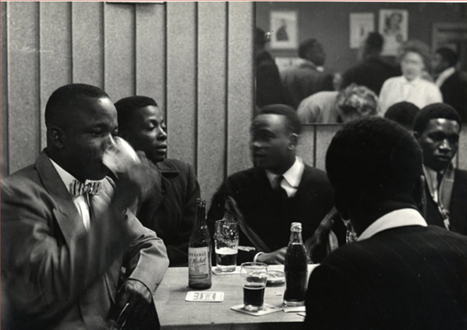
Bruxelles, la Congolaise
En ce moment12 septembre 2025 | Lecture 2 min.

Nicolas Mouzet Tagawa & Pierre Brasseur
Grand Angle17 juillet 2025 | Lecture 2 min.
épisode 7/9

Des milliers de raisons de vivre
Grand Angle16 juillet 2025 | Lecture 7 min.

Voir la mer et survivre
Émois8 juillet 2025 | Lecture 4 min.

Dalloway ouvre le Nifff!
En ce moment6 juillet 2025 | Lecture 3 min.

Toute une ville captivée
Au large5 juillet 2025 | Lecture 1 min.

Prix Maeterlinck: le retour
En ce moment27 juin 2025 | Lecture 4 min.
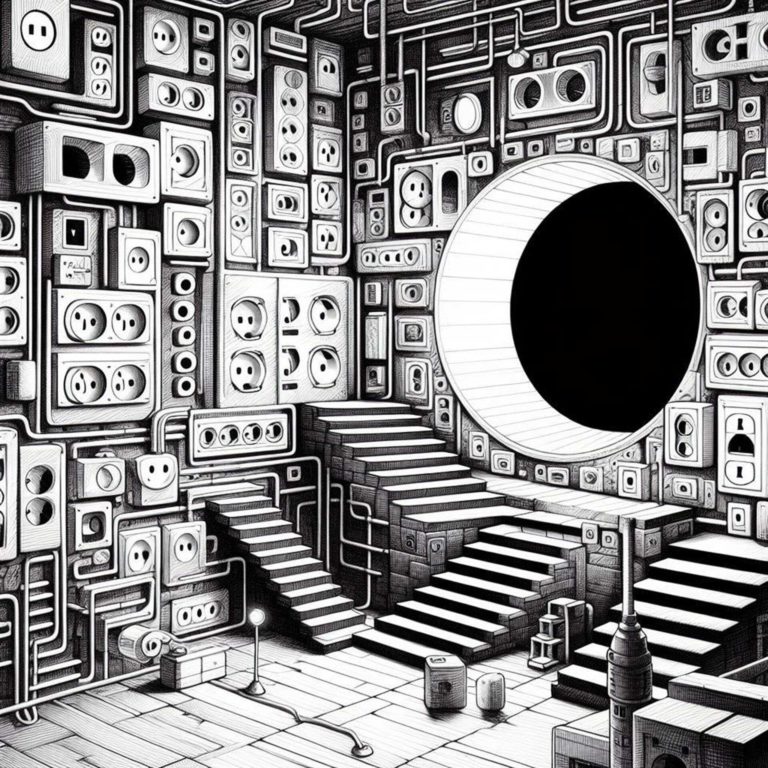
Simon Thomas & David Berliner
Grand Angle2 juin 2025 | Lecture 2 min.
épisode 5/9

Concret-abstrait, et vice-versa
Émois30 mai 2025 | Lecture 5 min.

KFDA, 30 ans
Grand Angle25 mai 2025 | Lecture 2 min.

La Maison Gertrude
En ce moment16 mai 2025 | Lecture 2 min.

Les désirs dans les mondes de l'art
En ce moment16 mai 2025 | Lecture 1 min.

Louise Vanneste, de la boîte noire au plein jour
Au large14 avril 2025 | Lecture 7 min.

L’ombre des espèces
En ce moment28 mars 2025 | Lecture 2 min.

Tac au tac
En ce moment15 mars 2025 | Lecture 2 min.

Puissances seules
En ce moment11 mars 2025 | Lecture 2 min.

RAGE
En ce moment7 mars 2025 | Lecture 2 min.

Salutations Mistinguettes
En ce moment7 mars 2025 | Lecture 2 min.

Véronique Clette-Gakuba & Zora Snake
Grand Angle5 mars 2025 | Lecture 2 min.
épisode 4/9

Laurence Rosier & Emilienne Flagothier
Grand Angle12 février 2025 | Lecture 2 min.
épisode 3/9

Décloisonner l’opéra
En chantier6 février 2025 | Lecture 1 min.
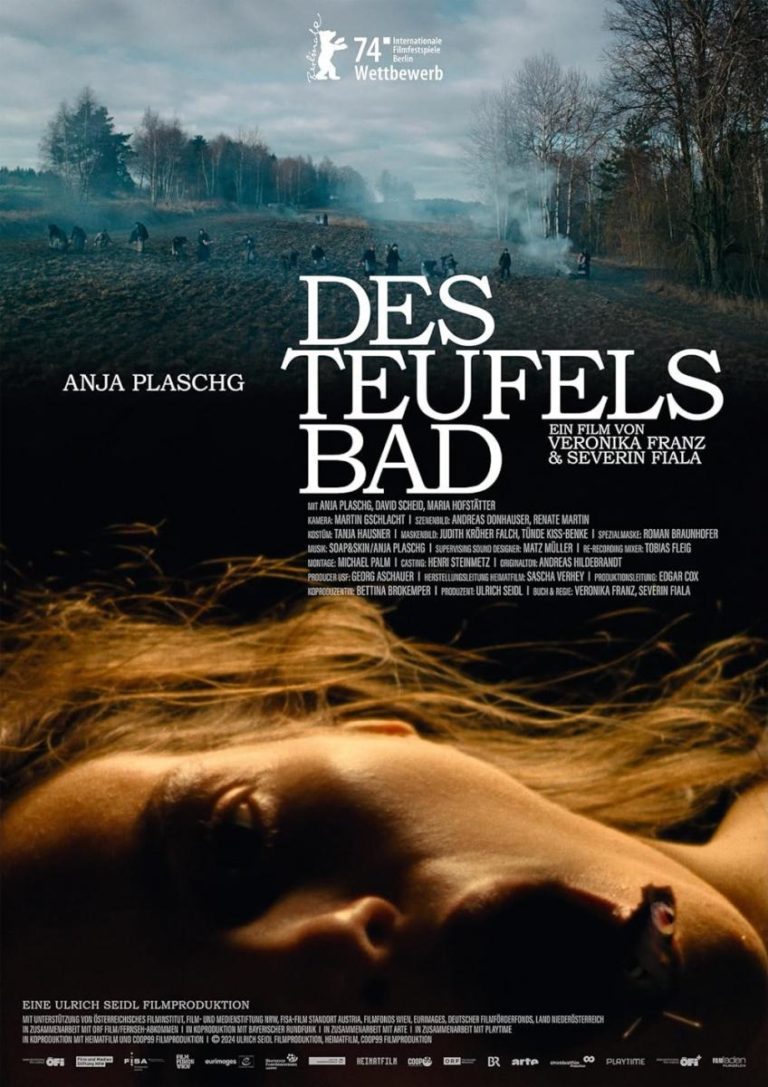
«Des Teufels Bad» de Veronika Franz et Severin Fiala
En ce moment30 janvier 2025 | Lecture 4 min.
épisode 3/6

«Quelque chose de paisible, de tranquille et de beau»
En ce moment30 janvier 2025 | Lecture 1 min.
épisode 2/6

Pierre Lannoy & Claude Schmitz
Grand Angle26 janvier 2025 | Lecture 2 min.
épisode 2/9

Le Pacha, ma mère et moi
Émois5 décembre 2024 | Lecture 3 min.
épisode 11/16

Les châteaux de mes tantes
En ce moment2 décembre 2024 | Lecture 2 min.

Musique Femmes Festival
En ce moment9 octobre 2024 | Lecture 2 min.

La Pointe On The Rocks!
Grand Angle6 octobre 2024 | Lecture 2 min.
épisode 1/3

État du monde
En ce moment23 septembre 2024 | Lecture 2 min.

Brûler, autour de Lucy
En chantier12 septembre 2024 | Lecture 12 min.

Au Brass
En ce moment8 septembre 2024 | Lecture 3 min.

Art et migration
Grand Angle2 septembre 2024 | Lecture 2 min.

Extimité.s par Zéphyr
Émois20 août 2024 | Lecture 3 min.
épisode 3/5
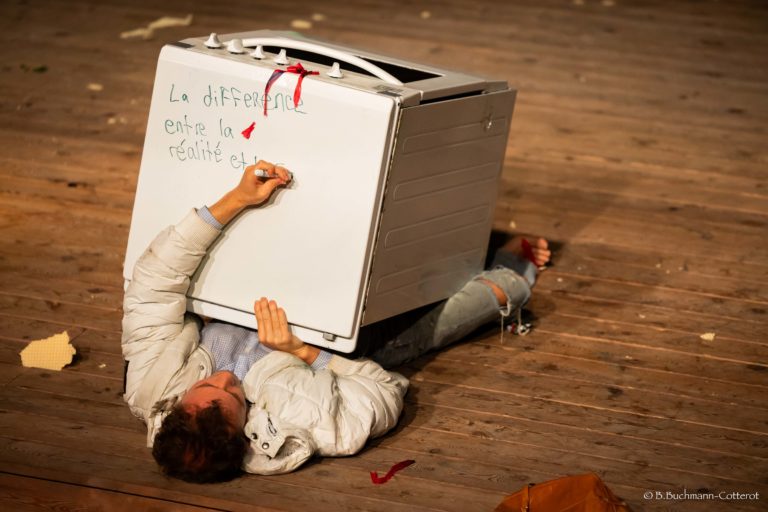
Et si Hansel avait consenti à être cuit vivant
Émois11 août 2024 | Lecture 5 min.
épisode 2/5

Les Rencontres Inattendues
En ce moment1 août 2024 | Lecture 2 min.

Sandrine Bergot, cap sur les Doms
Grand Angle25 juillet 2024 | Lecture 2 min.

Les hauts et les bas d’un théâtre de crise climatique à Avignon
Grand Angle22 juillet 2024 | Lecture 9 min.

Juana Ficción, chronique d’une disparition
Émois20 juillet 2024 | Lecture 4 min.

La petite fille sans nom
Au large17 juillet 2024 | Lecture 2 min.

Discofoot, Roller Derviches et leçons tout public
Au large9 juillet 2024 | Lecture 4 min.

Spoorloos/The Vanishing
En ce moment1 juillet 2024 | Lecture 2 min.
épisode 3/16
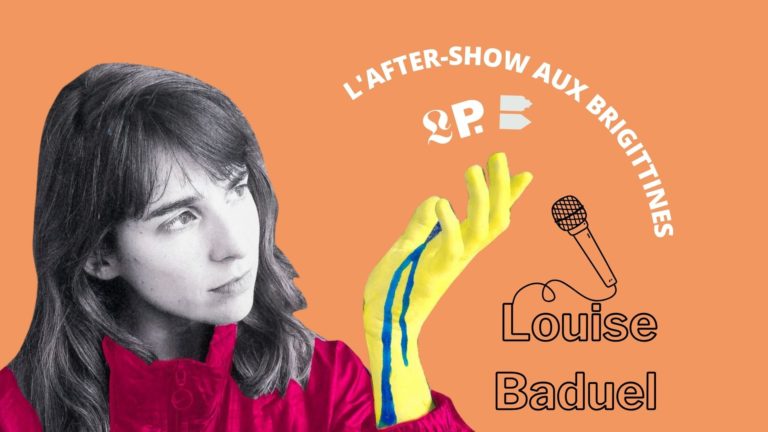
[PODCAST] Louise Baduel dans les paradoxes de l'écologisme
En chantier6 juin 2024 | Lecture 2 min.
épisode 10/10

Quelle place pour la culture dans les partis?
Grand Angle1 juin 2024 | Lecture 12 min.
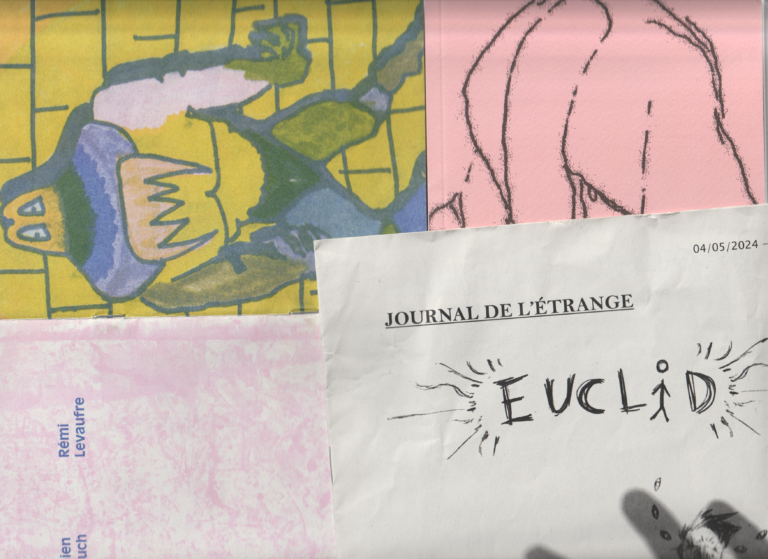
Entre Strasbourg et Liège, des livres inattendus
En chantier1 juin 2024 | Lecture 5 min.
épisode 8/9

Le festival TB²
En ce moment31 mai 2024 | Lecture 3 min.

Théâtre au Vert
En ce moment31 mai 2024 | Lecture 2 min.

Nacera Belaza
En chantier28 mai 2024 | Lecture 2 min.
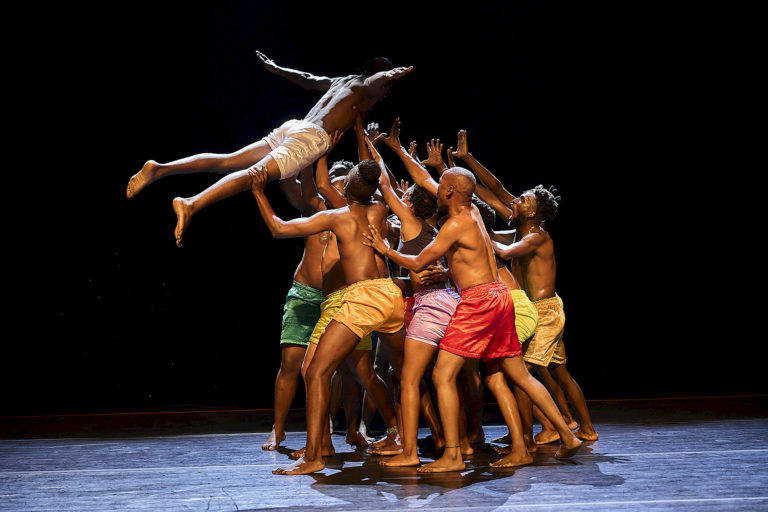
Idio Chichava au KFDA: découverte majeure
Émois19 mai 2024 | Lecture 5 min.

[PODCAST] KFDA 2024 L'art public selon Anna Rispoli
En chantier18 mai 2024 | Lecture 2 min.
épisode 2/2

Orlando: ma biographie politique, et des lieux qu’on habite ensemble
Émois17 mai 2024 | Lecture 5 min.
épisode 4/5

[PODCAST] 13 ans de création aux Brigittines racontés dans un livre
En chantier3 mai 2024 | Lecture 1 min.
épisode 9/10

L’Oiseau que je vois
En chantier24 avril 2024 | Lecture 1 min.
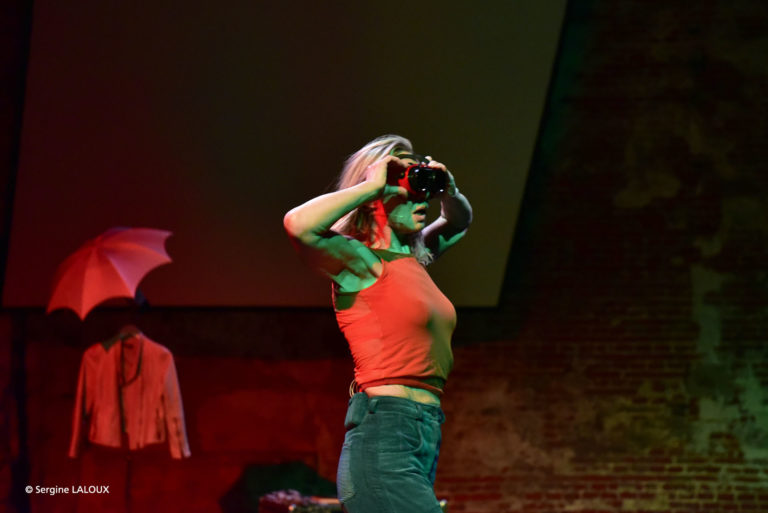
Louise Baduel et Michèle Noiret
En ce moment23 avril 2024 | Lecture 2 min.
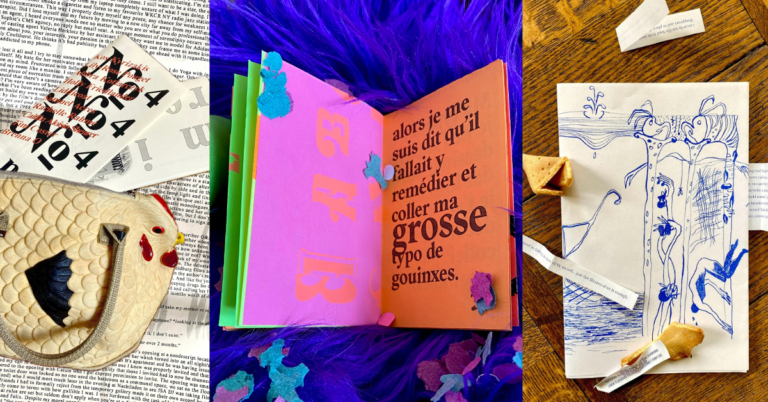
L'achronique de Karolina à Rile* Books: being iconic, clubbing et micropoèmes flamands
En chantier22 avril 2024 | Lecture 5 min.
épisode 7/9

Le zine s’institutionnalise-t-il? Interview avec Karolina Parzonko
En chantier22 avril 2024 | Lecture 7 min.
épisode 6/9

Second souffle
En chantier18 avril 2024 | Lecture 1 min.

Love Lies Bleeding
Émois15 avril 2024 | Lecture 4 min.

[VIDÉO] COLLEUSES FÉMINISTES ET COLÈRE DANS L’ESPACE PUBLIC AU THÉÂTRE VARIA
En chantier11 avril 2024 | Lecture 1 min.

Ma déficience visuelle ne devrait pas être un frein
Émois10 avril 2024 | Lecture 1 min.
épisode 1/1

À l’épreuve de la matière
En ce moment11 mars 2024 | Lecture 4 min.

Le Crazy Circle
Émois23 février 2024 | Lecture 6 min.
épisode 2/5

Tu l'as trouvé où, ce spectacle?
En ce moment19 février 2024 | Lecture 2 min.

Mutualiser… une (nouvelle) politique culturelle?
Grand Angle18 février 2024 | Lecture 4 min.

[VIDÉO] Dans l'atelier grouillant de Julie Larrouy à Saint-Gilles
En chantier7 février 2024 | Lecture 1 min.
épisode 3/3

La Barakakings à Naast Monique
Émois27 janvier 2024 | Lecture 5 min.
épisode 1/5
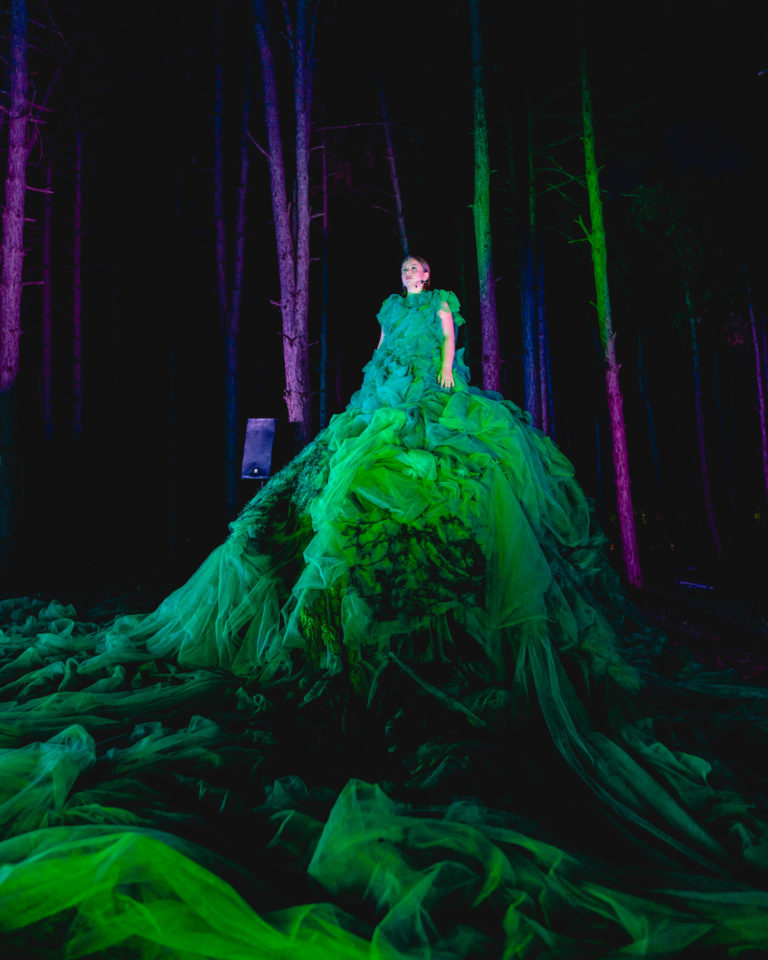
La semaine du son
En ce moment21 janvier 2024 | Lecture 2 min.

Janine Godinas
Grand Angle18 janvier 2024 | Lecture 1 min.

Priscilla
En ce moment7 janvier 2024 | Lecture 6 min.

007 à l’opéra
Émois4 janvier 2024 | Lecture 3 min.
épisode 3/6

Cherche employé·e de bureau
Grand Angle19 décembre 2023 | Lecture 12 min.

Comment l'école broie les Kévin
Grand Angle13 décembre 2023 | Lecture 1 min.

«Plonger», ou l'éloge de la suspension
En ce moment12 décembre 2023 | Lecture 1 min.

cinemamed
En ce moment29 novembre 2023 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] Théâtre et quartiers populaires avec Yousra Dahry
Grand Angle16 novembre 2023 | Lecture 2 min.

[PODCAST] Arco Renz et Danielle Allouma en spirales hypnotiques
En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.
épisode 8/10

[PODCAST] Chloé Beillevaire et Sabina Scarlat, bouffonnes en collants
En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.
épisode 7/10

[PODCAST] Karine Ponties au confluent du réalisme et de l'abstraction
En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.
épisode 6/10

[PODCAST] Le pouvoir des ondes sonores avec Marielle Morales
En chantier8 novembre 2023 | Lecture 1 min.
épisode 5/10

Sur la vieillesse au théâtre
Grand Angle30 octobre 2023 | Lecture 11 min.

Au pays de l’or blanc
En ce moment22 octobre 2023 | Lecture 4 min.
épisode 6/7

Macbeth au Shakespeare’s Globe
Au large17 octobre 2023 | Lecture 3 min.

Miroir Miroir
En ce moment16 octobre 2023 | Lecture 2 min.

L’Amour c’est pour du beurre
En ce moment16 octobre 2023 | Lecture 2 min.

Prendre soin, par le théâtre aussi
En ce moment4 octobre 2023 | Lecture 1 min.

Danse Avec les Foules
En ce moment2 octobre 2023 | Lecture 1 min.

Hippocampe
En ce moment29 septembre 2023 | Lecture 2 min.

La sentinelle du sens
Grand Angle29 août 2023 | Lecture 1 min.
épisode 3/10

Initier au matrimoine littéraire
En chantier25 août 2023 | Lecture 5 min.

Grande Fête Pointue
En ce moment24 août 2023 | Lecture 1 min.

Le vrai calme se trouve dans la tempête
Au large21 août 2023 | Lecture 5 min.

Théâtre au Vert: diversité, simplicité, sincérité
En ce moment19 août 2023 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] Lumière sur le vitrail dans l'atelier de François et Amélie
En chantier7 août 2023 | Lecture 1 min.
épisode 2/3

Réhabilitons Welfare, le spectacle mal-aimé d’Avignon 2023
Émois3 août 2023 | Lecture 11 min.

Violence symbolique et agressions réelles
Émois28 juillet 2023 | Lecture 6 min.

À Avignon, Julien Gosselin nous a percutés
Émois23 juillet 2023 | Lecture 8 min.

Drame familial sur fond d'imaginaire décolonisé
Grand Angle17 juillet 2023 | Lecture 1 min.

Place aux narrations féministes
En ce moment13 juillet 2023 | Lecture 12 min.

Retour sur l'Auberge Cabaret Bethléem
Émois10 juillet 2023 | Lecture 4 min.
épisode 1/1

Avignon, le festival, et moi
En ce moment4 juillet 2023 | Lecture 1 min.

Cinq spectacles québécois en rafale au FTA et au Carrefour
Au large30 juin 2023 | Lecture 13 min.

Échappées urbaines
En ce moment12 juin 2023 | Lecture 2 min.

La condition pavillonnaire ou la terreur du quotidien
Émois1 juin 2023 | Lecture 4 min.
épisode 10/15

[VIDÉO] Valse des matériaux dans l'atelier de Jacques Di Piazza
En chantier27 mai 2023 | Lecture 1 min.
épisode 1/3
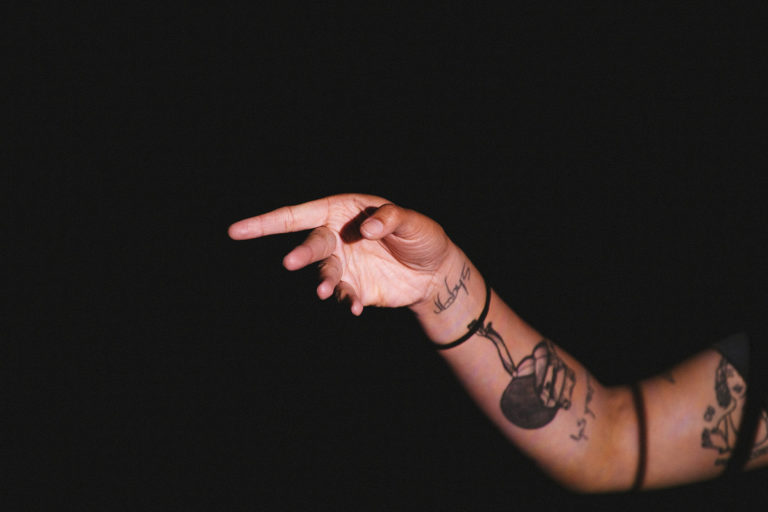
Depuis que tu n’as pas tiré
En ce moment24 mai 2023 | Lecture 2 min.

Le Brussels Jazz week-end
En ce moment24 mai 2023 | Lecture 2 min.

«Collision» et ça repart!
En ce moment24 mai 2023 | Lecture 2 min.

Malaise dans la civilisation
Émois19 mai 2023 | Lecture 3 min.

Garder l'enfance allumée
Grand Angle15 mai 2023 | Lecture 7 min.

Hormur: une plateforme pour créer dans des lieux insolites
En chantier15 mai 2023 | Lecture 1 min.

Le KFDA commence fort avec Angela, a strange loop
Émois13 mai 2023 | Lecture 4 min.

Serge Aimé Coulibaly, danser ici et ailleurs
Au large28 avril 2023 | Lecture 1 min.

Créer ensemble dans la ville
Au large24 avril 2023 | Lecture 0 min.
épisode 6/6

Des forêts et des sardines
Grand Angle21 avril 2023 | Lecture 7 min.

[VIDÉO] Boucles infinies avec Arco Renz et Danielle Allouma
En chantier18 avril 2023 | Lecture 1 min.

Le collectif suisse BPM déploie son irrésistible «Collection»
Émois17 avril 2023 | Lecture 5 min.

Brulex et Mathieu Desjardins
En ce moment17 avril 2023 | Lecture 2 min.

[VIDÉO] Chloé Beillevaire et Sabina Scarlat, étonnantes «folles du roi»
En chantier12 avril 2023 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] L'ART SUBTIL DE LA RELAX PERFORMANCE AVEC SIDE-SHOW
En chantier30 mars 2023 | Lecture 1 min.

Indiscipline à Knokke!
En ce moment29 mars 2023 | Lecture 2 min.

Nedjma Hadj Benchelabi: programmatrice-dramaturge
Au large28 mars 2023 | Lecture 1 min.
épisode 5/6

De la création à la pédagogie, un engagement continu
Au large24 mars 2023 | Lecture 1 min.
épisode 2/6

[VIDÉO] LE BANAL SUBLIMÉ AVEC KARINE PONTIES
En chantier20 mars 2023 | Lecture 2 min.

[VIDÉO] Entre l'audible et l'invisible avec Marielle Morales
En chantier15 mars 2023 | Lecture 1 min.

Ces paroles qui nous rassemblent
Grand Angle7 mars 2023 | Lecture 1 min.
épisode 2/10

Carte noire nommée désir
Émois20 février 2023 | Lecture 4 min.
épisode 7/15

Rabelais revient à la charge
Grand Angle18 février 2023 | Lecture 1 min.
épisode 1/10

Archipel_o
En ce moment13 février 2023 | Lecture 2 min.

Les dents de Lumumba
Grand Angle25 janvier 2023 | Lecture 2 min.
épisode 2/3

Okraïna Records fête ses dix ans!
Grand Angle17 janvier 2023 | Lecture 1 min.

Tervuren
En chantier13 janvier 2023 | Lecture 4 min.

Philippe Grombeer et les Halles
En ce moment10 janvier 2023 | Lecture 4 min.

Morel, c’est quelqu’un!
Grand Angle10 janvier 2023 | Lecture 1 min.

Les murs ont la parole
Au large9 décembre 2022 | Lecture 10 min.

La très belle métamorphose d’une traduction des Métamorphoses
Grand Angle18 novembre 2022 | Lecture 1 min.
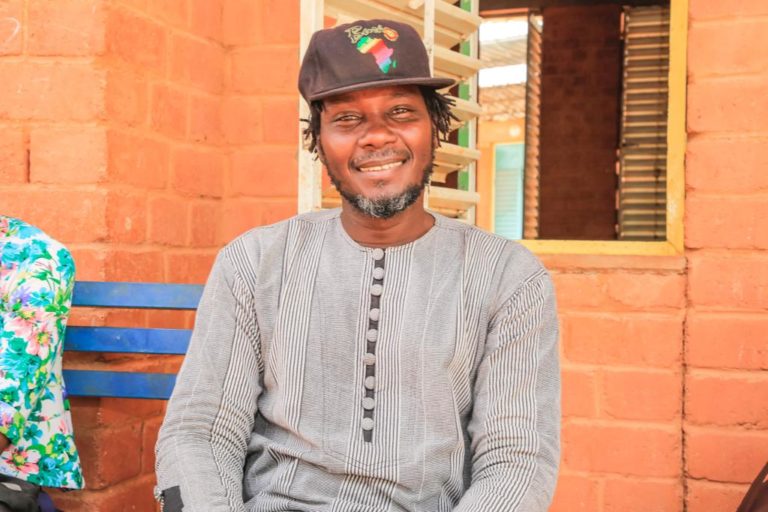
La puissance des langues vernaculaires
Au large15 novembre 2022 | Lecture 2 min.

Méduse.s par le collectif La Gang
Grand Angle11 novembre 2022 | Lecture 10 min.
épisode 2/3

Du théâtre malgré tout
Au large9 novembre 2022 | Lecture 2 min.

Que nos enfants soient des géants
Au large7 novembre 2022 | Lecture 1 min.

La puissance de Dionysos
Au large3 novembre 2022 | Lecture 5 min.
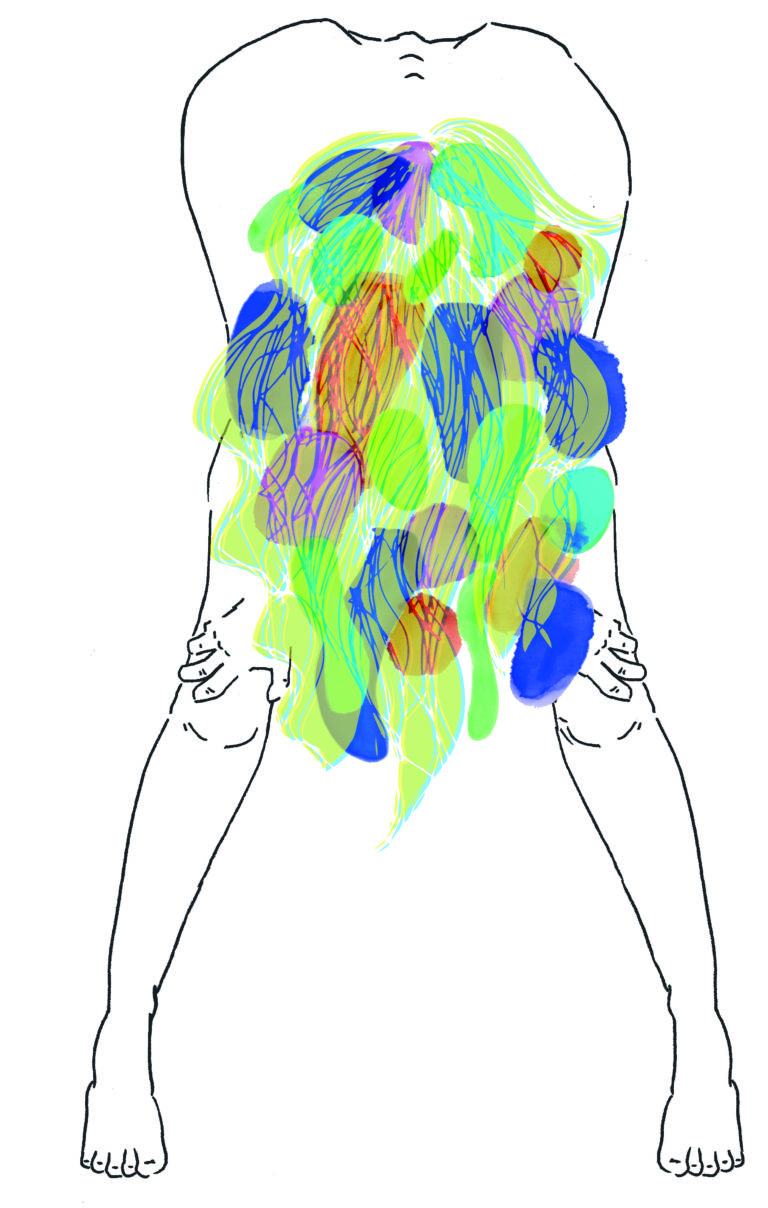
Créer pour faire advenir le female gaze
Grand Angle27 octobre 2022 | Lecture 6 min.
épisode 1/3

Déplacer l’espace du théâtre dans les cours familiales
Au large24 octobre 2022 | Lecture 1 min.

«Ça a commencé?»
Grand Angle19 octobre 2022 | Lecture 7 min.

[VIDÉO] Au fin fond des temps avec la compagnie Mossoux-Bonté
En chantier18 octobre 2022 | Lecture 1 min.

Cinéaste et thérapeute corporelle
Grand Angle14 octobre 2022 | Lecture 1 min.
épisode 18/18

Donner sa place au public
Au large12 octobre 2022 | Lecture 2 min.

Les Halles de Schaerbeek. Toute une histoire!
Émois5 octobre 2022 | Lecture 6 min.
épisode 4/4

[VIDÉO] En immersion avec Tumbleweed aux Brigittines
En chantier1 octobre 2022 | Lecture 1 min.

Scénographe et maman
Grand Angle30 septembre 2022 | Lecture 2 min.
épisode 3/6

Un nouveau prix au Burkina Faso!
Au large28 septembre 2022 | Lecture 4 min.

La rétrospective Akira Kurozawa
En ce moment27 septembre 2022 | Lecture 1 min.

Au festival Nourrir Bruxelles
18 septembre 2022 | Lecture 1 min.

Trouver un lieu pour y faire du théâtre
Grand Angle17 septembre 2022 | Lecture 1 min.
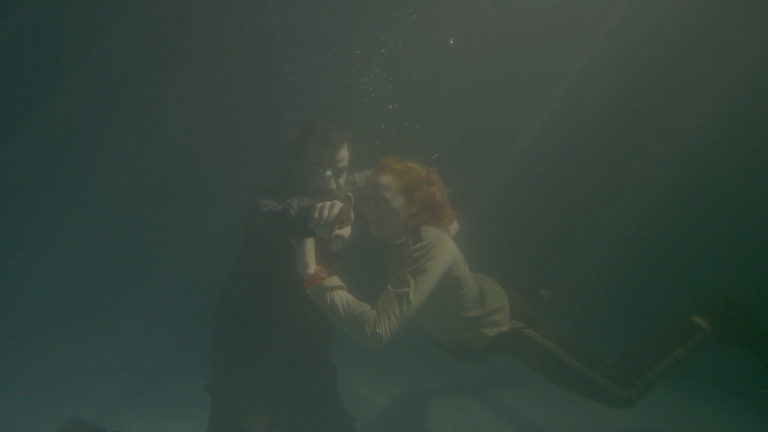
VIRUS-32. Les Variations Zombiques.
En ce moment10 septembre 2022 | Lecture 2 min.

Silent Night. Last Christmas?
En ce moment9 septembre 2022 | Lecture 2 min.

Éducatrice et maquilleuse
Grand Angle8 septembre 2022 | Lecture 1 min.
épisode 17/18

Megalomaniac. Vive l’enfer...
En ce moment3 septembre 2022 | Lecture 2 min.

Il est parti...
Émois31 août 2022 | Lecture 4 min.

Still Life fait régner le théâtre sans paroles à Avignon
Grand Angle23 juillet 2022 | Lecture 1 min.

Paradiso du Teatro delle Albe
Au large19 juillet 2022 | Lecture 4 min.
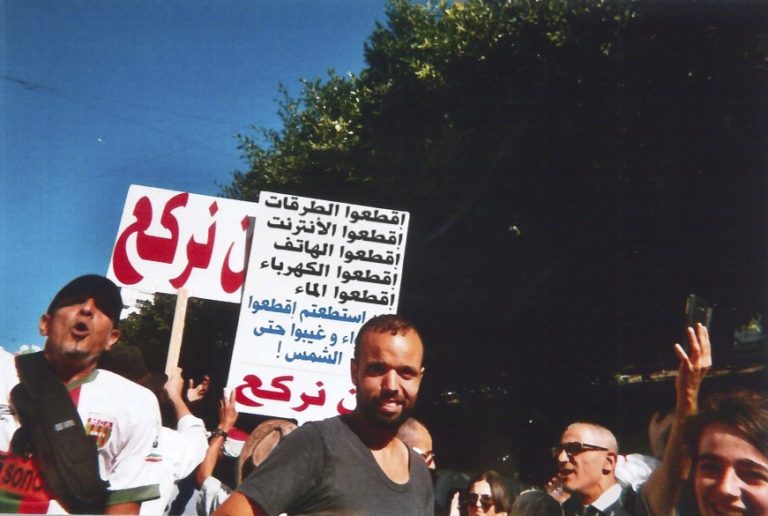
Koulounisation de Salim Djaferi
En ce moment16 juillet 2022 | Lecture 1 min.

Accompagner plutôt que programmer
Grand Angle3 juillet 2022 | Lecture 7 min.

24h dans la vie du théâtre des Doms
En ce moment3 juillet 2022 | Lecture 3 min.

Circassienne, le saut dans le vide
Grand Angle3 juillet 2022 | Lecture 4 min.
épisode 3/3

Comédien et guide à l’Africa Museum de Tervuren
Grand Angle1 juillet 2022 | Lecture 1 min.
épisode 15/18

Un festival au grand jour
Au large5 juin 2022 | Lecture 3 min.

Entrer et voir le bar
Grand Angle30 mai 2022 | Lecture 1 min.

«T’inquiète pas, je te rattrape»
Grand Angle30 mai 2022 | Lecture 4 min.
épisode 2/3

L'échec vu du public
En chantier28 mai 2022 | Lecture 3 min.
épisode 3/4
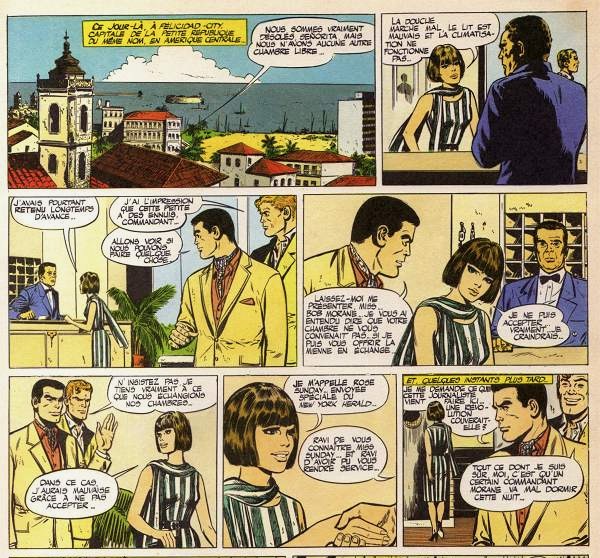
Bob Morane
Émois28 mai 2022 | Lecture 3 min.
épisode 3/15

«Désir ou amour, tu le sauras un jour.»
Émois18 mai 2022 | Lecture 1 min.
épisode 3/3

Rockeur et traducteur
Grand Angle13 mai 2022 | Lecture 1 min.
épisode 11/18

Démontage du chapiteau patriarcal
Grand Angle10 mai 2022 | Lecture 6 min.
épisode 1/3

Gestionnaire le matin et artiste l'après-midi
Grand Angle9 mai 2022 | Lecture 1 min.

Même pas mort le répertoire
En ce moment2 mai 2022 | Lecture 2 min.
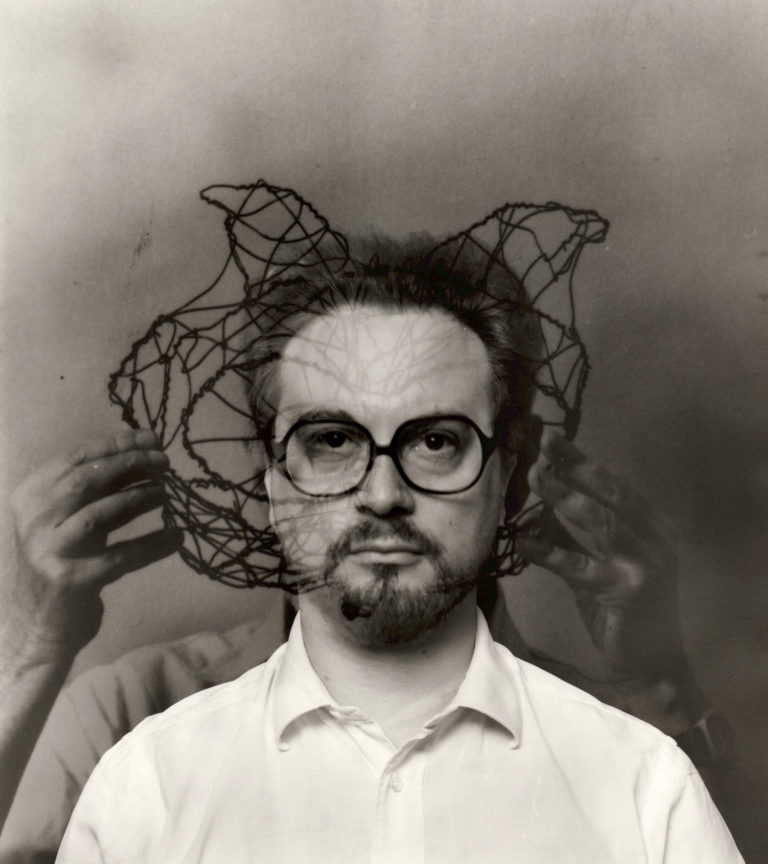
La fascination du mal
En ce moment1 mai 2022 | Lecture 1 min.

Amour et terreur
En ce moment1 mai 2022 | Lecture 1 min.

Guyane, Liban, Iran, Japon...
En ce moment1 mai 2022 | Lecture 1 min.

Fabienne Cresens
Grand Angle1 mai 2022 | Lecture 5 min.
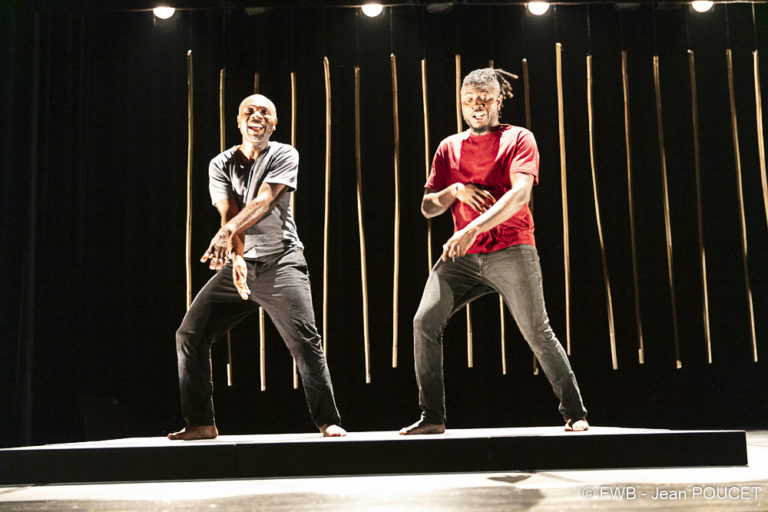
De la musique à la danse de luttes
En ce moment21 avril 2022 | Lecture 1 min.

«Faut pas dire à qui je ressemble, faut dire qui je suis.»
Émois21 avril 2022 | Lecture 1 min.
épisode 2/3

Marie Losier
18 avril 2022 | Lecture 1 min.

Les meilleurs sont les plus courts
18 avril 2022 | Lecture 1 min.

Comédienne et maman
Grand Angle15 avril 2022 | Lecture 1 min.
épisode 2/6
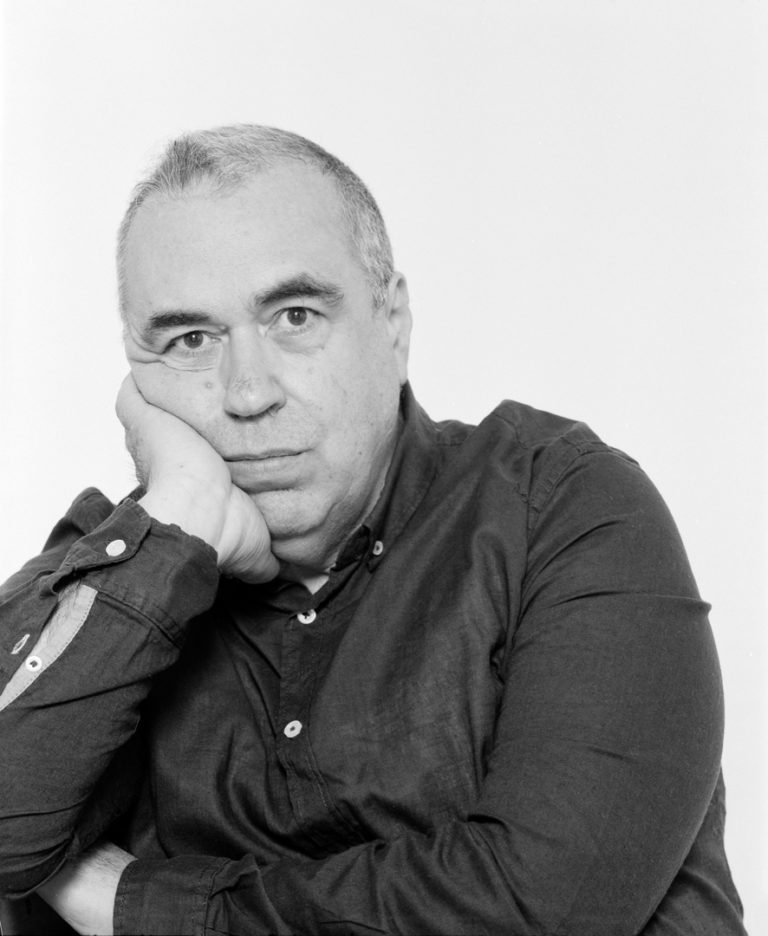
Saxophoniste et importateur d'huile d'olive
Grand Angle11 avril 2022 | Lecture 2 min.
épisode 8/18
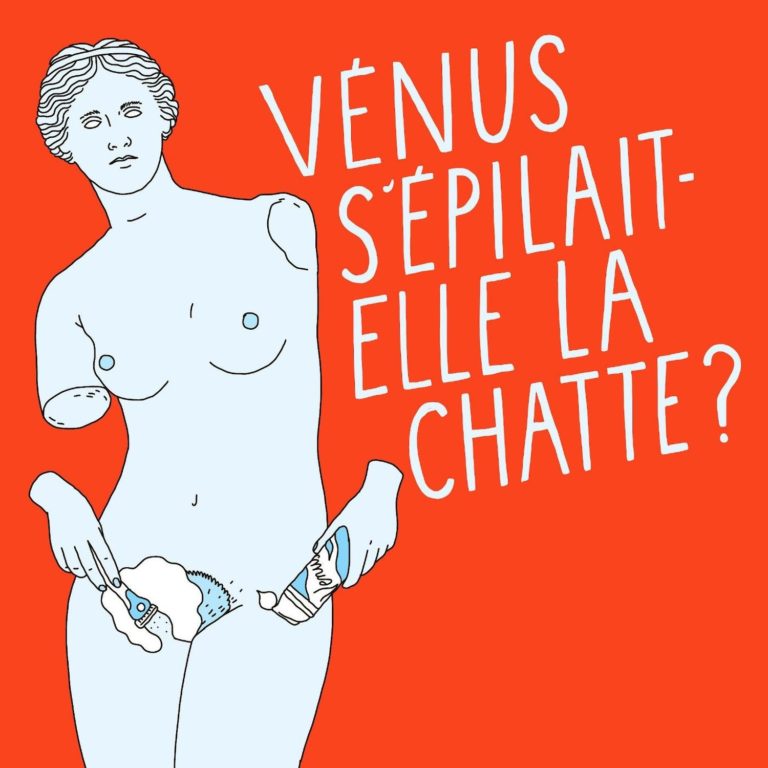
Aller au festival du podcast
4 avril 2022 | Lecture 2 min.

Comédien et formateur en entreprise
Grand Angle25 mars 2022 | Lecture 1 min.
épisode 7/18
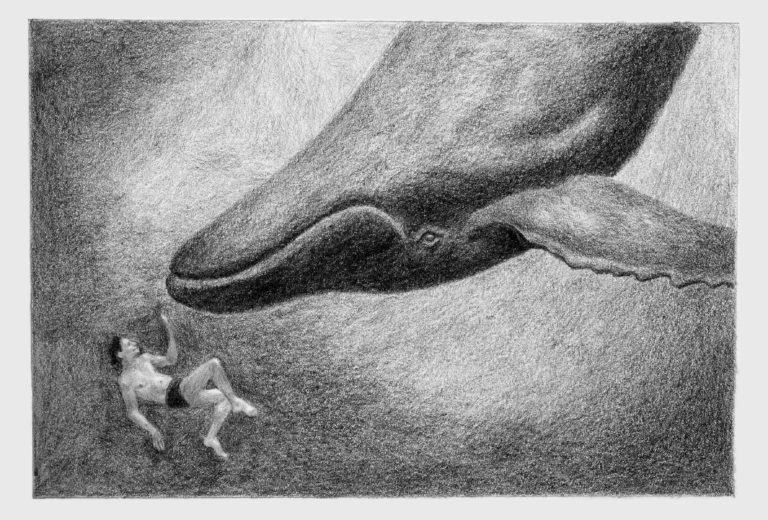
Archipel
En ce moment23 mars 2022 | Lecture 4 min.

Juwaa
14 mars 2022 | Lecture 1 min.

Une nuit à l'Union saint-gilloise
Émois7 mars 2022 | Lecture 13 min.
épisode 2/4

Les conditions extérieures à l’échec
En chantier1 mars 2022 | Lecture 4 min.
épisode 2/4
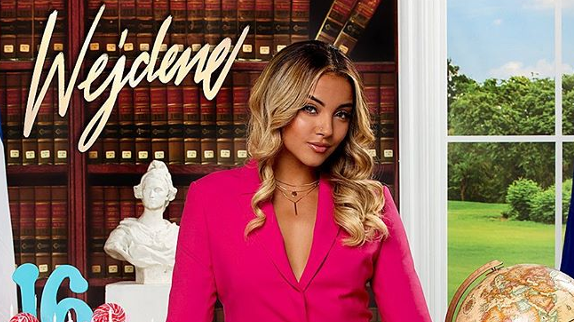
«L'amour c'est compliqué, les sentiments sont profonds.»
Émois14 février 2022 | Lecture 1 min.
épisode 1/3

Échappatoire à la Saint Valentin
Émois14 février 2022 | Lecture 4 min.

Déboires assumés
En chantier31 janvier 2022 | Lecture 8 min.
épisode 1/4

Diriger un festival: à deux, c’est mieux
Grand Angle31 janvier 2022 | Lecture 7 min.

Le vent tourne II
Grand Angle29 décembre 2021 | Lecture 7 min.

Acteur et plombier/chauffagiste
Grand Angle28 décembre 2021 | Lecture 1 min.
épisode 2/18

Diriger un théâtre: un geste politique
Grand Angle28 décembre 2021 | Lecture 2 min.

Un spectacle par ses costumes
En ce moment16 septembre 2021 | Lecture 5 min.

L'ouverture mythique de la Raffinerie du Plan K
Grand Angle10 juin 2021 | Lecture 3 min.

Vieilles peaux
Émois12 mars 2021 | Lecture 5 min.