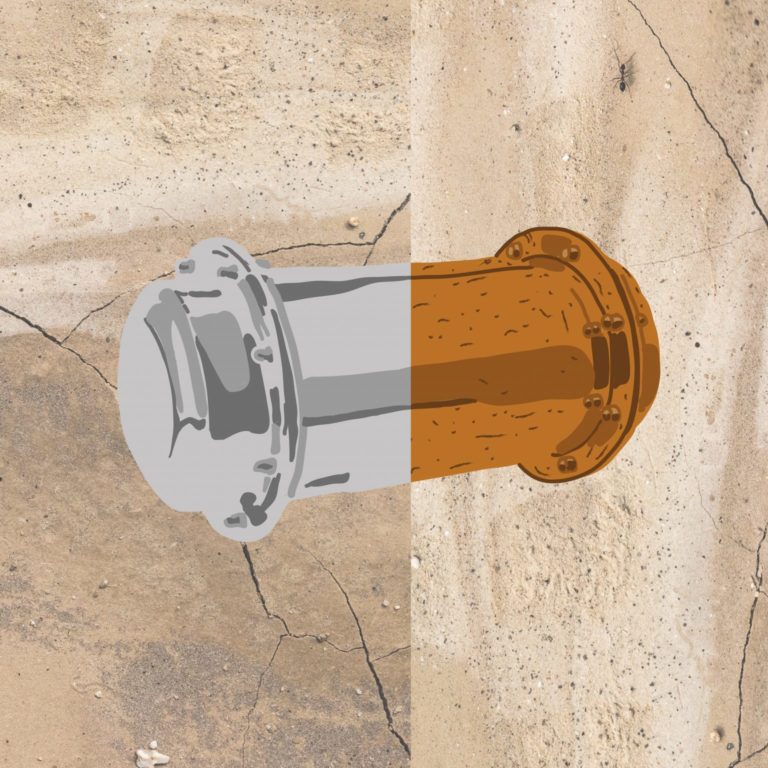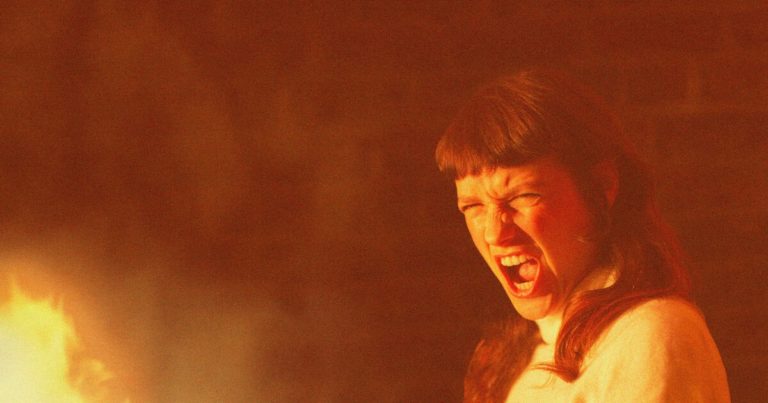De la création à la pédagogie, un engagement continu
Au large24 mars 2023 | Lecture 1 min.
épisode 2/6
Karolina SvobodovaVous vous définissez en tant que chorégraphe-pédagogue. Pourriez-vous revenir sur votre parcours avec votre première formation que vous qualifiez de «sauvage» et nous raconter comment celle-ci a influencé la manière dont vous concevez votre pratique et votre engagement de pédagogue?
Taoufiq IzeddiouQuand je parle de formation sauvage, c’est un peu brut mais à l’époque j’avais besoin de le dire parce que ce n’était pas une formation. C’était des ateliers, des stages de danse de 10 jours ou une semaine, une fois tous les trois mois. Entretemps, nous devions nous-mêmes inventer notre propre danse, nos réflexions. J’éprouvais un manque de rencontres et j’avais des reproches à formuler: il y avait trop de participant·es et les intervenant·es, devant tout ce monde, baissaient leur exigence. On était en train de courir derrière les intervenant·es pour trouver des idées… Quand, plus tard, j’ai voulu mettre en place des formations, je me suis inspiré de tous ces reproches mais aussi des aspects positifs. Parce qu’en regardant cette formation ‘sauvage’, j’ai rencontré que des grands, sans m’en rendre compte. Les grands m’ont fait gagner beaucoup de temps! Quand je rencontre Josef Nadj pendant trois heures, je sors de là et je me dis que c’est ça que je veux faire!
J’ai donc mis en place un système dans mes formations, avec les «viviers», les «extras» et les «flottants»: les viviers, ce sont celles et ceux qui sont là pour la danse, les futurs danseurs et danseuses, les extras, ce sont des talentueux mais qui font aussi autre chose: des études, un travail… Les flottants, ce sont celles et ceux qui sont là de temps en temps… Je ne crois pas qu’on puisse former des chorégraphes mais on peut créer des chemins, on peut repérer celles et ceux qui ont un univers et leur donner le temps pour qu’iels puissent le développer.

Vous liez également votre travail de formation et de création.
Oui, à travers la formation j’ai aussi beaucoup appris, les laboratoires sont inspirants pour la création. On entre dans un processus de recherche artistique et pédagogique.
On ne peut pas que transmettre son savoir-faire sans se poser la question de l’adresse, à qui on le transmet et pourquoi. Il y a la préoccupation de faire la danse, pour faire exister la danse il faut faire exister des danseur·euses, donc cette préoccupation d’une prochaine génération. C’est une préoccupation existentielle qui nous a poussé à créer les Prix Taklif.
Dans Hmadcha, il y a trois générations de danseur·euses, issu·es des laboratoires de formations Al-Mokhtabar et de l’école Nafass. On n’a pas d’école mais on a une pensée d’école. En 20 ans, j’ai développé cette pensée d’école que j’ai appelé Nafass, qui veut dire «souffle».
On a commencé Nafass en 2019. Pendant le covid, on a perdu beaucoup de monde. La création de Hmadcha a été suscitée par la situation des danseur·euses qui deviennent livreur·euses, qui travaillent dans des centres d’appel et arrêtent la danse. Tout le travail de formation commence alors à s’évaporer! Cette pièce m’a permis de rassembler du monde, pour avoir un repère commun et se demander: comment relancer la machine après le covid?
Quels sont les enjeux et les défis d’une telle initiative au Maroc aujourd’hui?
Au Maroc, former pour former ça ne veut rien dire, les gens doivent être en création permanente, être confrontés au public de manière permanente, être dans des résultats. Beaucoup de danseur·euses présent·es pendant le festival viennent de Nafass, iels y présentent leurs premières créations.
Ce qui est en train de se pratiquer au festival «On Marche» depuis le 28 février 2023, c’est, pour moi une annexe à Nafass, c’est ce que j’appelle «Nafass on marche». Ce sont les stages avec les formateurs présents: Jumata Poe (USA), Sylvain Groud (F), Julien-Henri Vu Van Dung (F). En ce moment, Nafass est très actif. Maintenant c’est dans la continuité qu’il faut réfléchir.
Il y a aussi la question du lieu qui se pose pour nous. On avait une salle à l’ESAV (École Supérieure des Arts Visuels), on travaille à l’Institut Français, à la Maison Denise Masson. La salle, elle est très importante mais en même temps, elle n’est pas si importante que ça parce que la réflexion, elle, continue tout le temps, elle se fait partout: avec moi ou sans moi, quand vous dansez dans votre salon, à gauche et à droite, c’est ça notre réalité aujourd’hui. Donc il ne faut pas vouloir rassembler à l’Europe, avec certains modèles: avoir un plancher, avoir ci ou ça, parce qu’on n’est pas dans cette situation, on n’a pas ça et la vie ne doit pas s’arrêter.
On a fait des éditions dans des appartements, «Danse F la parte», et on a invité des artistes internationaux pour partagez notre vécu. Nous, on est obligés de danser dans des appartements parce qu’on n’a pas de lieu et pour eux ça change complètement le rapport au public, à la lumière. On a aussi créé «danse contre nourriture», pour pouvoir initier un public. C’est la famille qui devient organisatrice de l’événement, elle prépare l’espace, elle prépare à manger, nous on vient, on danse, on mange et on discute. Je dis toujours que tous les cafés de Marrakech sont mes bureaux et toutes les rues sont mes lieux de résidence. Hier, nous avons dansé dans une salle d’exposition, ce soir on va danser sur une terrasse, on va sur la place, dans l’espace public… C’est ce rapport à l’espace qui est dans Nafass aussi: les escaliers, c’est un espace, la terrasse, c’est un espace. Mais si on a cette fameuse salle avec un plancher où on ne va pas se blesser, où il y a une intimité et où on peut se poser et travailler, c’est bien. Si on a un lieu qui peut être aussi un repère pour la société, des murs pour la danse, why not? Mais ça veut dire qu’il ne faut pas s’installer dans ce luxe. Ce que je dis toujours aux jeunes c’est: quand on va sur la scène, on va avec tout, tout ce qu’on vit en dehors nous charge, on sait pourquoi on fait ça. Le dehors, c’est notre terrain de jeu, l’information se trouve dans la rue, dans un rapport à la lumière, dans la Médina. Au Maroc, on veut un lieu mais on ne souhaite pas perdre tous ces lieux qu’on a créés. On a besoin de ces deux mondes, on ne peut pas s’enfermer.
Dans le texte de présentation du spectacle Äataba (Le Seuil), créé en 2008, on peut lire à propos des boîtes de nuit et des espaces intérieurs privés: «L’intériorité de chacun doit être invisible au-dehors: dans la rue prime l’extériorité des professions ou de la religion. Dans la rue, les corps cessent d’être eux-mêmes. Dans les sous-sols, ils ne se cachent plus: ils osent, ils vivent, ils jouissent. Et oublient tout. On pourrait être n’importe où dans le monde… seulement on est au Maroc…» Ces considérations sont-elles toujours d’actualité ou bien la situation s’est transformée? Quel est l’accueil fait à vos corps dansants dans l’espace public?
On continue à voir différentes façons d’être avec notre corps dans l’espace public, la situation est mieux acceptée. Ce que fait le festival, ce n’est pas assez, d’où l’idée d’instaurer un forum de discussion cette année autour de cette question: pourquoi les intellectuels ont abandonné le corps? C’est une question pour tout le monde, pas que pour les danseur·euses. On habite l’espace avec nos corps, les gens sont habitués à nous voir; certains nous prennent pour des fous, pour d’autres la danse contemporaine c’est quelque chose d’Occidental, qui vient d’ailleurs. Et puis il a celles et ceux qui trouvent que c’est beau, qu’on a besoin de nouvelles choses. Peu à peu, on a développé la conscience de prendre l’espace. Mais ce n’est pas assez, la question du corps doit être plus présente dans les débats… On est mieux accepté qu’avant, on a plus confiance qu’avant, mais celui qui aime la danse en public ne le montre pas assez.

Le festival existe depuis 2005, quelles sont les grandes étapes de son évolution?
Au début, je voulais réunir tous ces Marocain·es qui se rencontrent dans les aéroports, à différents endroits du monde et faire un bilan, découvrir ce que chacun fait, voir si on les même préoccupations… Après ce bilan, il y a eu Montpellier Danse qui a accueilli deux pièces. En 2006 à Montpellier Danse, il y avait déjà deux compagnies marocaines et ça, ça a déclenché quelque chose. À partir de là, on a réfléchi à ce que pouvait faire le festival pour la danse, par rapport au contexte dans lequel on était. Il y avait la responsabilité de créer une vie pour la danse contemporaine, de donner une place aux jeunes danseur·euses et chorégraphes. Maintenant avec le programme 2023-2026, je sens une maturité du festival, mais pas du côté économique ni administratif. On manque encore d’administrateur·ices compétent·es sur les pratiques de levées de fonds, etc.
Quelles sont les principales urgences aujourd’hui?
Les urgences, c’est «Taklif», c’est cette génération qui se sent perdue. Alors, on partage nos réseaux, on leur donne des espaces de résidence. Donner l’élan, l’espoir et l’accompagnement.
Une autre urgence, c’est le débat public sur la présence du corps dans l’espace public. Où sont les intellectuel·les depuis 20 ans? Enfin, c’est la question d’élargir la base, de toucher plus de public, on est trop entre nous. Avec le projet de Caravanes des Corps («Kafilat Al Ajssad»), on va en caravane pour danser, donner des masterclass, initier des publics, faire des performances in situ dans l’espace privé, répondre au besoin des danseur·euses locaux, les mettre en réseau, dans des endroits reculés. Cette caravane doit se refaire, il faut faire des actions en dehors du festival, tout au long de l’année.
Toujours dans le texte de présentation du spectacle Äataba, vous posiez la question de ce que serait la danse contemporaine marocaine. Comment répondez-vous à cette question aujourd’hui?
Je ne dis pas danse contemporaine marocaine mais danse contemporaine qui vient du Maroc, parce que la danse est plus large que ça, plus universelle. C’est ça que j’adore dans la danse, c’est cette ouverture dans l’interprétation et la lecture. Si on la cloisonne à une géographie ou une histoire, ça devient du folklore, ça devient quelque chose de figé qui n’évolue pas. Le Maroc lui-même est un carrefour de cultures, de rencontres et de civilisations: il y a le sud de l’Europe, le nord de l’Afrique, les Arabes, les Amazighs… Aujourd’hui, quand je crée, je le fais peut-être à partir du Maroc mais je suis un grand voyageur, je suis intéressé par ce qui se passe au Japon, par la vieille génération américaine, par Germaine Acogny au Sénégal, etc.
Pour davantage d’information sur les spectacles et les formations, visiter le site Internet de Taoufiq Izeddiou.
Lire également notre article sur le festival «On Marche».
Dans la même série

Créer ensemble dans la ville
Au large24 avril 2023 | Lecture 0 min.
épisode 6/6

Nedjma Hadj Benchelabi: programmatrice-dramaturge
Au large28 mars 2023 | Lecture 1 min.
épisode 5/6
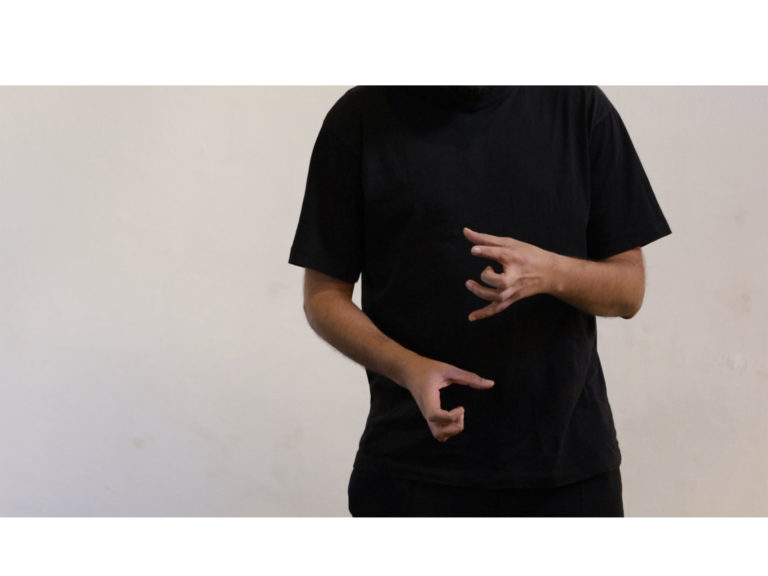
Abdel Mounim Elallami, un premier solo, un premier prix!
Au large27 mars 2023 | Lecture 0 min.
épisode 3/6

De la création à la pédagogie, un engagement continu
Au large24 mars 2023 | Lecture 1 min.
épisode 2/6
Vous aimerez aussi

Que nos enfants soient des géants
Au large7 novembre 2022 | Lecture 1 min.

Donner sa place au public
Au large12 octobre 2022 | Lecture 2 min.

Carte noire nommée désir
Émois20 février 2023 | Lecture 4 min.
épisode 7/15

Trouble #13: Invocations et évocations
Grand Angle12 juin 2025 | Lecture 6 min.

KFDA, 30 ans
Grand Angle25 mai 2025 | Lecture 2 min.

Louise Vanneste, de la boîte noire au plein jour
Au large14 avril 2025 | Lecture 7 min.

Musique Femmes Festival
En ce moment9 octobre 2024 | Lecture 2 min.

La Pointe On The Rocks!
Grand Angle6 octobre 2024 | Lecture 2 min.
épisode 1/3

État du monde
En ce moment23 septembre 2024 | Lecture 2 min.

Les Rencontres Inattendues
En ce moment1 août 2024 | Lecture 2 min.

Juana Ficción, chronique d’une disparition
Émois20 juillet 2024 | Lecture 4 min.

Discofoot, Roller Derviches et leçons tout public
Au large9 juillet 2024 | Lecture 4 min.

[PODCAST] Louise Baduel dans les paradoxes de l'écologisme
En chantier6 juin 2024 | Lecture 2 min.
épisode 10/10

Théâtre au Vert
En ce moment31 mai 2024 | Lecture 2 min.

Idio Chichava au KFDA: découverte majeure
Émois19 mai 2024 | Lecture 5 min.

[PODCAST] 13 ans de création aux Brigittines racontés dans un livre
En chantier3 mai 2024 | Lecture 1 min.
épisode 9/10

Second souffle
En chantier18 avril 2024 | Lecture 1 min.

Love Lies Bleeding
Émois15 avril 2024 | Lecture 4 min.

La semaine du son
En ce moment21 janvier 2024 | Lecture 2 min.

cinemamed
En ce moment29 novembre 2023 | Lecture 1 min.

[PODCAST] Karine Ponties au confluent du réalisme et de l'abstraction
En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.
épisode 6/10

[PODCAST] Le pouvoir des ondes sonores avec Marielle Morales
En chantier8 novembre 2023 | Lecture 1 min.
épisode 5/10

Théâtre au Vert: diversité, simplicité, sincérité
En ce moment19 août 2023 | Lecture 1 min.

Réhabilitons Welfare, le spectacle mal-aimé d’Avignon 2023
Émois3 août 2023 | Lecture 11 min.

Violence symbolique et agressions réelles
Émois28 juillet 2023 | Lecture 6 min.

À Avignon, Julien Gosselin nous a percutés
Émois23 juillet 2023 | Lecture 8 min.

Drame familial sur fond d'imaginaire décolonisé
Grand Angle17 juillet 2023 | Lecture 1 min.

Avignon, le festival, et moi
En ce moment4 juillet 2023 | Lecture 1 min.

Le KFDA commence fort avec Angela, a strange loop
Émois13 mai 2023 | Lecture 4 min.

Créer ensemble dans la ville
Au large24 avril 2023 | Lecture 0 min.
épisode 6/6

Nedjma Hadj Benchelabi: programmatrice-dramaturge
Au large28 mars 2023 | Lecture 1 min.
épisode 5/6
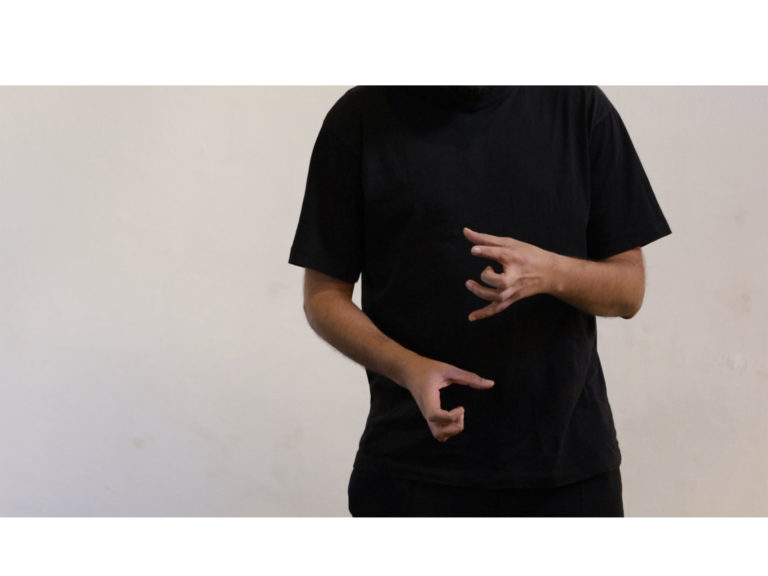
Abdel Mounim Elallami, un premier solo, un premier prix!
Au large27 mars 2023 | Lecture 0 min.
épisode 3/6

[VIDÉO] Entre l'audible et l'invisible avec Marielle Morales
En chantier15 mars 2023 | Lecture 1 min.

La puissance des langues vernaculaires
Au large15 novembre 2022 | Lecture 2 min.

[VIDÉO] Au fin fond des temps avec la compagnie Mossoux-Bonté
En chantier18 octobre 2022 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] En immersion avec Tumbleweed aux Brigittines
En chantier1 octobre 2022 | Lecture 1 min.

Au festival Nourrir Bruxelles
18 septembre 2022 | Lecture 1 min.

Megalomaniac. Vive l’enfer...
En ce moment3 septembre 2022 | Lecture 2 min.

Juwaa
14 mars 2022 | Lecture 1 min.

Diriger un festival: à deux, c’est mieux
Grand Angle31 janvier 2022 | Lecture 7 min.