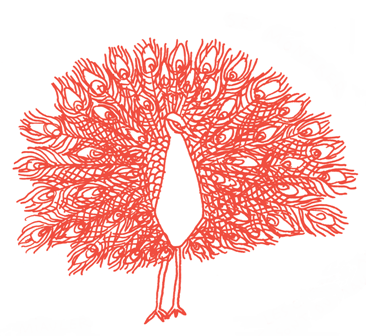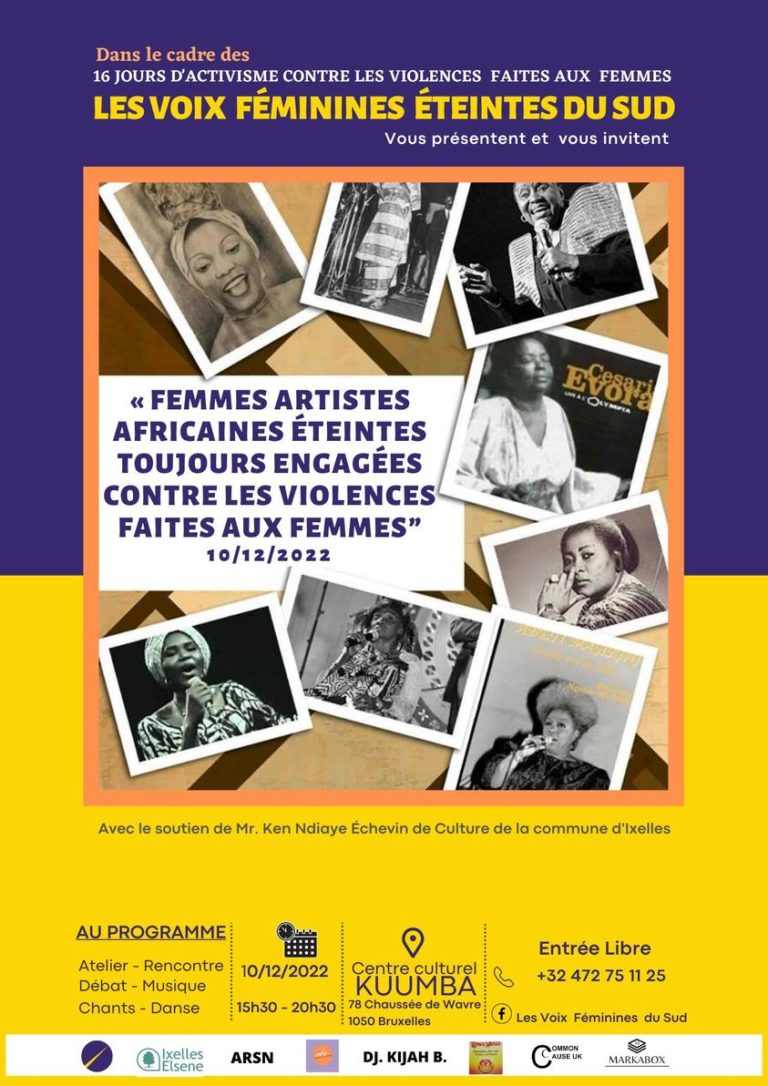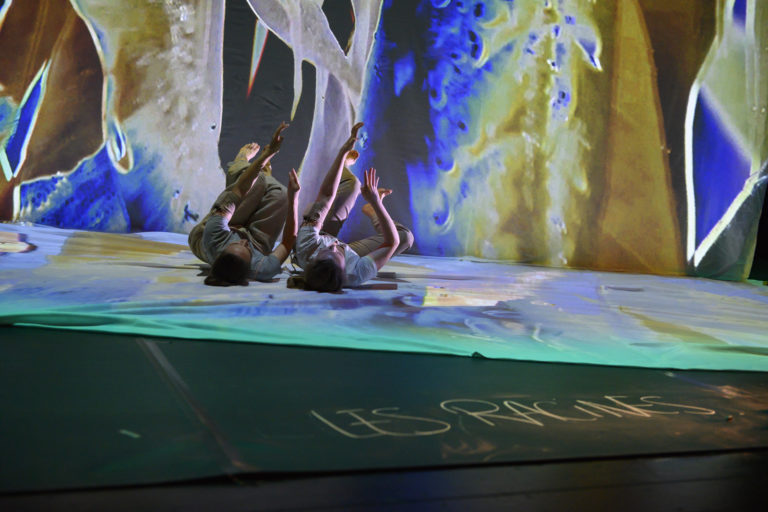Déplacer l’espace du théâtre dans les cours familiales
Au large24 octobre 2022 | Lecture 1 min.
Karolina SvobodovaEn 2010, le Festival se déroule pour la première fois au sein d’un seul quartier, les spectacles sont créés et joués dans les cours des familles du quartier.
Comment avez-vous réussi à convaincre ces dernières d’accueillir artistes et spectateur·ices chez eux?
Étienne MinoungouIl fallait faire un autre travail supplémentaire qui n’est pas seulement le travail de poète: un travail de rencontre avec les familles, des discussions. Faire comprendre aux gens finalement ce que signifie le métier.
Et c’était un peu compliqué parce que nous qui faisons ce métier, nous ne nous rendons pas compte que la perception du public sur celui-ci est loin de ce qu’on imagine. On nous tolère, on nous regarde mais rien de plus. Pour eux, c’est de l’amusement, ce n’est pas un métier. Alors j’ai voulu qu’on discute dans nos langues. Quel exercice difficile! Parce qu’à partir du moment où la langue n’a pas inventé le métier, il n’y a pas les mots. La traduction ne sera pas une traduction littérale. La traduction impose que vous puissiez aller le plus loin possible avec les mots disponibles pour finalement désigner ce que vous faites. C’est dans ce travail du langage qu’on a [avec Patrick Janvier, scénographe général du festival] trouvé l’idée.
Quelle était cette idée?
Le théâtre, qu’est-ce que c’est? Le théâtre, c’est un espace de la discussion sociale; le théâtre, c’est le miroir de la société, la société qui se regarde elle-même. Dans nos langues ça pourrait se traduire de quelle façon? On est passé par plusieurs voies jusqu’à ce que, clac! Je trouve: «théâtre ya waa tid sonss yalg buudu.» Le théâtre c’est: «viens et par une conversation, élargissons la parenté, la famille». Buudu ça veut dire famille, peuple, lignée. Là ça devient intéressant: si le théâtre est un lieu de discussion de ce buudu , alors les questions de ce buudu ne se discutent pas dehors. Il faut un espace reconnu par les membres de la famille, dont on peut dire: «c’est notre espace».
Donc la cour intérieure, le lieu de vie partagé.
Oui. Tout se passe là, sous les manguiers: la vie quotidienne, les réunions de famille, un heureux ou un malheureux événement, une crise. Et la crise se discute dans la cour familiale, tout le monde est présent, y compris les enfants.
Si le théâtre doit rendre compte de cette discussion de la communauté avec elle-même, il ne peut pas se passer dans des lieux fermés à cette dernière, il doit se passer dans un lieu ouvert à cette communauté qui l’accepte, qui l’héberge et qui, finalement, commence à apprendre les codes de cette relation sociale.

Qu’en était-il du travail des artistes dans ce cadre?
Ce déplacement donnait aussi les possibilités pour que les artistes, les poètes, se sentent reconnu·es. On leur a dit que ce sont eux qui donnent l’impulsion de la discussion. Donc s’ils écrivent, ils proposent des éléments de discussion au public. Dans ces conditions, on écrit en écoutant la respiration de la société puisqu’on se trouve en son cœur. Les résidences de création prenaient alors une autre forme: l’auteur logeait dans une famille, vivait dans le quartier. Il avait son petit carnet, proposait des choses, de temps en temps on faisait des petites lectures et on l’écoutait, on discutait et comme ça, il avait de la nourriture pour repartir.
Pour que les metteurs en scène puissent mettre en musique cette discussion, il fallait qu’ils regardent la configuration de l’espace et que leur dramaturgie prenne en compte tout cela. Évidemment ces dramaturgies avaient une implication logistique extrêmement importante.

Les habitant·es du quartier ont participé à la mise en place du festival, en apportant notamment un appui logistique.
On a eu parfois à rénover des canalisations pour faire les évacuations d’eau, on a dû aussi vider des fosses septiques dans telle ou telle cour pour mieux l’aménager, et ce sont les jeunes du quartier qui l’ont fait, parce qu’ils savent le faire. Les ferronniers ont également été sollicité pour la fabrication des décors, les boutiques de tailleurs pour la confection des costumes. Et c’est comme ça qu’à un moment donné, les femmes pouvaient dire «Nous on s’organise et on nettoie la rue, on l’arrose pour que la poussière disparaisse, pour les différentes installations», ou «Nous, on va nourrir les gens qui viennent, moi je n’ai pas de maquis mais je vais vendre des brochettes devant ma porte… »
L’espace de la discussion sociale s’agrandissait en s’épaississant sur plusieurs aspects: l’aspect économique et la fierté d’être reconnu. Les habitant·es pouvaient dire: «Le théâtre, c’est chez Monsieur et Madame un·e tel·le et c’est la famille qui reçoit». Le fait aussi de dire: «C’est dans notre quartier, c’est chez nous, c’est notre affaire». Cette reconnaissance du buudu par rapport à sa propre coproduction dans une entreprise poétique peut, selon moi, amener le renouvellement de la pratique et de la perception théâtrales.

Les Récréâtrales, le festival des arts de la scène du Burkina Faso, a lieu du 29 octobre au 5 novembre. La programmation est en ligne ici.
Vous aimerez aussi

De la musique à la danse de luttes
En ce moment21 avril 2022 | Lecture 1 min.

D'ici et d'ailleurs
En ce moment14 avril 2022 | Lecture 1 min.

«Jouez, jouez, jouez!»
Au large30 janvier 2022 | Lecture 10 min.

Voir la mer et survivre
Émois8 juillet 2025 | Lecture 4 min.

Dalloway ouvre le Nifff!
En ce moment6 juillet 2025 | Lecture 3 min.

Toute une ville captivée
Au large5 juillet 2025 | Lecture 1 min.

Prix Maeterlinck: le retour
En ce moment27 juin 2025 | Lecture 4 min.

Trouble #13: Invocations et évocations
Grand Angle12 juin 2025 | Lecture 6 min.
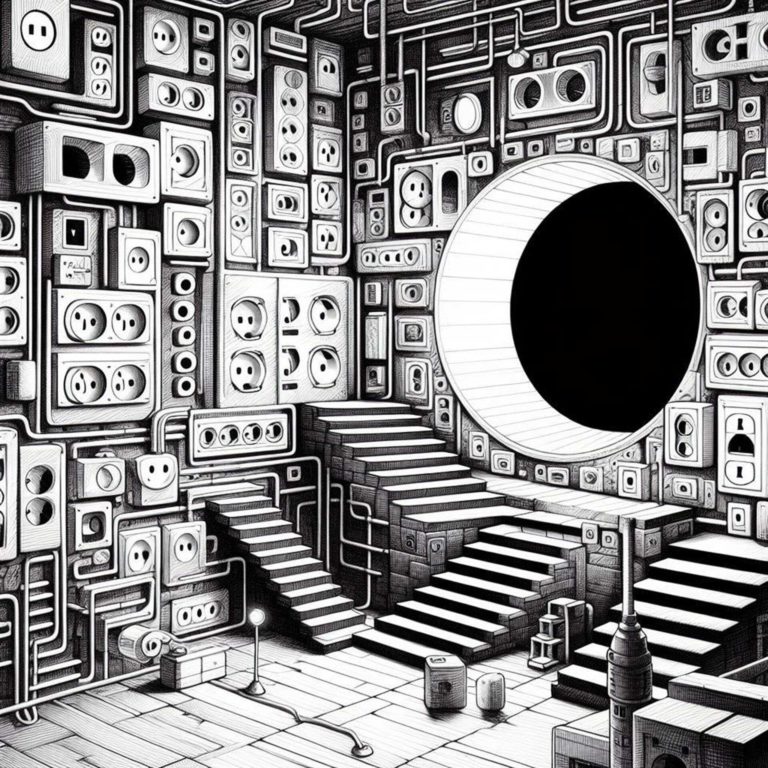
Simon Thomas & David Berliner
Grand Angle2 juin 2025 | Lecture 2 min.
épisode 5/5

Concret-abstrait, et vice-versa
Émois30 mai 2025 | Lecture 5 min.

KFDA, 30 ans
Grand Angle25 mai 2025 | Lecture 2 min.

De l’exil et de la censure
Grand Angle24 mai 2025 | Lecture 2 min.

La pratique de plumassière
En chantier21 avril 2025 | Lecture 2 min.

Louise Vanneste, de la boîte noire au plein jour
Au large14 avril 2025 | Lecture 7 min.

Puissances seules
En ce moment11 mars 2025 | Lecture 2 min.

RAGE
En ce moment7 mars 2025 | Lecture 2 min.

Salutations Mistinguettes
En ce moment7 mars 2025 | Lecture 2 min.

Véronique Clette-Gakuba et Zora Snake
Grand Angle5 mars 2025 | Lecture 2 min.
épisode 4/5

Laurence Rosier et Emilienne Flagothier
Grand Angle12 février 2025 | Lecture 2 min.
épisode 3/5

Décloisonner l’opéra
En chantier6 février 2025 | Lecture 1 min.

«Quelque chose de paisible, de tranquille et de beau»
En ce moment30 janvier 2025 | Lecture 1 min.
épisode 2/6

Pierre Lannoy et Claude Schmitz
Grand Angle26 janvier 2025 | Lecture 2 min.
épisode 2/5

Poèmes et Tango
En chantier2 janvier 2025 | Lecture 3 min.
épisode 1/3

Les châteaux de mes tantes
En ce moment2 décembre 2024 | Lecture 2 min.

État du monde
En ce moment23 septembre 2024 | Lecture 2 min.

Brûler, autour de Lucy
En chantier12 septembre 2024 | Lecture 12 min.

Au Brass
En ce moment8 septembre 2024 | Lecture 3 min.

Art et migration
Grand Angle2 septembre 2024 | Lecture 2 min.

Extimité.s par Zéphyr
Émois20 août 2024 | Lecture 3 min.
épisode 3/4

Et si Hansel avait consenti à être cuit vivant
Émois11 août 2024 | Lecture 5 min.
épisode 2/4

Sandrine Bergot, cap sur les Doms
Grand Angle25 juillet 2024 | Lecture 2 min.

Les hauts et les bas d’un théâtre de crise climatique à Avignon
Grand Angle22 juillet 2024 | Lecture 9 min.

Juana Ficción, chronique d’une disparition
Émois20 juillet 2024 | Lecture 4 min.

La petite fille sans nom
Au large17 juillet 2024 | Lecture 2 min.

[PODCAST] Louise Baduel dans les paradoxes de l'écologisme
En chantier6 juin 2024 | Lecture 2 min.
épisode 10/10

Quelle place pour la culture dans les partis?
Grand Angle1 juin 2024 | Lecture 12 min.

Le festival TB²
En ce moment31 mai 2024 | Lecture 3 min.

Théâtre au Vert
En ce moment31 mai 2024 | Lecture 2 min.

Nacera Belaza
En chantier28 mai 2024 | Lecture 2 min.

Idio Chichava au KFDA: découverte majeure
Émois19 mai 2024 | Lecture 5 min.

[PODCAST] KFDA 2024 L'art public selon Anna Rispoli
En chantier18 mai 2024 | Lecture 2 min.
épisode 2/2

[PODCAST] 13 ans de création aux Brigittines racontés dans un livre
En chantier3 mai 2024 | Lecture 1 min.
épisode 9/10

Louise Baduel et Michèle Noiret
En ce moment23 avril 2024 | Lecture 2 min.

Second souffle
En chantier18 avril 2024 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] COLLEUSES FÉMINISTES ET COLÈRE DANS L’ESPACE PUBLIC AU THÉÂTRE VARIA
En chantier11 avril 2024 | Lecture 1 min.

Ma déficience visuelle ne devrait pas être un frein
Émois10 avril 2024 | Lecture 1 min.
épisode 1/1

Tu l'as trouvé où, ce spectacle?
En ce moment19 février 2024 | Lecture 2 min.

Mutualiser… une (nouvelle) politique culturelle?
Grand Angle18 février 2024 | Lecture 4 min.

Janine Godinas
Grand Angle18 janvier 2024 | Lecture 1 min.

Cherche employé·e de bureau
Grand Angle19 décembre 2023 | Lecture 12 min.

Comment l'école broie les Kévin
Grand Angle13 décembre 2023 | Lecture 1 min.

«Plonger», ou l'éloge de la suspension
En ce moment12 décembre 2023 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] Théâtre et quartiers populaires avec Yousra Dahry
Grand Angle16 novembre 2023 | Lecture 2 min.

[PODCAST] Arco Renz et Danielle Allouma en spirales hypnotiques
En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.
épisode 8/10

[PODCAST] Chloé Beillevaire et Sabina Scarlat, bouffonnes en collants
En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.
épisode 7/10

[PODCAST] Karine Ponties au confluent du réalisme et de l'abstraction
En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.
épisode 6/10

[PODCAST] Le pouvoir des ondes sonores avec Marielle Morales
En chantier8 novembre 2023 | Lecture 1 min.
épisode 5/10

Sur la vieillesse au théâtre
Grand Angle30 octobre 2023 | Lecture 11 min.

Macbeth au Shakespeare’s Globe
Au large17 octobre 2023 | Lecture 3 min.

L’Amour c’est pour du beurre
En ce moment16 octobre 2023 | Lecture 2 min.

L'appel des champignons
Au large9 octobre 2023 | Lecture 3 min.

Prendre soin, par le théâtre aussi
En ce moment4 octobre 2023 | Lecture 1 min.

Danse Avec les Foules
En ce moment2 octobre 2023 | Lecture 1 min.

Hippocampe
En ce moment29 septembre 2023 | Lecture 2 min.

La sentinelle du sens
Grand Angle29 août 2023 | Lecture 1 min.
épisode 3/10

Le vrai calme se trouve dans la tempête
Au large21 août 2023 | Lecture 5 min.

Théâtre au Vert: diversité, simplicité, sincérité
En ce moment19 août 2023 | Lecture 1 min.

Réhabilitons Welfare, le spectacle mal-aimé d’Avignon 2023
Émois3 août 2023 | Lecture 11 min.

Violence symbolique et agressions réelles
Émois28 juillet 2023 | Lecture 6 min.

À Avignon, Julien Gosselin nous a percutés
Émois23 juillet 2023 | Lecture 8 min.

Drame familial sur fond d'imaginaire décolonisé
Grand Angle17 juillet 2023 | Lecture 1 min.

Place aux narrations féministes
En ce moment13 juillet 2023 | Lecture 12 min.

Avignon, le festival, et moi
En ce moment4 juillet 2023 | Lecture 1 min.

Cinq spectacles québécois en rafale au FTA et au Carrefour
Au large30 juin 2023 | Lecture 13 min.

Échappées urbaines
En ce moment12 juin 2023 | Lecture 2 min.

Depuis que tu n’as pas tiré
En ce moment24 mai 2023 | Lecture 2 min.

Malaise dans la civilisation
Émois19 mai 2023 | Lecture 3 min.

Garder l'enfance allumée
Grand Angle15 mai 2023 | Lecture 7 min.

Hormur: une plateforme pour créer dans des lieux insolites
En chantier15 mai 2023 | Lecture 1 min.

Un retour aux sources pour ne plus manquer de repères
Grand Angle15 mai 2023 | Lecture 5 min.

Le KFDA commence fort avec Angela, a strange loop
Émois13 mai 2023 | Lecture 4 min.

Serge Aimé Coulibaly, danser ici et ailleurs
Au large28 avril 2023 | Lecture 1 min.

Créer ensemble dans la ville
Au large24 avril 2023 | Lecture 0 min.
épisode 6/6

Des forêts et des sardines
Grand Angle21 avril 2023 | Lecture 7 min.

[VIDÉO] Boucles infinies avec Arco Renz et Danielle Allouma
En chantier18 avril 2023 | Lecture 1 min.

Le collectif suisse BPM déploie son irrésistible «Collection»
Émois17 avril 2023 | Lecture 5 min.

[VIDÉO] Chloé Beillevaire et Sabina Scarlat, étonnantes «folles du roi»
En chantier12 avril 2023 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] L'ART SUBTIL DE LA RELAX PERFORMANCE AVEC SIDE-SHOW
En chantier30 mars 2023 | Lecture 1 min.

Indiscipline à Knokke!
En ce moment29 mars 2023 | Lecture 2 min.
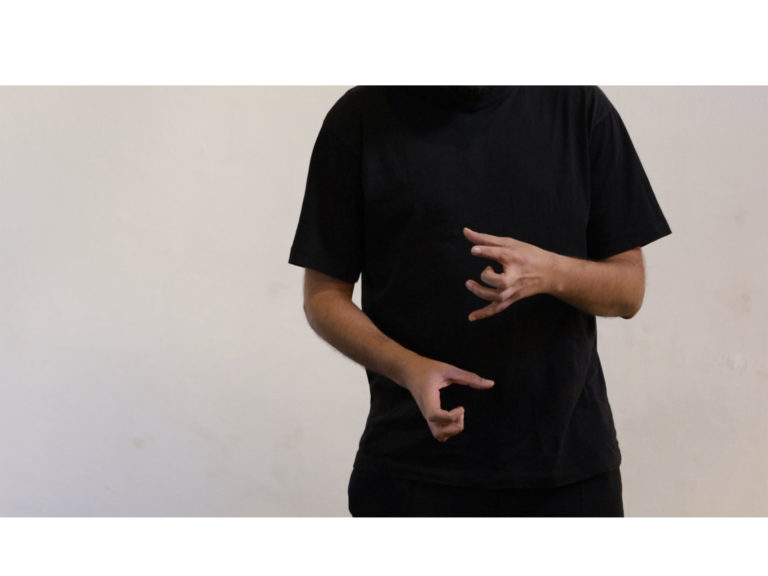
Abdel Mounim Elallami, un premier solo, un premier prix!
Au large27 mars 2023 | Lecture 0 min.
épisode 3/6

[VIDÉO] LE BANAL SUBLIMÉ AVEC KARINE PONTIES
En chantier20 mars 2023 | Lecture 2 min.

[VIDÉO] Entre l'audible et l'invisible avec Marielle Morales
En chantier15 mars 2023 | Lecture 1 min.

Ces paroles qui nous rassemblent
Grand Angle7 mars 2023 | Lecture 1 min.
épisode 2/10

Carte noire nommée désir
Émois20 février 2023 | Lecture 4 min.
épisode 7/15

Rabelais revient à la charge
Grand Angle18 février 2023 | Lecture 1 min.
épisode 1/10

Okraïna Records fête ses dix ans!
Grand Angle17 janvier 2023 | Lecture 1 min.

Tervuren
En chantier13 janvier 2023 | Lecture 4 min.

Philippe Grombeer et les Halles
En ce moment10 janvier 2023 | Lecture 4 min.

Morel, c’est quelqu’un!
Grand Angle10 janvier 2023 | Lecture 1 min.

Beoogneere, l’espoir de la Savane
Au large19 novembre 2022 | Lecture 4 min.

La très belle métamorphose d’une traduction des Métamorphoses
Grand Angle18 novembre 2022 | Lecture 1 min.

La puissance des langues vernaculaires
Au large15 novembre 2022 | Lecture 2 min.

Méduse.s par le collectif La Gang
Grand Angle11 novembre 2022 | Lecture 10 min.
épisode 2/3

Du théâtre malgré tout
Au large9 novembre 2022 | Lecture 2 min.

Que nos enfants soient des géants
Au large7 novembre 2022 | Lecture 1 min.

La puissance de Dionysos
Au large3 novembre 2022 | Lecture 5 min.

Créer pour faire advenir le female gaze
Grand Angle27 octobre 2022 | Lecture 6 min.
épisode 1/3

«Ça a commencé?»
Grand Angle19 octobre 2022 | Lecture 7 min.

Cinéaste et thérapeute corporelle
Grand Angle14 octobre 2022 | Lecture 1 min.
épisode 18/18

Donner sa place au public
Au large12 octobre 2022 | Lecture 2 min.

[VIDÉO] En immersion avec Tumbleweed aux Brigittines
En chantier1 octobre 2022 | Lecture 1 min.

Un nouveau prix au Burkina Faso!
Au large28 septembre 2022 | Lecture 4 min.

Au festival Nourrir Bruxelles
18 septembre 2022 | Lecture 1 min.

Trouver un lieu pour y faire du théâtre
Grand Angle17 septembre 2022 | Lecture 1 min.

Éducatrice et maquilleuse
Grand Angle8 septembre 2022 | Lecture 1 min.
épisode 17/18

Il est parti...
Émois31 août 2022 | Lecture 4 min.

Graphiste-illustratrice et plasticienne
Grand Angle14 août 2022 | Lecture 1 min.
épisode 16/18

Still Life fait régner le théâtre sans paroles à Avignon
Grand Angle23 juillet 2022 | Lecture 1 min.

Paradiso du Teatro delle Albe
Au large19 juillet 2022 | Lecture 4 min.

Koulounisation de Salim Djaferi
En ce moment16 juillet 2022 | Lecture 1 min.

Accompagner plutôt que programmer
Grand Angle3 juillet 2022 | Lecture 7 min.

24h dans la vie du théâtre des Doms
En ce moment3 juillet 2022 | Lecture 3 min.

Circassienne, le saut dans le vide
Grand Angle3 juillet 2022 | Lecture 4 min.
épisode 3/3

Comédien et guide à l’Africa Museum de Tervuren
Grand Angle1 juillet 2022 | Lecture 1 min.
épisode 15/18

Un festival au grand jour
Au large5 juin 2022 | Lecture 3 min.

Compositrice-interprète et responsable de revue
Grand Angle1 juin 2022 | Lecture 1 min.
épisode 14/18

Entrer et voir le bar
Grand Angle30 mai 2022 | Lecture 1 min.

«T’inquiète pas, je te rattrape»
Grand Angle30 mai 2022 | Lecture 4 min.
épisode 2/3

L'échec vu du public
En chantier28 mai 2022 | Lecture 3 min.
épisode 3/4

Démontage du chapiteau patriarcal
Grand Angle10 mai 2022 | Lecture 6 min.
épisode 1/3

Gestionnaire le matin et artiste l'après-midi
Grand Angle9 mai 2022 | Lecture 1 min.

Même pas mort le répertoire
En ce moment2 mai 2022 | Lecture 2 min.

La fascination du mal
En ce moment1 mai 2022 | Lecture 1 min.

Guyane, Liban, Iran, Japon...
En ce moment1 mai 2022 | Lecture 1 min.

Comédienne et maman
Grand Angle15 avril 2022 | Lecture 1 min.
épisode 2/6

Comédien et formateur en entreprise
Grand Angle25 mars 2022 | Lecture 1 min.
épisode 7/18

Archipel
En ce moment23 mars 2022 | Lecture 4 min.

Juwaa
14 mars 2022 | Lecture 1 min.

Les conditions extérieures à l’échec
En chantier1 mars 2022 | Lecture 4 min.
épisode 2/4

Échappatoire à la Saint Valentin
Émois14 février 2022 | Lecture 4 min.

Déboires assumés
En chantier31 janvier 2022 | Lecture 8 min.
épisode 1/4

Diriger un festival: à deux, c’est mieux
Grand Angle31 janvier 2022 | Lecture 7 min.

Acteur et plombier/chauffagiste
Grand Angle28 décembre 2021 | Lecture 1 min.
épisode 2/18

Diriger un théâtre: un geste politique
Grand Angle28 décembre 2021 | Lecture 2 min.

Un spectacle par ses costumes
En ce moment16 septembre 2021 | Lecture 5 min.

L'ouverture mythique de la Raffinerie du Plan K
Grand Angle10 juin 2021 | Lecture 3 min.