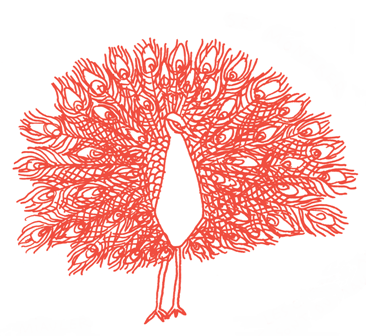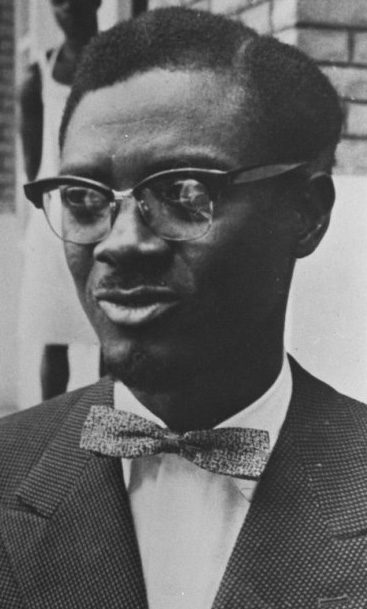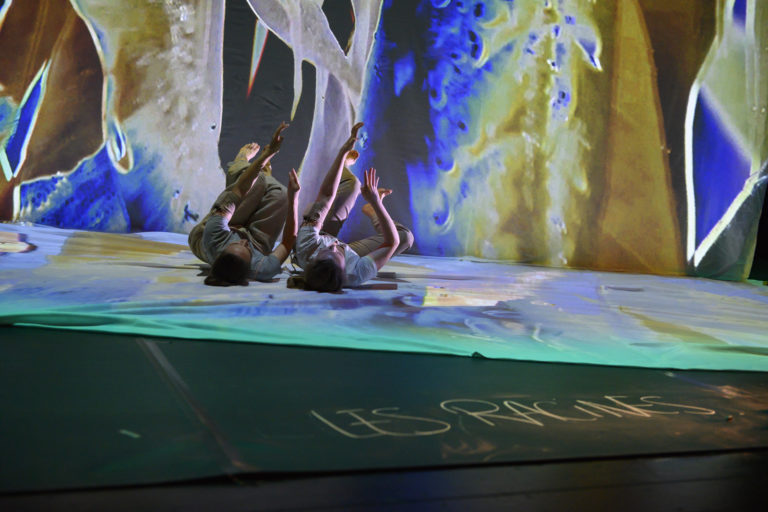Place aux narrations féministes
En ce moment13 juillet 2023 | Lecture 12 min.
Expériences festivalières
Un festival, c’est une condensation, dans un espace-temps restreint, d’activités et de participant·es autour d’une discipline partagée. C’est un espace-temps marqué par l’intensité, voire l’excès, dont la dynamique tranche avec celle de la vie quotidienne. On s’y presse, on l’attend avec impatience. Pour les professionnel·les et les amateur·ices, c’est un rendez-vous inratable. Peu de festivals ont cependant atteint le statut quasi mythique du festival d’Avignon, qui, à chaque édition, célèbre le théâtre autant qu’il se célèbre lui-même. Le spectacle Cour d’honneur de Jérôme Bel, performé dans ce lieu emblématique du festival en 2013, en est la preuve aussi touchante qu’éclatante.
Le festival Off, dont les origines remontent à 1966 avec les premiers spectacles d’André Benedetto accueillis au Théâtre des Carmes en parallèle de la programmation de Jean Vilar, est certes moins mythifié. C’est lui pourtant qui rassemble le plus grand nombre de spectacles, d’artistes et de spectateur·ices. Les artistes s’y précipitent pour essayer de renforcer leurs réseaux, attirer le plus grand nombre possible de ce public potentiel rassemblé dans la cité, se distinguer parmi les centaines de spectacles joués chaque heure dans les différents lieux, plus ou moins adaptés, de la ville.
Bref, le festival d’Avignon est aussi excitant qu’épuisant tandis que la «festivalisation» interroge le rapport de consommation de l’art. On le sait, on voit souvent trop, on n’a pas le temps de digérer les spectacles, de les laisser vivre en nous: en moins d’une heure les images et émotions d’une proposition sont déjà remplacées par l’univers dans lequel nous plonge la suivante.
On connaît ces critiques, elles se justifient en général. Mais quand, à l’inverse, les propositions se complètent les unes les autres, quand les mots et images d’une œuvre sont repris, renforcés, complétés par l’œuvre qui suit, quand, plutôt que d’écraser le sens, celui-ci est coconstruit par les différentes créations, c’est une tout autre expérience qui s’ouvre à nous. Bien évidemment, cette porosité est toujours à l’œuvre lors d’un festival et le hasard peut merveilleusement faire s’entrechoquer des narrations, créant en nous des idées et émotions aussi originales que déconcertantes. Mais ce dont je voudrais parler ici, c’est quand cette expérience est le résultat d’une programmation, autrement dit de choix réfléchis. En effet, si chaque programmateur·ice de saison théâtrale rêve peut-être que son public assiste à l’ensemble de sa sélection, ce rêve a davantage de chance de se réaliser dans le cadre de cet espace-temps à part qu’est le festival.
Se plonger dans la programmation du Théâtre des Doms
Le théâtre des Doms, c’est le Pôle Sud de la création de la Belgique francophone, sa vitrine dans la cité des papes. La structure, actuellement dirigée par Alain Cofino Gomez vise à promouvoir – en particulier pendant le festival – des artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’enjeu de diffusion y est donc essentiel. Si la structure accueille de nombreux·ses professionnel·les, elle a également été adoptée par les festivalier·ères. De fait, en raison de la qualité de sa programmation, le théâtre des Doms s’est, au fil des années, véritablement imposé dans le off.
Pour son édition précédente, le directeur du festival s’était livré lui-même à une mise en récit de sa programmation, mettant en connexion expérience des spectateur·ices et spectacles accueillis dans son lieu. Cette année encore, c’est à un parcours réfléchi qu’il nous invite: «Le Festival OFF aux Doms, sera en 2023, le festival des parcours flamboyants, uniques et hors du commun, profondément humains et beaux, qui racontent les combats perdus ou gagnés de femmes, et parfois d’hommes, aux prises avec le changement, l’évolution et l’alternative.»[1][1] lesdoms.eu
Il s’agit donc de répondre à cette invitation, et de s’interroger ce faisant sur les récits qui nous sont racontés, sur les épreuves qui nous sont confiées et sur la manière dont celles-ci sont surmontées. Il s’agit d’observer encore les formes choisies pour nous les transmettre et les modalités d’adresses mises en place. Bref, rassembler ces parcours de flamboyant·es et observer quelles expériences et sensibilités ils nous livrent ensemble aujourd’hui. (Précisons que le spectacle Angles morts de Joëlle Sambi, qui, par sa thématique et son traitement constitue certainement un jalon important de ce parcours n’est pas abordé ici, n’ayant malheureusement pas pu y assister.)
Quitter l’enclos
Quitter l’enclos, j’emprunte cette image au spectacle Voie Voix Vois de Gaël Santisteva, Saaber Bachir et Antoine Leroy, création interdisciplinaire investissant le matériau sonore pour, entre autres, questionner les discours et les rapports de pouvoir en jeu dans la prise de parole. Dans ce spectacle, il est aussi question de chevaux. Ceux que Saaber Bachir peint, celui qu’il a fait réaliser pour l’œuvre textile dont il s’enroule jusqu’à faire vivre, avec ses protagonistes, un cheval et son cavalier sur la scène du jardin des Doms où se déroule la représentation, et, enfin, les chevaux sauvages qui le passionnent. Ceux qui se sont enfuis après avoir été introduits en Amérique par les colons espagnols. Ces chevaux se sont reproduits entre eux et ont investi de nouveaux territoires. À ceux qui s’opposent à leur présence, les artistes rétorquent qu’il y a assez de place pour eux aussi, et soulignent que ces chevaux ont modifié en partie leur alimentation pour survivre dans les territoires plus arides où ils ont pu s’installer, qu’ils se sont adaptés à leur environnement, ce sont ainsi rapprochés de la nature et sont finalement devenus plus forts.

Quitter l’enclos, se transformer et devenir plus fort·e, est le thème qui traverse l’ensemble des créations accueillies aux Doms cette édition, chacune d’entre elles pouvant être lues comme un récit d’émancipation. Et si je puise cette image dans un spectacle créé et porté par trois hommes, j’observe ensuite que c’est dans le reste des propositions artistiques, créées par des femmes, qu’elle est actualisée.
Dans Dominique toute seule, création jeune public de Marie Burki avec, au plateau, Garance Durand-Cominos et Tom Geels, le départ est initialement contraint: Dominique a perdu son travail, et puis Dominique a perdu sa petite maison qui n’était finalement pas vraiment sa maison. Elle se retrouve dans la forêt, et l’herbe grasse à l’odeur de terre et de rosée devient soudainement appétissante. Elle s’endort au clair de lune, se réveille avec le soleil, marche tout le long de la journée. Jour après jour, elle s’adapte et se transforme au contact de cet environnement nouveau: celle qui avait l’impression de devenir invisible apprend grâce à un menhir que, dans la forêt, tout le monde voit tout le monde et qu’il ne faut pas nécessairement qu’il se passe beaucoup de choses pour faire une belle histoire. Au contact de la forêt, elle reprend consistance et retrouve sa voix. Car elle chante en marchant, de plus en plus fort, avec de plus en plus de joie. Dominique toute seule rencontre en la forêt une alliée et c’est en cheminant à travers elle qu’elle trouve un sens, celui d’être simplement là, et abandonne la quête d’une direction mortifère.

À travers Je crois que dehors c’est le printemps de Gaia Saitta et Giorgio Barberio Corsetti, Gaia Saitta souhaitait retracer le parcours d’Irina Lucidi: celui d’une histoire de couple, d’un drame, de la reconstruction de soi malgré la douleur, de la relation aux autres dans et pour la possibilité de cette reconstruction.
Celle dont la confiance en soi était jour après jour mise à mal par des injonctions laissées par un mari psychorigide sur des dizaines de post-it, celle que les policiers n’ont pas voulu écouter au moment du drame, celle dont le mal-être ne semblait même pas pris au sérieux par la psychologue du couple, est ici invitée sur scène en compagnie de ces différents personnages et des éternels post-it.
L’actrice interprète parfois le rôle d’Irina, ou parle en son propre nom, les personnages convoqués sont portés par des spectateur·ices placé·es sur le plateau et dans les gradins. Ensemble, actrice et public, reparcourent l’histoire, et font résonner ce qui n’a pas été entendu. Il s’agit aussi de raconter la reconstruction et une expérience de bonheur que, malgré la souffrance, Irina a pu retrouver. Sans toutefois pouvoir en témoigner, car ce bonheur semble incompréhensible, tant son désir de vie est jugé indécent et dérange. Avec un dispositif simple et efficace – deux caméras, deux écrans, quelques feuilles de papier et un bic – Gaia Saitta fait le récit de la colère, de l’enquête, de la solitude, des doutes mais aussi de la joie et de l’appel à la vie. Le spectacle trace également l’histoire d’une rencontre, celle de l’actrice avec le récit d’Irina et puis de l’actrice avec Irina elle-même.
À travers les modalités de cette rencontre et la manière dont Gaia Saitta transmet celle-ci sur scène s’affirment un engagement et un espoir. Ce n’est pas Irina la victime qui l’intéresse, mais Irina, la femme qui incarne le choix de la vie. La nécessité de porter ce récit à la scène est dans sa force émancipatoire: si Irina y est arrivée, c’est qu’il y a un espoir, et c’est dans le parcours de cette force de vie qui le sous-tend qu’elle propose aux spectateur·ices de l’accompagner, littéralement, sur le plateau.

Avec Y a brûler et cramer, forme courte présentée dans le Jardin des Doms, Camille Freychet, accompagnée sur la scène par la création sonore de Maïa Blondeau, nous embarque dans un récit qu’on pourrait dire initiatique. Il y est question de volcan, d’auto-stop, et puis du village au bout de la route, là où ce qui devait se découvrir se découvre, l’identité qui devait s’affirmer s’affirme.
Camille Freychet nous entraîne avec elle, sur la route et dans les voitures de ceux et celles qui acceptent de la conduire sur un bout de chemin, structurant son récit en campant les différents personnages qui la font, d’une façon ou d’une autre, avancer. Dans son histoire, c’est la mort du grand-père qui a provoqué son besoin de prendre la route; un poids en même temps qu’un sentiment de liberté la pousse à partir, sans savoir où.
Comme dans tous les récits initiatiques, c’est dans la découverte de soi-même que réside le but du parcours, et c’est en clamant fièrement son identité que Camille Freychet termine son voyage.

Beat’ume, également accueilli sur la scène du jardin, fait se rencontrer slam, rap et théâtre. Z&T, duo de jeunes slameuses bruxelloises, investit le plateau de théâtre pour faire entendre ses textes féministes et questionner dans le même mouvement leur présence dans cette institution. Ici, c’est leur zone de confort qu’elles quittent, celle des scènes de slam et de la communauté bienveillante dans laquelle elles se sont aujourd’hui fait une place. Ce pas de côté de la scène underground vers l’institution théâtrale leur permet de partager avec un autre public les discours et les actions militantes qu’elles mènent. Dans leurs textes, il est question d’amitié, de harcèlement, de la vie d’artiste, de la difficulté de la militance surtout quand il s’agit de l’appliquer dans la sphère privée. Elles performent leur (il)légitimité à être là, dans le monde de l’art, avec du slam, du rap, dans la rue, l’espace politique et privé, telles qu’elles sont, sans concession… et malgré la difficulté à tenir cette place.
Avec intelligence et beaucoup d’humour, Zouz et T.A manient les codes de ces mondes, en les mobilisant ou en les déconstruisant, pour affirmer haut et fort leur présence.

Dans Marche salope de et par Celine Chariot, il est notamment question des aigles et des huîtres. Des huîtres, ou plutôt des coquilles d’huîtres, qu’elle dispose précautionneusement le long d’un rectangle délimité au moyen de tape blanche sur le plateau. Et puis, consciencieusement, une à une, l’actrice les broie à l’aide d’un grand maillet. À côté de chaque coquille réduite en tas de poudre, elle dépose une plaque numérotée.
C’est une scène de crime qu’elle reconstitue pas à pas, la scène d’un viol. Tout au long de la représentation, ces traces d’autres victimes restent exposées à la vue du public, indiquant que le drame raconté n’est pas isolé. Sur scène, Celine Chariot ne parle pas, elle nous regarde, elle performe. Des voix off s’adressent à nous, ou dialoguent entre elles, éclairant sous différents angles les mécanismes de défense – telle l’amnésie – développés par le psychisme des victimes, mécanismes de défense temporaires mais aussi ignorés par la loi lorsque la durée de prescription est dépassée.
Le spectacle aborde le viol et les traumatismes qu’il engendre au moyen d’images, d’échanges fictionnels élaborés avec de la matière documentaire. S’il nous émeut et nous renseigne, il nous invite également à nous projeter et à imaginer un monde différent. Un monde dans lequel les huîtres ne seraient plus les victimes des aigles, emportées et lâchées du ciel, mais un monde où elles pourraient s’envoler elles aussi. Là où elles seraient libres et hors de danger, elles pourraient même se mettre à chanter. Le spectacle se termine sur cette image qui fait enfin rire les voix tandis que l’imaginaire de cette alternative se déploie sur le plateau.

Ces récits, racontés souvent à la première personne ou mêlant intelligemment narration en je et en elle/il, sont avant tout des témoignages, des adresses, à nous spectateur·ices rassemblé·es et, à travers nous, à la cité que nous représentons au théâtre. Des histoires insuffisamment racontées ou rapportées par d’autres, des réalités longtemps invisibilisés sur les scènes de théâtre et dans le monde social, deviennent ici les sujets réappropriés par ces différentes voix de femmes. Méduse.s,spectacle également présenté au théâtre des Doms par La Gang, aborde frontalement cette question historiographique, invitant à passer de l’History à Herstory…
Se saisissant de mythe de Méduse, La Gang invite à réfléchir en contrepoint au devenir des femmes qui, violentées, se rebellent et refusent le silence de la victime. Méduse est transformée en «monstre» après avoir été violée par Poséidon mais l’histoire transmet l’acte héroïque de Percée qui lui a coupé sa dangereuse tête couverte de serpents…

Chacune de ces pièces consiste en une prise de parole sensible pour non seulement raconter le viol, la violence, le harcèlement, le manque de reconnaissance et de considération ou encore le statut de subalterne voire d’incapable auquel sont souvent réduites les femmes mais aussi – et c’est là la force principale de ces créations – participe à construire un imaginaire et des récits d’émancipation. Dans ces récits et la manière dont ils sont portés en scène, les femmes ne sont pas uniquement des victimes: même si elles ont été violentées, elles sont les héroïnes, celles qui s’emparent de leur présent pour construire un autre devenir.
Dans ces différentes créations, on observe également que la nature devient souvent le refuge pour celles et ceux qui sont sorti·es de l’enclos, de la communauté des hommes, volontairement ou sous la contrainte. C’est dans l’éloignement et, conséquemment, par un rapprochement avec d’autres, que la reconstitution peut se faire et que d’autres modes d’existence s’ouvrent. Des modes de coexistence qui laissent de la place, qui accordent de l’attention, parce que les belles histoires ne reposent pas nécessairement sur de grandes actions et parce qu’il n’y a pas que les héros dont la bravoure est souvent liée à des actes de violence, qui ont droit de citer.
En abordant des thématiques difficiles, en se les appropriant pour recréer du sens à travers des mots, des chansons, des images, les différentes pièces évoquées brièvement ici participent à la mise en place d’un autre imaginaire et d’un nouveau répertoire.
Vous aimerez aussi

Carte noire nommée désir
Émois20 février 2023 | Lecture 4 min.
épisode 7/15

Méduse.s par le collectif La Gang
Grand Angle11 novembre 2022 | Lecture 10 min.
épisode 2/3

Avignon, le festival, et moi
En ce moment4 juillet 2023 | Lecture 1 min.

Koulounisation de Salim Djaferi
En ce moment16 juillet 2022 | Lecture 1 min.

Politique de la douceur
Grand Angle10 mars 2023 | Lecture 9 min.

Le KFDA commence fort avec Angela, a strange loop
Émois13 mai 2023 | Lecture 4 min.

«T’inquiète pas, je te rattrape»
Grand Angle30 mai 2022 | Lecture 4 min.
épisode 2/3

«Ça a commencé?»
Grand Angle19 octobre 2022 | Lecture 7 min.

Prix Maeterlinck: le retour
En ce moment27 juin 2025 | Lecture 4 min.

Trouble #13: Invocations et évocations
Grand Angle12 juin 2025 | Lecture 6 min.
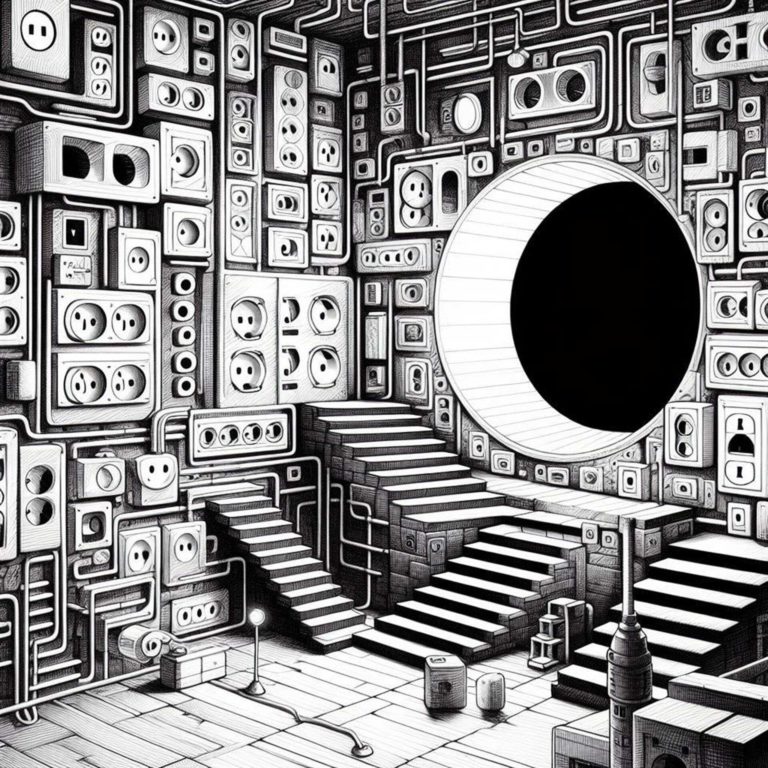
Simon Thomas & David Berliner
Grand Angle2 juin 2025 | Lecture 2 min.
épisode 5/5

Concret-abstrait, et vice-versa
Émois30 mai 2025 | Lecture 5 min.

KFDA, 30 ans
Grand Angle25 mai 2025 | Lecture 2 min.

La Maison Gertrude
En ce moment16 mai 2025 | Lecture 2 min.

Les désirs dans les mondes de l'art
En ce moment16 mai 2025 | Lecture 1 min.

Louise Vanneste, de la boîte noire au plein jour
Au large14 avril 2025 | Lecture 7 min.

Tac au tac
En ce moment15 mars 2025 | Lecture 2 min.

Puissances seules
En ce moment11 mars 2025 | Lecture 2 min.

RAGE
En ce moment7 mars 2025 | Lecture 2 min.

Salutations Mistinguettes
En ce moment7 mars 2025 | Lecture 2 min.

Laurence Rosier et Emilienne Flagothier
Grand Angle12 février 2025 | Lecture 2 min.
épisode 3/5

Décloisonner l’opéra
En chantier6 février 2025 | Lecture 1 min.

«Des Teufels Bad» de Veronika Franz et Severin Fiala
En ce moment30 janvier 2025 | Lecture 4 min.
épisode 3/6

«Quelque chose de paisible, de tranquille et de beau»
En ce moment30 janvier 2025 | Lecture 1 min.
épisode 2/6

Pierre Lannoy et Claude Schmitz
Grand Angle26 janvier 2025 | Lecture 2 min.
épisode 2/5

Les châteaux de mes tantes
En ce moment2 décembre 2024 | Lecture 2 min.

État du monde
En ce moment23 septembre 2024 | Lecture 2 min.

Brûler, autour de Lucy
En chantier12 septembre 2024 | Lecture 12 min.

Au Brass
En ce moment8 septembre 2024 | Lecture 3 min.

Art et migration
Grand Angle2 septembre 2024 | Lecture 2 min.

Extimité.s par Zéphyr
Émois20 août 2024 | Lecture 3 min.
épisode 3/4

Et si Hansel avait consenti à être cuit vivant
Émois11 août 2024 | Lecture 5 min.
épisode 2/4

Kifesh 2.0 par Kifesh
Émois11 août 2024 | Lecture 3 min.
épisode 1/4

Les Rencontres Inattendues
En ce moment1 août 2024 | Lecture 2 min.

Sandrine Bergot, cap sur les Doms
Grand Angle25 juillet 2024 | Lecture 2 min.

Les hauts et les bas d’un théâtre de crise climatique à Avignon
Grand Angle22 juillet 2024 | Lecture 9 min.

Juana Ficción, chronique d’une disparition
Émois20 juillet 2024 | Lecture 4 min.

La petite fille sans nom
Au large17 juillet 2024 | Lecture 2 min.

Discofoot, Roller Derviches et leçons tout public
Au large9 juillet 2024 | Lecture 4 min.

[PODCAST] Louise Baduel dans les paradoxes de l'écologisme
En chantier6 juin 2024 | Lecture 2 min.
épisode 10/10

Quelle place pour la culture dans les partis?
Grand Angle1 juin 2024 | Lecture 12 min.

Le festival TB²
En ce moment31 mai 2024 | Lecture 3 min.

Théâtre au Vert
En ce moment31 mai 2024 | Lecture 2 min.

Nacera Belaza
En chantier28 mai 2024 | Lecture 2 min.

Idio Chichava au KFDA: découverte majeure
Émois19 mai 2024 | Lecture 5 min.

[PODCAST] KFDA 2024 L'art public selon Anna Rispoli
En chantier18 mai 2024 | Lecture 2 min.
épisode 2/2

Orlando: ma biographie politique, et des lieux qu’on habite ensemble
Émois17 mai 2024 | Lecture 5 min.
épisode 4/5

[PODCAST] 13 ans de création aux Brigittines racontés dans un livre
En chantier3 mai 2024 | Lecture 1 min.
épisode 9/10

Louise Baduel et Michèle Noiret
En ce moment23 avril 2024 | Lecture 2 min.

Love Lies Bleeding
Émois15 avril 2024 | Lecture 4 min.

[VIDÉO] COLLEUSES FÉMINISTES ET COLÈRE DANS L’ESPACE PUBLIC AU THÉÂTRE VARIA
En chantier11 avril 2024 | Lecture 1 min.

Ma déficience visuelle ne devrait pas être un frein
Émois10 avril 2024 | Lecture 1 min.
épisode 1/1

Tu l'as trouvé où, ce spectacle?
En ce moment19 février 2024 | Lecture 2 min.

Mutualiser… une (nouvelle) politique culturelle?
Grand Angle18 février 2024 | Lecture 4 min.

Janine Godinas
Grand Angle18 janvier 2024 | Lecture 1 min.

Cherche employé·e de bureau
Grand Angle19 décembre 2023 | Lecture 12 min.

Comment l'école broie les Kévin
Grand Angle13 décembre 2023 | Lecture 1 min.

«Plonger», ou l'éloge de la suspension
En ce moment12 décembre 2023 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] Théâtre et quartiers populaires avec Yousra Dahry
Grand Angle16 novembre 2023 | Lecture 2 min.

[PODCAST] Arco Renz et Danielle Allouma en spirales hypnotiques
En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.
épisode 8/10

[PODCAST] Chloé Beillevaire et Sabina Scarlat, bouffonnes en collants
En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.
épisode 7/10

[PODCAST] Karine Ponties au confluent du réalisme et de l'abstraction
En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.
épisode 6/10

[PODCAST] Le pouvoir des ondes sonores avec Marielle Morales
En chantier8 novembre 2023 | Lecture 1 min.
épisode 5/10

Sur la vieillesse au théâtre
Grand Angle30 octobre 2023 | Lecture 11 min.

Macbeth au Shakespeare’s Globe
Au large17 octobre 2023 | Lecture 3 min.

L’Amour c’est pour du beurre
En ce moment16 octobre 2023 | Lecture 2 min.

Prendre soin, par le théâtre aussi
En ce moment4 octobre 2023 | Lecture 1 min.

Danse Avec les Foules
En ce moment2 octobre 2023 | Lecture 1 min.

Hippocampe
En ce moment29 septembre 2023 | Lecture 2 min.

La sentinelle du sens
Grand Angle29 août 2023 | Lecture 1 min.
épisode 3/10

Initier au matrimoine littéraire
En chantier25 août 2023 | Lecture 5 min.

Le vrai calme se trouve dans la tempête
Au large21 août 2023 | Lecture 5 min.

Théâtre au Vert: diversité, simplicité, sincérité
En ce moment19 août 2023 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] Lumière sur le vitrail dans l'atelier de François et Amélie
En chantier7 août 2023 | Lecture 1 min.
épisode 2/3

Réhabilitons Welfare, le spectacle mal-aimé d’Avignon 2023
Émois3 août 2023 | Lecture 11 min.

Violence symbolique et agressions réelles
Émois28 juillet 2023 | Lecture 6 min.

À Avignon, Julien Gosselin nous a percutés
Émois23 juillet 2023 | Lecture 8 min.

Drame familial sur fond d'imaginaire décolonisé
Grand Angle17 juillet 2023 | Lecture 1 min.

Cinq spectacles québécois en rafale au FTA et au Carrefour
Au large30 juin 2023 | Lecture 13 min.

Échappées urbaines
En ce moment12 juin 2023 | Lecture 2 min.

Depuis que tu n’as pas tiré
En ce moment24 mai 2023 | Lecture 2 min.

Malaise dans la civilisation
Émois19 mai 2023 | Lecture 3 min.

Garder l'enfance allumée
Grand Angle15 mai 2023 | Lecture 7 min.

Hormur: une plateforme pour créer dans des lieux insolites
En chantier15 mai 2023 | Lecture 1 min.

Serge Aimé Coulibaly, danser ici et ailleurs
Au large28 avril 2023 | Lecture 1 min.

Créer ensemble dans la ville
Au large24 avril 2023 | Lecture 0 min.
épisode 6/6

Des forêts et des sardines
Grand Angle21 avril 2023 | Lecture 7 min.

[VIDÉO] Boucles infinies avec Arco Renz et Danielle Allouma
En chantier18 avril 2023 | Lecture 1 min.

Le collectif suisse BPM déploie son irrésistible «Collection»
Émois17 avril 2023 | Lecture 5 min.

[VIDÉO] Chloé Beillevaire et Sabina Scarlat, étonnantes «folles du roi»
En chantier12 avril 2023 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] L'ART SUBTIL DE LA RELAX PERFORMANCE AVEC SIDE-SHOW
En chantier30 mars 2023 | Lecture 1 min.

Indiscipline à Knokke!
En ce moment29 mars 2023 | Lecture 2 min.

Nedjma Hadj Benchelabi: programmatrice-dramaturge
Au large28 mars 2023 | Lecture 1 min.
épisode 5/6

[VIDÉO] LE BANAL SUBLIMÉ AVEC KARINE PONTIES
En chantier20 mars 2023 | Lecture 2 min.

[VIDÉO] Entre l'audible et l'invisible avec Marielle Morales
En chantier15 mars 2023 | Lecture 1 min.

Ces paroles qui nous rassemblent
Grand Angle7 mars 2023 | Lecture 1 min.
épisode 2/10

Rabelais revient à la charge
Grand Angle18 février 2023 | Lecture 1 min.
épisode 1/10

Les dents de Lumumba
Grand Angle25 janvier 2023 | Lecture 2 min.
épisode 2/3

Tervuren
En chantier13 janvier 2023 | Lecture 4 min.

Philippe Grombeer et les Halles
En ce moment10 janvier 2023 | Lecture 4 min.

Morel, c’est quelqu’un!
Grand Angle10 janvier 2023 | Lecture 1 min.

Les murs ont la parole
Au large9 décembre 2022 | Lecture 10 min.

La très belle métamorphose d’une traduction des Métamorphoses
Grand Angle18 novembre 2022 | Lecture 1 min.

La puissance des langues vernaculaires
Au large15 novembre 2022 | Lecture 2 min.

Du théâtre malgré tout
Au large9 novembre 2022 | Lecture 2 min.

Que nos enfants soient des géants
Au large7 novembre 2022 | Lecture 1 min.

La puissance de Dionysos
Au large3 novembre 2022 | Lecture 5 min.

Créer pour faire advenir le female gaze
Grand Angle27 octobre 2022 | Lecture 6 min.
épisode 1/3

Déplacer l’espace du théâtre dans les cours familiales
Au large24 octobre 2022 | Lecture 1 min.

Cinéaste et thérapeute corporelle
Grand Angle14 octobre 2022 | Lecture 1 min.
épisode 18/18

Donner sa place au public
Au large12 octobre 2022 | Lecture 2 min.

[VIDÉO] En immersion avec Tumbleweed aux Brigittines
En chantier1 octobre 2022 | Lecture 1 min.

Scénographe et maman
Grand Angle30 septembre 2022 | Lecture 2 min.
épisode 3/6

Un nouveau prix au Burkina Faso!
Au large28 septembre 2022 | Lecture 4 min.

Au festival Nourrir Bruxelles
18 septembre 2022 | Lecture 1 min.

Trouver un lieu pour y faire du théâtre
Grand Angle17 septembre 2022 | Lecture 1 min.

Éducatrice et maquilleuse
Grand Angle8 septembre 2022 | Lecture 1 min.
épisode 17/18

Il est parti...
Émois31 août 2022 | Lecture 4 min.

Still Life fait régner le théâtre sans paroles à Avignon
Grand Angle23 juillet 2022 | Lecture 1 min.

Paradiso du Teatro delle Albe
Au large19 juillet 2022 | Lecture 4 min.

Accompagner plutôt que programmer
Grand Angle3 juillet 2022 | Lecture 7 min.

24h dans la vie du théâtre des Doms
En ce moment3 juillet 2022 | Lecture 3 min.

Circassienne, le saut dans le vide
Grand Angle3 juillet 2022 | Lecture 4 min.
épisode 3/3

Comédien et guide à l’Africa Museum de Tervuren
Grand Angle1 juillet 2022 | Lecture 1 min.
épisode 15/18

Un festival au grand jour
Au large5 juin 2022 | Lecture 3 min.

Entrer et voir le bar
Grand Angle30 mai 2022 | Lecture 1 min.

L'échec vu du public
En chantier28 mai 2022 | Lecture 3 min.
épisode 3/4

Bob Morane
Émois28 mai 2022 | Lecture 3 min.
épisode 3/15

«Désir ou amour, tu le sauras un jour.»
Émois18 mai 2022 | Lecture 1 min.
épisode 3/3

Rockeur et traducteur
Grand Angle13 mai 2022 | Lecture 1 min.
épisode 11/18

Démontage du chapiteau patriarcal
Grand Angle10 mai 2022 | Lecture 6 min.
épisode 1/3

Gestionnaire le matin et artiste l'après-midi
Grand Angle9 mai 2022 | Lecture 1 min.

Même pas mort le répertoire
En ce moment2 mai 2022 | Lecture 2 min.

La fascination du mal
En ce moment1 mai 2022 | Lecture 1 min.

Guyane, Liban, Iran, Japon...
En ce moment1 mai 2022 | Lecture 1 min.

De la musique à la danse de luttes
En ce moment21 avril 2022 | Lecture 1 min.

«Faut pas dire à qui je ressemble, faut dire qui je suis.»
Émois21 avril 2022 | Lecture 1 min.
épisode 2/3

Comédienne et maman
Grand Angle15 avril 2022 | Lecture 1 min.
épisode 2/6

Saxophoniste et importateur d'huile d'olive
Grand Angle11 avril 2022 | Lecture 2 min.
épisode 8/18

Comédien et formateur en entreprise
Grand Angle25 mars 2022 | Lecture 1 min.
épisode 7/18

Archipel
En ce moment23 mars 2022 | Lecture 4 min.

Les conditions extérieures à l’échec
En chantier1 mars 2022 | Lecture 4 min.
épisode 2/4
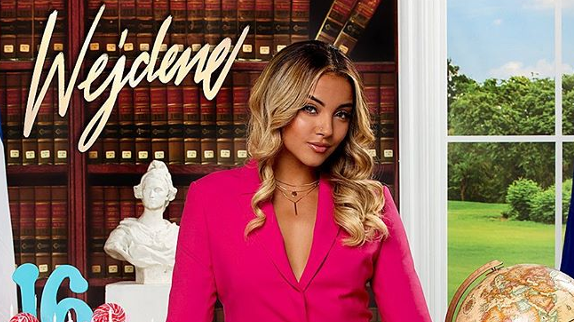
«L'amour c'est compliqué, les sentiments sont profonds.»
Émois14 février 2022 | Lecture 1 min.
épisode 1/3

Échappatoire à la Saint Valentin
Émois14 février 2022 | Lecture 4 min.

Déboires assumés
En chantier31 janvier 2022 | Lecture 8 min.
épisode 1/4

Diriger un festival: à deux, c’est mieux
Grand Angle31 janvier 2022 | Lecture 7 min.

Acteur et plombier/chauffagiste
Grand Angle28 décembre 2021 | Lecture 1 min.
épisode 2/18

Diriger un théâtre: un geste politique
Grand Angle28 décembre 2021 | Lecture 2 min.

Un spectacle par ses costumes
En ce moment16 septembre 2021 | Lecture 5 min.

L'ouverture mythique de la Raffinerie du Plan K
Grand Angle10 juin 2021 | Lecture 3 min.

Vieilles peaux
Émois12 mars 2021 | Lecture 5 min.