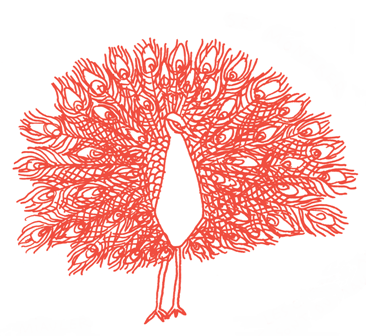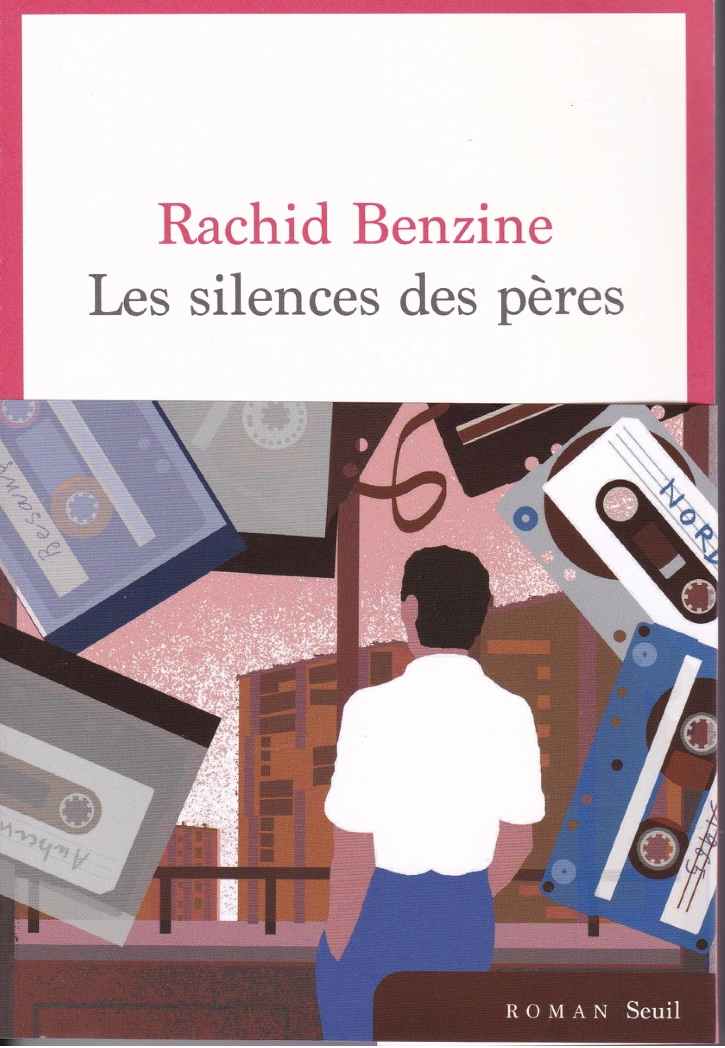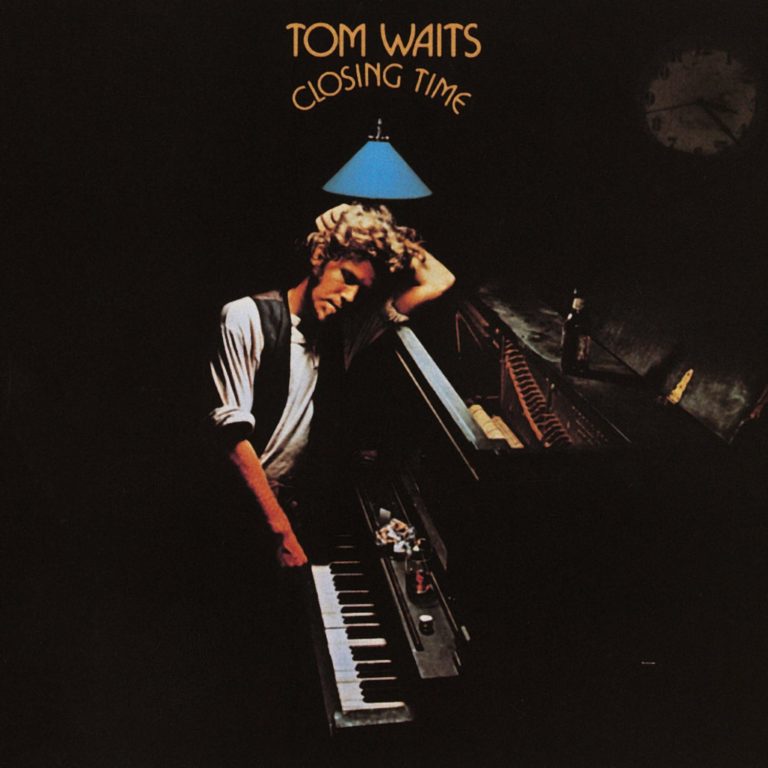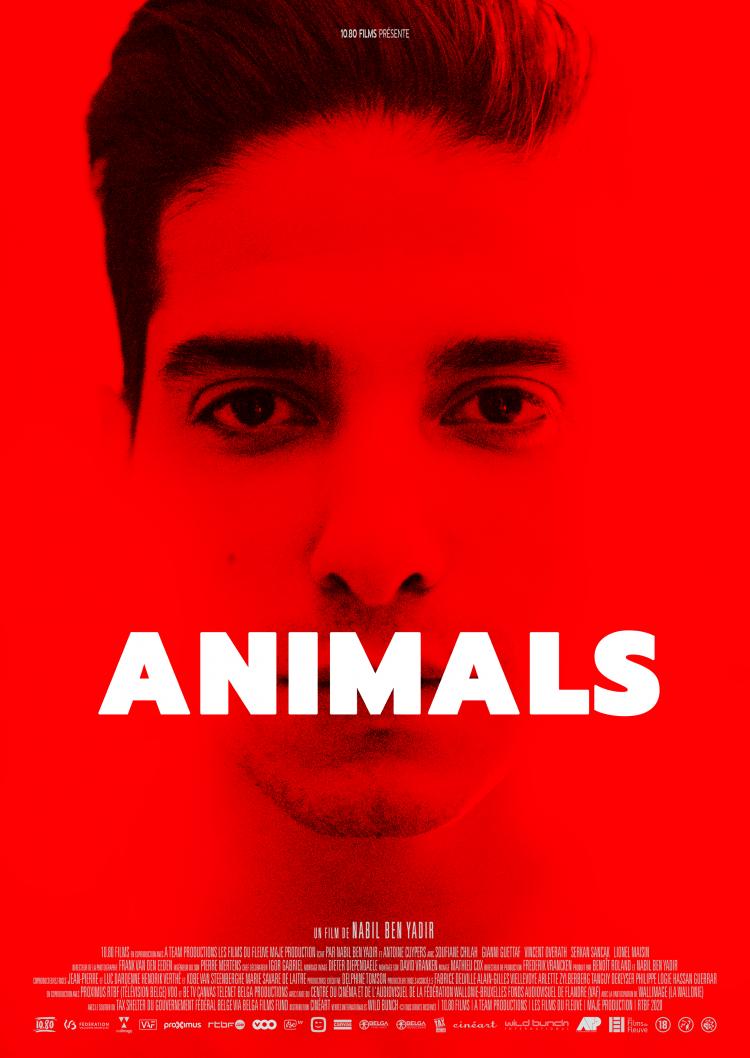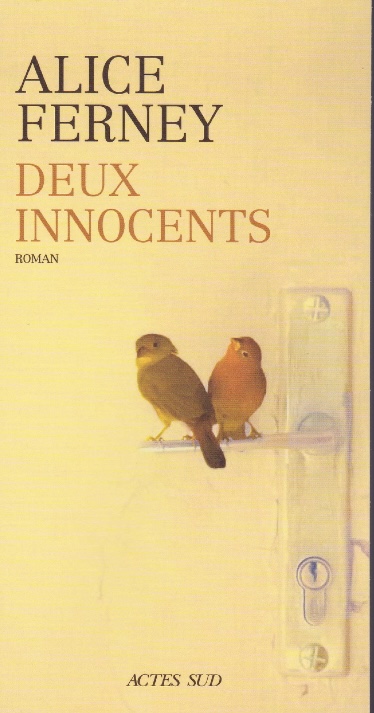007 à l’opéra
Émois4 janvier 2024 | Lecture 3 min.
épisode 3/6
Son nom est Bond, James Bond… En 2021, après cinq films, la saga d’action (où le meilleur côtoie le pire depuis 60 ans) faisait ses adieux à l’incarnation signée Daniel Craig de son «irrésistible» agent secret. Alors que les pronostics vont bon train quant au choix du prochain acteur à endosser le costume du héros qui sent bon les phéromones et le Vodka Martini, j’ai voulu sauver une pépite trouvant sa source dans l’un des pires défauts de Quantum of Solace, le moins apprécié des cinq épisodes avec Daniel Craig…

Du désordre à 230 000 dollars
Quantum of Solace est la suite directe de Casino Royal, dans lequel Bond tombe amoureux de Vesper Lynd (Eva Green), une énigmatique employée de la trésorerie du Royaume-Uni. Victime du chantage d’une puissante organisation criminelle qui détient prétendument en otage son petit ami, la jeune femme sauve, puis trahit l’agent secret avant de se sacrifier. Ce deuxième opus voit 007 simultanément enquêter sur les manigances politiques et économiques de la société secrète susmentionnée et tenter de découvrir les responsables de la mort de Vesper Lynd…
La première chose qui m’abasourdit systématiquement quand je regarde les deux films à la suite – ce que j’ai fait avant la rédaction de cet article –, c’est à quel point Quantum of Solace semble interminable par rapport à son prédécesseur, pourtant plus long de 40 minutes!
Plus que probablement troublé par la grève de la Writers Guild of America de 2007-2008, le scénario, parfois incompréhensible, souvent ridicule, est le premier de nombreux dominos ayant précipité à mes yeux la chute de cette production au budget rutilant (230 000$).
L’intrigue mêlant enquête, vengeances (au pluriel s’il vous plait!), troubles géopolitiques et corruption écologique ne se donne pas les moyens d’être aussi compliquée qu’elle le souhaite (je défie d’ailleurs quiconque de trouver un sens au «plan» des antagonistes). Les différents fils narratifs, au lieu de se rejoindre en une harmonieuse pelote, terminent en boule confuse trimbalée de droite à gauche par un chat névrosé. La caractérisation des personnages est risible. Bond est un homme. Donc, il cache ses sentiments. Donc, il est brutal parce qu’il veut se venger et donc il tue beaucoup de monde parce qu’il est triste et fâché et fâché d’être triste. Remplaçant son flegme des épisodes précédents, la M de Judi Dench semble étrangement irascible. Son attitude envers 007 manque de régularité, ses nombreux revirements ne semblant jamais justifiés. La longueur et la rapidité des dialogues donnent presque l’impression qu’on essaie de nous empêcher de suivre l’histoire et d’en relever les incohérences.
La réalisation de Marc Foster suit d’ailleurs cette tendance, donnant à chaque scène une fulgurance hystérique. La musique, incessante, soutient l’impression que tout est vital, tendu, dangereux, mais sa seule réussite consiste à vous donner la migraine. C’est comme si un inconnu hurlait en secouant un panda par les épaules sans jamais parvenir à susciter son intérêt parce qu’il pense à sa variété favorite de bambou. Enfin, que dire de l’acting si ce n’est que les performances sont majoritairement monolithiques? Seul Giancarlo Giannini (René Mathis) se distingue en gratifiant ses quelques minutes à l’écran d’une jolie sensibilité.
Dans le rôle du «méchant», Mathieu Amalric est tout bonnement affligeant : son anglais est honteux, son incarnation dépourvue de sincérité ou de menace, son jeu corporel au mieux rigide, au pire absent. Vocalement, il effectue une tentative bizarre de modulation vers les graves accompagnée d’un ton monocorde pour illustrer, peut-être, la froideur psychopathique de son personnage mais le résultat c’est qu’il semble être en réhabilitation logopédique après une rupture d’anévrisme.
Le montage, talon d’Achille rédempteur
Principal paramètre esthétique responsable de la précipitation décrite ci-dessus, le montage de Quantum of Solace est pour le moins clipesque. Dès la première poursuite en voiture, la brièveté des plans, leurs enchaînements épileptiques et leur approximation spatiale nous font comprendre que le reste des scènes d’action tronquera la lisibilité pour une dose survoltée d’adrénaline. Au lieu d’accompagner ce rythme effréné, une distance se crée de plus en plus entre nous et le barrage ininterrompu d’images jusqu’au bout de l’ennui.
Exception faite d’une séquence… Bond a suivi la trace de Dominic Greene dont il suspecte les activités philanthropiques de dissimuler un empire criminel. Il atterrit à l’opéra de Bregenz en Autriche où Greene et ses associé·es se rencontrent par oreillettes interposées pendant une représentation de Tosca. Ici, un montage alterné nous présente simultanément la représentation en cours, le public et les membres de la société secrète qui s’y dissimulent, 007 les espionnant puis les photographiant avant d’affronter les gardes du corps de Greene en coulisses et les bureaux du MI6 où Tanner reçoit les photos automatiquement identifiées par l’ordinateur.
En plus de sa clarté, la séquence profite de nombreuses résonnances thématiques avec l’opéra de Puccini et la mise en scène élaborée spécialement pour le film. Tosca parle de jalousie, de duplicité, de torture, de vengeance, d’une histoire d’amour au destin tragique, de la mort et son inévitabilité. Les deux passages musicaux couvrant la scène ont été judicieusement choisis: le «Te Deum» du sadique Scarpia, une prière détournée en plan machiavélique, et les mesures instrumentales qui suivent le meurtre de ce dernier par l’héroïne après une tentative de chantage sexuel. Deux partitions se superposent en contrepoint: celle des images et celle des notes, avec tantôt un fade out des coups de feu, tantôt un gros plan sonore sur la respiration haletante de la cantatrice. L’ensemble doit sa justesse au fait que la musique et la sélection de plans (dont la magnifique inclusion métatextuelle d’un œil gigantesque faisant office de décor) se renforcent mutuellement, sans jamais tomber dans le piège du synchronisme facile. L’opéra communique non seulement la rage mais aussi l’angoisse, la douleur, les regrets que l’agent secret refuse de verbaliser. Tosca, le personnage, s’impose comme le double lyrique de Camille Montes (Olga Kurylenko) qui cherche à punir le meurtre et le viol de sa mère et de sa sœur aux mains d’un général bolivien corrompu. C’est aussi le fantôme de Vesper qui hante 007. Nous avons même droit à une mise en abîme de toute la saga et de son protagoniste, condamné à un cycle infini de violence au détriment de ses émotions.
Nous entendons cette fêlure tout en observant ses conséquences: un James Bond qui, pour venir à bout de sa mission, risque le démantèlement de sa propre humanité. Je ne sais pas à quel point l’équipe artistique visait intentionnellement ces échos symboliques, mais le résultat est efficace et, lorsqu’on s’y attarde, étonnamment profond…
Dans la même série

007 à l’opéra
Émois4 janvier 2024 | Lecture 3 min.
épisode 3/6
Vous aimerez aussi

Dalloway ouvre le Nifff!
En ce moment6 juillet 2025 | Lecture 3 min.

Trouble #13: Invocations et évocations
Grand Angle12 juin 2025 | Lecture 6 min.

«Des Teufels Bad» de Veronika Franz et Severin Fiala
En ce moment30 janvier 2025 | Lecture 4 min.
épisode 3/6

La Callas du slam belge
En chantier12 janvier 2025 | Lecture 4 min.
épisode 2/3

Poèmes et Tango
En chantier2 janvier 2025 | Lecture 3 min.
épisode 1/3

Vingt Dieux
Émois2 janvier 2025 | Lecture 3 min.
épisode 13/16

L’histoire de Souleymane
Émois15 décembre 2024 | Lecture 3 min.
épisode 12/16

Le Pacha, ma mère et moi
Émois5 décembre 2024 | Lecture 3 min.
épisode 11/16

The Substance
Émois22 novembre 2024 | Lecture 3 min.
épisode 9/16

Don’t expect too much...
Émois3 novembre 2024 | Lecture 5 min.
épisode 7/16

Strange Darling
En ce moment22 septembre 2024 | Lecture 1 min.
épisode 6/16

Saravah
En ce moment21 août 2024 | Lecture 2 min.
épisode 5/16

Et si Hansel avait consenti à être cuit vivant
Émois11 août 2024 | Lecture 5 min.
épisode 2/4

Sandrine Bergot, cap sur les Doms
Grand Angle25 juillet 2024 | Lecture 2 min.

Emilia Perez
En ce moment15 juillet 2024 | Lecture 1 min.
épisode 4/16

La fille de son père
Émois3 juillet 2024 | Lecture 2 min.
épisode 2/4

Le successeur
Émois3 juillet 2024 | Lecture 3 min.
épisode 1/4

Spoorloos/The Vanishing
En ce moment1 juillet 2024 | Lecture 2 min.
épisode 3/16

Vice-Versa 2
En ce moment26 juin 2024 | Lecture 2 min.
épisode 2/16

Knit’s Island
En ce moment26 juin 2024 | Lecture 3 min.
épisode 1/16

Quelle place pour la culture dans les partis?
Grand Angle1 juin 2024 | Lecture 12 min.

Idio Chichava au KFDA: découverte majeure
Émois19 mai 2024 | Lecture 5 min.

Orlando: ma biographie politique, et des lieux qu’on habite ensemble
Émois17 mai 2024 | Lecture 5 min.
épisode 4/5

L’IA dans les séries télé: finis les discours alarmistes
Grand Angle10 mai 2024 | Lecture 8 min.

Laura Mulvey
En ce moment23 avril 2024 | Lecture 1 min.

Love Lies Bleeding
Émois15 avril 2024 | Lecture 4 min.

Poor Things
Émois16 janvier 2024 | Lecture 5 min.
épisode 13/15

Priscilla
En ce moment7 janvier 2024 | Lecture 6 min.

cinemamed
En ce moment29 novembre 2023 | Lecture 1 min.

À Avignon, Julien Gosselin nous a percutés
Émois23 juillet 2023 | Lecture 8 min.

Drame familial sur fond d'imaginaire décolonisé
Grand Angle17 juillet 2023 | Lecture 1 min.

Retour sur l'Auberge Cabaret Bethléem
Émois10 juillet 2023 | Lecture 4 min.
épisode 1/1

La condition pavillonnaire ou la terreur du quotidien
Émois1 juin 2023 | Lecture 4 min.
épisode 10/15

Un retour aux sources pour ne plus manquer de repères
Grand Angle15 mai 2023 | Lecture 5 min.

Le KFDA commence fort avec Angela, a strange loop
Émois13 mai 2023 | Lecture 4 min.

Le collectif suisse BPM déploie son irrésistible «Collection»
Émois17 avril 2023 | Lecture 5 min.

Carte noire nommée désir
Émois20 février 2023 | Lecture 4 min.
épisode 7/15

IL ÉTAIT UNE FOIS LES EFFETS SPÉCIAUX
Grand Angle23 décembre 2022 | Lecture 10 min.

Cinéaste et thérapeute corporelle
Grand Angle14 octobre 2022 | Lecture 1 min.
épisode 18/18

Il était une fois les effets spéciaux
Grand Angle20 septembre 2022 | Lecture 5 min.

VIRUS-32. Les Variations Zombiques.
En ce moment10 septembre 2022 | Lecture 2 min.

Megalomaniac. Vive l’enfer...
En ce moment3 septembre 2022 | Lecture 2 min.

Comédien et guide à l’Africa Museum de Tervuren
Grand Angle1 juillet 2022 | Lecture 1 min.
épisode 15/18

Marie Losier
18 avril 2022 | Lecture 1 min.

Les meilleurs sont les plus courts
18 avril 2022 | Lecture 1 min.

Juwaa
14 mars 2022 | Lecture 1 min.

«Jouez, jouez, jouez!»
Au large30 janvier 2022 | Lecture 10 min.

À l’ami à la vie !
Grand Angle25 janvier 2022 | Lecture 2 min.

Acteur et plombier/chauffagiste
Grand Angle28 décembre 2021 | Lecture 1 min.
épisode 2/18