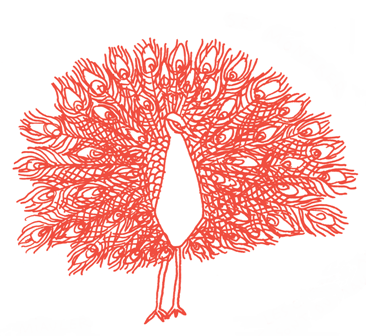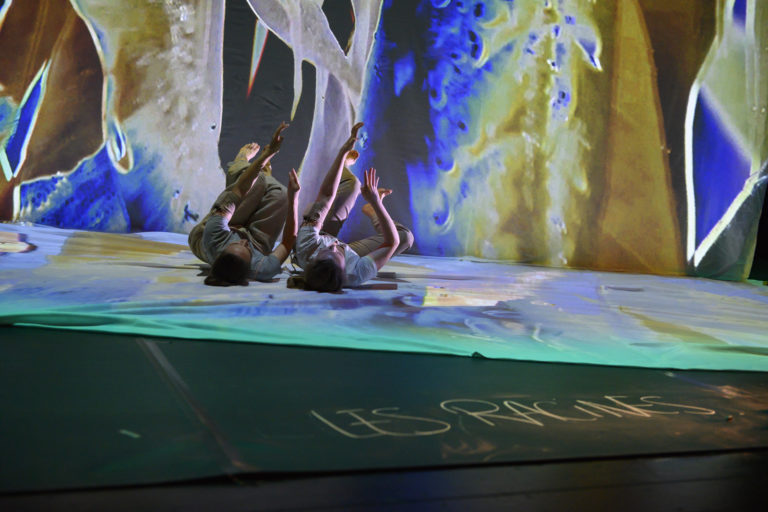Serge Aimé Coulibaly, danser ici et ailleurs
Au large28 avril 2023 | Lecture 1 min.
Karolina SvobodovaCette année, vous avez créé le spectacle d’ouverture du Fespaco et des Récréâtrales au Burkina Faso, dont vous êtes originaire. Depuis de nombreuses années, avec votre compagnie Faso Danse Théâtre, vous tournez partout dans le monde. Comment avez-vous découvert la danse au Burkina?
Serge Aimé CoulibalyLa première fois que j’ai dansé devant des gens, c’était à l’école primaire, pendant les spectacles de fin d’année… Ensuite, en secondaire, il y avait la troupe artistique du lycée, on faisait du théâtre. Avec un ami, Sana Seydou Khanzai, qui est musicien maintenant et qui est aussi à Bruxelles et Kanga Yolande qui venait de Côte d’Ivoire, on avait créé une petite troupe, on faisait des spectacles autour de Michael Jackson… On se prenait un peu pour des Américains, avec des jeans déchirés, des blousons en cuir etc. Et puis, il y a eu une bascule dans ma vie, lorsque j’ai découvert à la télévision la compagnie Feeren. Les comédiens parlaient du théâtre et de la danse comme d’un vrai métier. J’ai tout fait pour contacter Amadou Bourou, qui était le directeur de la compagnie. Il m’a dit: «Bon, on va voir». Je suis arrivé mais il n’était pas là! Il y avait les acteurs qui étaient sur la scène en train de répéter. Ils jouaient de la percussion et ça dansait. Ils faisaient plein de trucs et ils m’ont invité à les rejoindre. J’ai passé toute la journée avec eux. Le lendemain, Amadou Bourou était là, il me voit sur la scène, il ne dit rien. Et puis en fait, voilà, c’est comme ça que je suis arrivé là.
Des figures importantes du théâtre et de la danse contemporaine burkinabè telles qu’Odile Sankara et Alain Héma sont également passés par cette troupe. Quelles en sont les caractéristiques principales?
La compagnie Feeren, c’était du théâtre dans le sens africain du terme, c’est-à-dire que le comédien ou la comédienne doit savoir danser, chanter, raconter des histoires, comme les griots. J’ai fait 8 ans dans la compagnie. On avait des journées de 10h de travail: de 7h30 à 10h30, c’était le travail physique, la danse, tout ce qui était de l’initiation corporelle. On naviguait dans tout. Et puis de 10h30 à 12h30, chacun devait développer un projet pour développer l’activité culturelle et artistique au Burkina. À midi et demi, on finissait, on revenait à 15h30. Jusqu’à 17h30 c’était musique. Chaque membre de la compagnie devait savoir jouer 1, 2 ou 3 instruments et chanter. Et à partir de 17h30 jusqu’à 21h30, souvent 22h, c’était le théâtre. Amadou Bourou arrivait avec soit un spectacle de conte, soit une pièce. J’ai donc reçu une formation assez complète dans les différents arts mais aussi des réflexions autour du développement de l’art et de la culture au Burkina. Dans la compagnie, je suis devenu le responsable danse, et plus tard, le chorégraphe de la compagnie. On a participé à des cérémonies, j’ai chorégraphié le spectacle d’ouverture de la Coupe d’Afrique des nations en 1998, et le spectacle d’ouverture du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) en 1999.
Pourquoi avez-vous décidé ensuite de poursuivre votre carrière en Europe?
Ces deux événements ont été un peu comme une bascule pour moi. J’ai vu très vite mes limites en tant que chorégraphe, en tant que créateur, parce que j’avais des responsabilités mais je n’avais pas fait d’école de danse, je n’avais pas de connaissances réelles de la danse. Ici, on n’avait que l’Institut Français qui avait une bibliothèque assez fournie. À l’époque, il y avait trois livres sur la danse dans la bibliothèque… Et on attendait qu’un spectacle vienne à l’Institut Français pour savoir ce qu’était la création contemporaine.
À partir de 1999-2000, j’ai commencé à vouloir aller ailleurs pour apprendre. Pendant un an, j’ai envoyé des lettres partout. Finalement, Nathalie Cornille m’a retenu pour la création du spectacle Doublé Peau et je me suis retrouvé dans le Nord de la France, à côté de Lille, pendant 6 mois. Là, j’ai été très boulimique! J’ai regardé des cassettes vidéo, les grosses cassettes VHS de tout ce qui était danse, je me gavais, j’avais faim quoi. Et je prenais des cours de danse partout, des cours de danses africaines et de danses contemporaines.

Vous en profitiez aussi pour passer des auditions.
En 2002, j’ai vu une audition chez Alain Platel (pour le spectacle Wolf, Ballets C de la B/Alain Platel) et j’ai été retenu. Ça a été la bascule de ma vie, puisque tout d’un coup, je me retrouvais dans une grosse compagnie, à faire des tournées mondiales, à avoir de la notoriété. Ça a vraiment changé beaucoup de choses.
Et vous avez d’emblée créé votre propre compagnie. À quoi répondait ce besoin?
J’avais un objectif qui était clair: fabriquer mes spectacles, liés à la réalité politique de mon pays. J’avais envie de faire des choses qui parlaient aux gens ici, de créer tous mes spectacles en partie au Burkina. Cette préoccupation m’a aussi amené à la création d’Ankata: parler aux gens d’ici et aux gens de là-bas, parce que finalement, j’arrive à créer mes spectacles parce que je suis là-bas.
J’ai toujours été comme en mission, comme si je voulais propager la culture africaine contemporaine, partout dans le monde. Je pense vraiment qu’on a quelque chose, pour enrichir la création contemporaine mondiale. Avec notre spécificité, nos richesses, notre culture, avec cette force et cette énergie.
Avec Ankata, Laboratoire International de Recherche, Création et Production des Arts de la scène fonctionne que vous avez fondé à Bobo Dioulasso en 2014, il s’agit donc de contribuer au développement de cette créativité sur le continent et d’apporter les cadres et outils qui manquent actuellement aux jeunes danseur·euses.
Oui, j’ai voulu donner à la jeune génération ce qui m’avait manqué, moi, quand je voulais me former. J’avais d’abord un projet de médiathèque et de lieu pour développer la multidisciplinarité. Ça a toujours été une préoccupation pour moi, de ne pas rester cantonné dans un seul côté. Entretemps, il a eu le CDC – la termitière qui a été créé en 2006. Et du coup, il y a eu un pan de ma préoccupation qui a été éliminé. Ça m’a ramené au lieu où je suis né, à Bobo Dioulasso, qui est un berceau de la créativité, c’est une ville naturellement culturelle. Il y a beaucoup de jeunes talents qui montent et puis il y a une coupure. Il n’y a rien pour la formation et la professionnalisation. L’autre élément qui m’a amené à la création d’Ankata, c’est un engagement citoyen. Mes premières pièces étaient des pièces très politiques: on prend la parole, on dit les choses, ça danse, on est souvent contre les dirigeants en place dans nos pays, c’était de l’activisme sur la scène, jusqu’à Nuit Blanche à Ouagadougou, où on était au sommet de l’activisme puisqu’on a interpellé le président qui était au pouvoir à l’époque, on était vraiment agressifs. Ensuite, j’ai commencé à devenir un peu plus poétique, mes créations sont plus imagées, c’est beaucoup plus subtil. La politique, elle est toujours derrière, mais ce n’est plus en première ligne. C’est la poésie qui domine. À partir de 2014, j’ai donc décidé que, plutôt que dénoncer, j’allais faire ce que je pouvais de mon côté, pour montrer que c’est possible.
Au début, Ankata, c’était un projet écologique, économique et politique. Il s’agissait de voir comment rendre la création artistique vitale et viable dans des pays comme le Burkina Faso, en repensant complètement le système qui est aujourd’hui calqué et basé sur le système français. Ce système est décalé et ne correspond plus à notre réalité qui est complètement différente. Mon projet initial était idéaliste et titanesque, à un moment j’étais bloqué. J’ai dit OK, j’arrête et j’ai créé une scène de 8 mètres sur 10 dans ma cour, on a démarré là.

C’est le petit studio. Depuis peu, le grand studio a également ouvert ses portes. Quelles sont les activités que vous y développez?
J’avais un terrain à côté et avec l’architecte, on a réfléchi à comment adapter cet espace qui était assez petit pour faire le maximum de choses. On a la formation sur 3 ans, c’est Next Generation. On a aussi le coaching qui est davantage au niveau du mental parce que je pense que le problème au niveau de la création et au niveau de la jeunesse africaine, est mental plus qu’économique. C’est le mental qui va créer l’économie. Et après, il y a aussi le concours de solos chorégraphiques Simply The Best, qui est de la promotion pour les jeunes artistes. Toutes ces initiatives sont là pour répondre à ce qui moi m’avait manqué. Je me demande: qu’est-ce qui fait que moi, je peux tourner à travers le monde? Et comment je peux aider d’autres personnes?
Cette dimension humaine est importante. C’est pour ça que dans Ankata, il y a aussi un volet social. Il s’agit de contribuer au développement du quartier, pour l’éradication de l’extrême pauvreté, en tout cas autour de l’espace d’Ankata. On met en place un système de microcrédits avec les femmes du quartier. Elles peuvent, quand elles ont une idée d’un commerce, venir demander un prêt. Si elles remboursent dans la date fixée, elles peuvent demander le double. Pour les familles les plus pauvres, on prend en charge la scolarisation des enfants.
Quels liens établissez-vous entre vos spectacles et cet engagement social?
La raison pour laquelle je crée des spectacles, c’est pour changer la société, mais mon engagement passe par d’autres actions également.
Vous aimerez aussi

Trouble #13: Invocations et évocations
Grand Angle12 juin 2025 | Lecture 6 min.
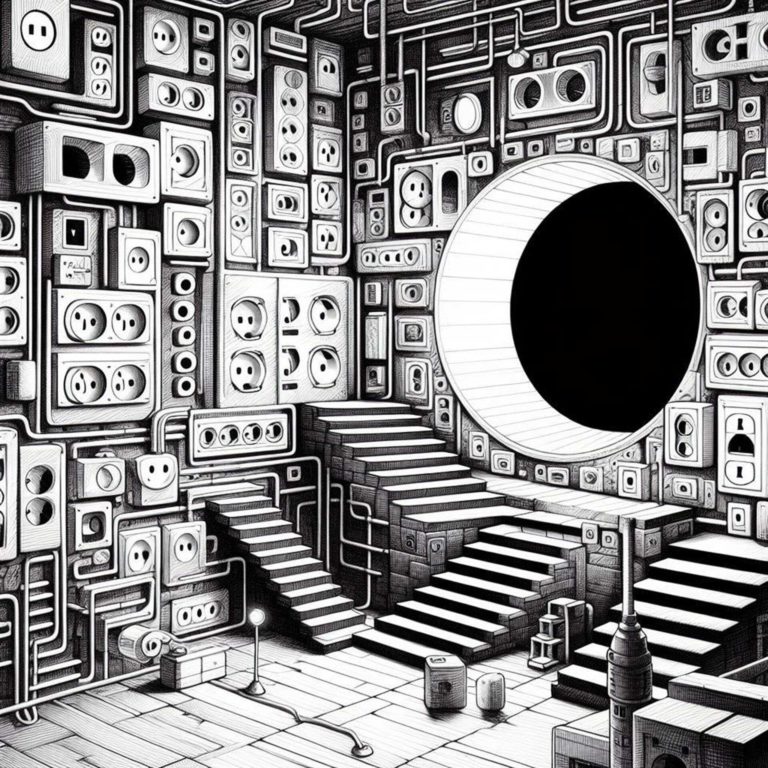
Simon Thomas & David Berliner
Grand Angle2 juin 2025 | Lecture 2 min.
épisode 5/5

KFDA, 30 ans
Grand Angle25 mai 2025 | Lecture 2 min.

De l’exil et de la censure
Grand Angle24 mai 2025 | Lecture 2 min.

La pratique de plumassière
En chantier21 avril 2025 | Lecture 2 min.

Louise Vanneste, de la boîte noire au plein jour
Au large14 avril 2025 | Lecture 7 min.

Puissances seules
En ce moment11 mars 2025 | Lecture 2 min.

RAGE
En ce moment7 mars 2025 | Lecture 2 min.

Salutations Mistinguettes
En ce moment7 mars 2025 | Lecture 2 min.

Laurence Rosier et Emilienne Flagothier
Grand Angle12 février 2025 | Lecture 2 min.
épisode 3/5

Décloisonner l’opéra
En chantier6 février 2025 | Lecture 1 min.

«Quelque chose de paisible, de tranquille et de beau»
En ce moment30 janvier 2025 | Lecture 1 min.
épisode 2/6

Pierre Lannoy et Claude Schmitz
Grand Angle26 janvier 2025 | Lecture 2 min.
épisode 2/5

Poèmes et Tango
En chantier2 janvier 2025 | Lecture 3 min.
épisode 1/3

Les châteaux de mes tantes
En ce moment2 décembre 2024 | Lecture 2 min.

État du monde
En ce moment23 septembre 2024 | Lecture 2 min.

Brûler, autour de Lucy
En chantier12 septembre 2024 | Lecture 12 min.

Au Brass
En ce moment8 septembre 2024 | Lecture 3 min.

Art et migration
Grand Angle2 septembre 2024 | Lecture 2 min.

Extimité.s par Zéphyr
Émois20 août 2024 | Lecture 3 min.
épisode 3/4

Et si Hansel avait consenti à être cuit vivant
Émois11 août 2024 | Lecture 5 min.
épisode 2/4

Kifesh 2.0 par Kifesh
Émois11 août 2024 | Lecture 3 min.
épisode 1/4

Sandrine Bergot, cap sur les Doms
Grand Angle25 juillet 2024 | Lecture 2 min.

Les hauts et les bas d’un théâtre de crise climatique à Avignon
Grand Angle22 juillet 2024 | Lecture 9 min.

Juana Ficción, chronique d’une disparition
Émois20 juillet 2024 | Lecture 4 min.

La petite fille sans nom
Au large17 juillet 2024 | Lecture 2 min.

Discofoot, Roller Derviches et leçons tout public
Au large9 juillet 2024 | Lecture 4 min.

[PODCAST] Louise Baduel dans les paradoxes de l'écologisme
En chantier6 juin 2024 | Lecture 2 min.
épisode 10/10

Quelle place pour la culture dans les partis?
Grand Angle1 juin 2024 | Lecture 12 min.

Le festival TB²
En ce moment31 mai 2024 | Lecture 3 min.

Théâtre au Vert
En ce moment31 mai 2024 | Lecture 2 min.

Nacera Belaza
En chantier28 mai 2024 | Lecture 2 min.

Idio Chichava au KFDA: découverte majeure
Émois19 mai 2024 | Lecture 5 min.

[PODCAST] KFDA 2024 L'art public selon Anna Rispoli
En chantier18 mai 2024 | Lecture 2 min.
épisode 2/2

[PODCAST] 13 ans de création aux Brigittines racontés dans un livre
En chantier3 mai 2024 | Lecture 1 min.
épisode 9/10

L’Oiseau que je vois
En chantier24 avril 2024 | Lecture 1 min.

Louise Baduel et Michèle Noiret
En ce moment23 avril 2024 | Lecture 2 min.

Second souffle
En chantier18 avril 2024 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] COLLEUSES FÉMINISTES ET COLÈRE DANS L’ESPACE PUBLIC AU THÉÂTRE VARIA
En chantier11 avril 2024 | Lecture 1 min.

Ma déficience visuelle ne devrait pas être un frein
Émois10 avril 2024 | Lecture 1 min.
épisode 1/1

Tu l'as trouvé où, ce spectacle?
En ce moment19 février 2024 | Lecture 2 min.

Mutualiser… une (nouvelle) politique culturelle?
Grand Angle18 février 2024 | Lecture 4 min.

Janine Godinas
Grand Angle18 janvier 2024 | Lecture 1 min.

Cherche employé·e de bureau
Grand Angle19 décembre 2023 | Lecture 12 min.

Comment l'école broie les Kévin
Grand Angle13 décembre 2023 | Lecture 1 min.

«Plonger», ou l'éloge de la suspension
En ce moment12 décembre 2023 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] Théâtre et quartiers populaires avec Yousra Dahry
Grand Angle16 novembre 2023 | Lecture 2 min.

[PODCAST] Arco Renz et Danielle Allouma en spirales hypnotiques
En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.
épisode 8/10

[PODCAST] Chloé Beillevaire et Sabina Scarlat, bouffonnes en collants
En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.
épisode 7/10

[PODCAST] Karine Ponties au confluent du réalisme et de l'abstraction
En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.
épisode 6/10

[PODCAST] Le pouvoir des ondes sonores avec Marielle Morales
En chantier8 novembre 2023 | Lecture 1 min.
épisode 5/10

Sur la vieillesse au théâtre
Grand Angle30 octobre 2023 | Lecture 11 min.

Macbeth au Shakespeare’s Globe
Au large17 octobre 2023 | Lecture 3 min.

L’Amour c’est pour du beurre
En ce moment16 octobre 2023 | Lecture 2 min.

L'appel des champignons
Au large9 octobre 2023 | Lecture 3 min.

Prendre soin, par le théâtre aussi
En ce moment4 octobre 2023 | Lecture 1 min.

Danse Avec les Foules
En ce moment2 octobre 2023 | Lecture 1 min.

Hippocampe
En ce moment29 septembre 2023 | Lecture 2 min.

La sentinelle du sens
Grand Angle29 août 2023 | Lecture 1 min.
épisode 3/10

Théâtre au Vert: diversité, simplicité, sincérité
En ce moment19 août 2023 | Lecture 1 min.

Réhabilitons Welfare, le spectacle mal-aimé d’Avignon 2023
Émois3 août 2023 | Lecture 11 min.

Violence symbolique et agressions réelles
Émois28 juillet 2023 | Lecture 6 min.

À Avignon, Julien Gosselin nous a percutés
Émois23 juillet 2023 | Lecture 8 min.

Drame familial sur fond d'imaginaire décolonisé
Grand Angle17 juillet 2023 | Lecture 1 min.

Place aux narrations féministes
En ce moment13 juillet 2023 | Lecture 12 min.

Avignon, le festival, et moi
En ce moment4 juillet 2023 | Lecture 1 min.

Cinq spectacles québécois en rafale au FTA et au Carrefour
Au large30 juin 2023 | Lecture 13 min.

Échappées urbaines
En ce moment12 juin 2023 | Lecture 2 min.

Malaise dans la civilisation
Émois19 mai 2023 | Lecture 3 min.

Garder l'enfance allumée
Grand Angle15 mai 2023 | Lecture 7 min.

Hormur: une plateforme pour créer dans des lieux insolites
En chantier15 mai 2023 | Lecture 1 min.

Le KFDA commence fort avec Angela, a strange loop
Émois13 mai 2023 | Lecture 4 min.

Créer ensemble dans la ville
Au large24 avril 2023 | Lecture 0 min.
épisode 6/6

Des forêts et des sardines
Grand Angle21 avril 2023 | Lecture 7 min.

[VIDÉO] Boucles infinies avec Arco Renz et Danielle Allouma
En chantier18 avril 2023 | Lecture 1 min.

Le collectif suisse BPM déploie son irrésistible «Collection»
Émois17 avril 2023 | Lecture 5 min.

[VIDÉO] Chloé Beillevaire et Sabina Scarlat, étonnantes «folles du roi»
En chantier12 avril 2023 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] L'ART SUBTIL DE LA RELAX PERFORMANCE AVEC SIDE-SHOW
En chantier30 mars 2023 | Lecture 1 min.

Indiscipline à Knokke!
En ce moment29 mars 2023 | Lecture 2 min.
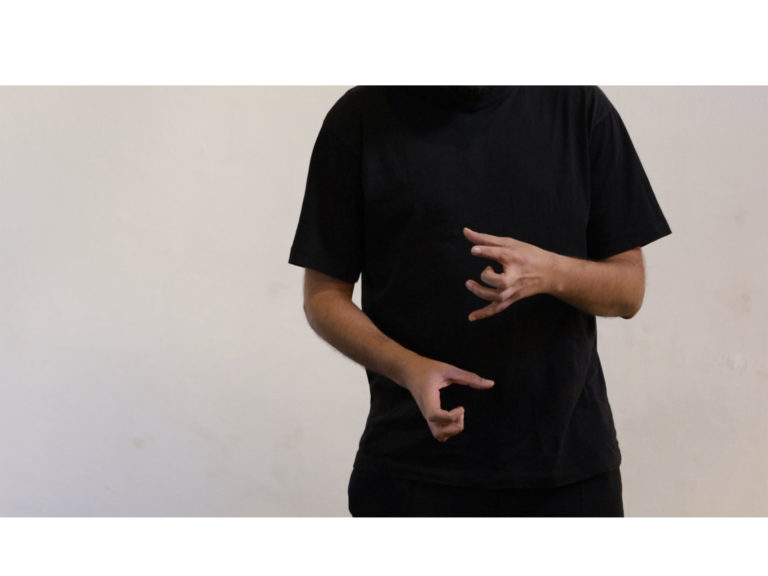
Abdel Mounim Elallami, un premier solo, un premier prix!
Au large27 mars 2023 | Lecture 0 min.
épisode 3/6

Fancy Legs
En ce moment21 mars 2023 | Lecture 2 min.

[VIDÉO] LE BANAL SUBLIMÉ AVEC KARINE PONTIES
En chantier20 mars 2023 | Lecture 2 min.

[VIDÉO] Entre l'audible et l'invisible avec Marielle Morales
En chantier15 mars 2023 | Lecture 1 min.

Ces paroles qui nous rassemblent
Grand Angle7 mars 2023 | Lecture 1 min.
épisode 2/10

Carte noire nommée désir
Émois20 février 2023 | Lecture 4 min.
épisode 7/15

Rabelais revient à la charge
Grand Angle18 février 2023 | Lecture 1 min.
épisode 1/10

Okraïna Records fête ses dix ans!
Grand Angle17 janvier 2023 | Lecture 1 min.

Tervuren
En chantier13 janvier 2023 | Lecture 4 min.

Philippe Grombeer et les Halles
En ce moment10 janvier 2023 | Lecture 4 min.

Morel, c’est quelqu’un!
Grand Angle10 janvier 2023 | Lecture 1 min.

La puissance des langues vernaculaires
Au large15 novembre 2022 | Lecture 2 min.

Méduse.s par le collectif La Gang
Grand Angle11 novembre 2022 | Lecture 10 min.
épisode 2/3

Que nos enfants soient des géants
Au large7 novembre 2022 | Lecture 1 min.

Créer pour faire advenir le female gaze
Grand Angle27 octobre 2022 | Lecture 6 min.
épisode 1/3

Déplacer l’espace du théâtre dans les cours familiales
Au large24 octobre 2022 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] Au fin fond des temps avec la compagnie Mossoux-Bonté
En chantier18 octobre 2022 | Lecture 1 min.

Cinéaste et thérapeute corporelle
Grand Angle14 octobre 2022 | Lecture 1 min.
épisode 18/18

Donner sa place au public
Au large12 octobre 2022 | Lecture 2 min.

[VIDÉO] En immersion avec Tumbleweed aux Brigittines
En chantier1 octobre 2022 | Lecture 1 min.

Un nouveau prix au Burkina Faso!
Au large28 septembre 2022 | Lecture 4 min.

Trouver un lieu pour y faire du théâtre
Grand Angle17 septembre 2022 | Lecture 1 min.

Graphiste-illustratrice et plasticienne
Grand Angle14 août 2022 | Lecture 1 min.
épisode 16/18

Still Life fait régner le théâtre sans paroles à Avignon
Grand Angle23 juillet 2022 | Lecture 1 min.

Koulounisation de Salim Djaferi
En ce moment16 juillet 2022 | Lecture 1 min.

Accompagner plutôt que programmer
Grand Angle3 juillet 2022 | Lecture 7 min.

Circassienne, le saut dans le vide
Grand Angle3 juillet 2022 | Lecture 4 min.
épisode 3/3

Comédien et guide à l’Africa Museum de Tervuren
Grand Angle1 juillet 2022 | Lecture 1 min.
épisode 15/18

Un festival au grand jour
Au large5 juin 2022 | Lecture 3 min.

Compositrice-interprète et responsable de revue
Grand Angle1 juin 2022 | Lecture 1 min.
épisode 14/18

Entrer et voir le bar
Grand Angle30 mai 2022 | Lecture 1 min.

«T’inquiète pas, je te rattrape»
Grand Angle30 mai 2022 | Lecture 4 min.
épisode 2/3

L'échec vu du public
En chantier28 mai 2022 | Lecture 3 min.
épisode 3/4

Démontage du chapiteau patriarcal
Grand Angle10 mai 2022 | Lecture 6 min.
épisode 1/3

Gestionnaire le matin et artiste l'après-midi
Grand Angle9 mai 2022 | Lecture 1 min.

Même pas mort le répertoire
En ce moment2 mai 2022 | Lecture 2 min.

La fascination du mal
En ce moment1 mai 2022 | Lecture 1 min.

Guyane, Liban, Iran, Japon...
En ce moment1 mai 2022 | Lecture 1 min.

De la musique à la danse de luttes
En ce moment21 avril 2022 | Lecture 1 min.

D'ici et d'ailleurs
En ce moment14 avril 2022 | Lecture 1 min.

Comédien et formateur en entreprise
Grand Angle25 mars 2022 | Lecture 1 min.
épisode 7/18

Archipel
En ce moment23 mars 2022 | Lecture 4 min.

Germaine Acogny, in(c)lassable reine de la danse
En ce moment13 février 2022 | Lecture 1 min.

Déboires assumés
En chantier31 janvier 2022 | Lecture 8 min.
épisode 1/4

Acteur et plombier/chauffagiste
Grand Angle28 décembre 2021 | Lecture 1 min.
épisode 2/18

Diriger un théâtre: un geste politique
Grand Angle28 décembre 2021 | Lecture 2 min.

Un spectacle par ses costumes
En ce moment16 septembre 2021 | Lecture 5 min.