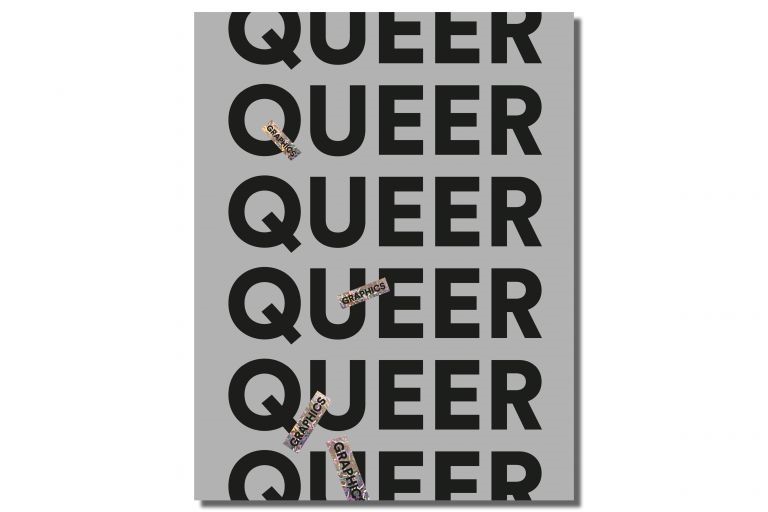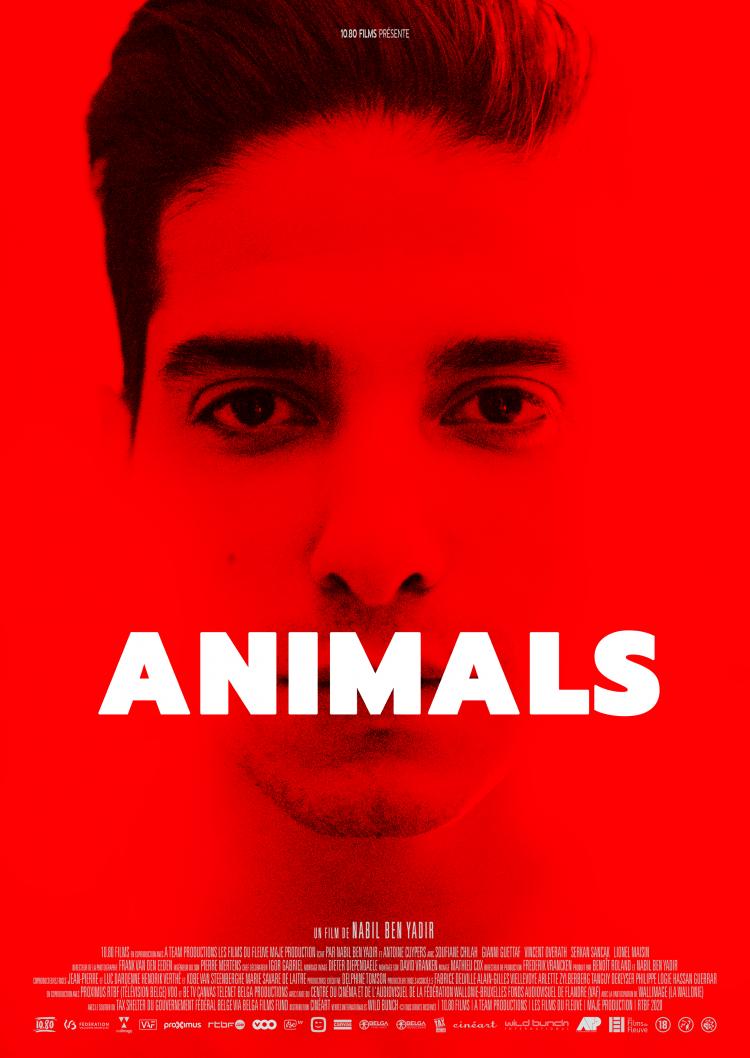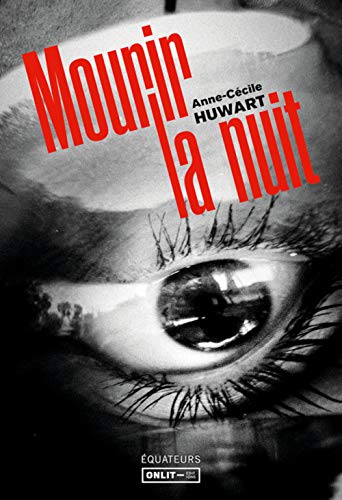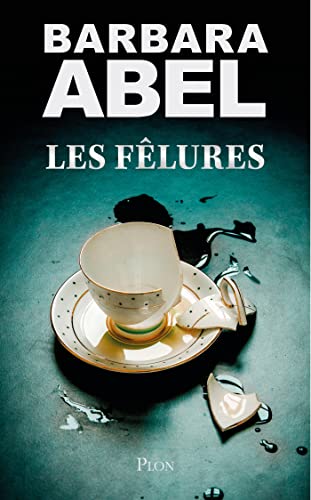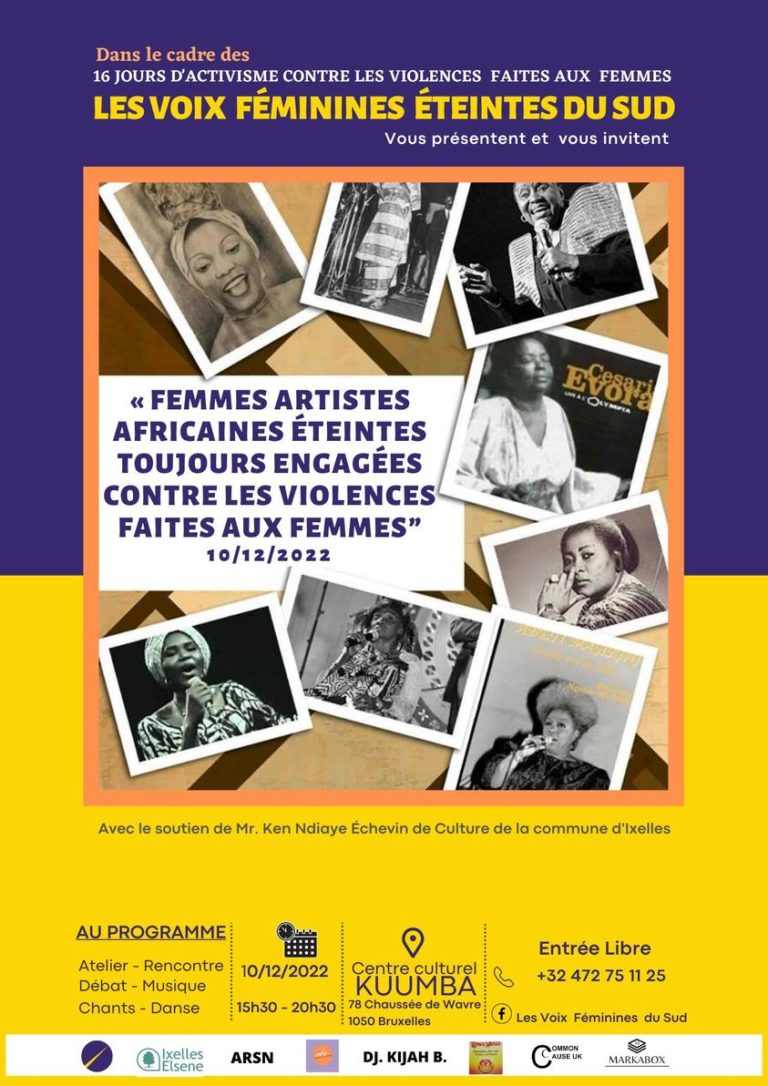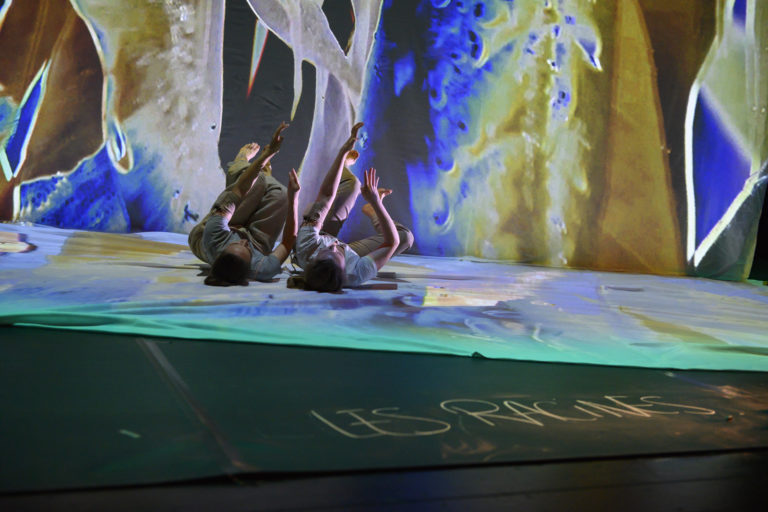Entrer et voir le bar
Grand Angle30 mai 2022 | Lecture 1 min.
Pour son travail de fin d’études à l’INSAS en 2019 accompagnée par Coline Struyf, Alyssa Tzavaras a travaillé sur un projet personnel d’ouverture d’un nouveau théâtre. Elle s’est interrogée sur les liens entre la gestion d’un lieu et le désir personnel de création artistique. Pour alimenter sa réflexion, elle rencontre une série d’artistes-directeur-ices de théâtre en Belgique. Aujourd’hui, nous publions des extraits de sa conversation avec Martine Wijckaert, metteuse en scène, autrice et fondatrice du théâtre La Balsamine (Schaerbeek).
ATJe te rencontre en tant que metteuse en scène-fondatrice d’un lieu parce que j’aimerais avoir mon propre lieu l’année prochaine pour créer mes spectacles.
MWQu’est-ce ça représente pour toi d’avoir ton propre lieu? C’est une aventure que tu ne décides pas comme ça, c’est quelque chose qui te tombe dessus.
Quand tu dis: «J’ai envie d’avoir mon propre lieu?», ça veut dire quoi?
Si c’est pour dire: «J’ai envie d’être seul maître à bord, et de ne pas dépendre de toute une série de contextes et de CADRES dans lesquels je dois rentrer», c’est autre chose, ça c’est un peu ce qu’on a fait nous, les vieux, il y a 45 ans, mais au moment où l’histoire le permettait. L’histoire a terriblement changé, le contexte aussi.
Moi, je sais qu’à l’époque où je suis sortie de l’Insas, il n’y avait rien. Il y avait le Théâtre National, qui était une institution boulonnée, close, en fonction de laquelle tu te situais: avec, ou à côté. Et à côté, ça signifiait contre. Et donc, l’histoire nous était extrêmement favorable. Il n’y avait rien.
Je pense toujours que par rapport à des gens de votre génération, nous avons eu une chance historique admirable. Nous sortions de la guerre, donc tout, tout était…
À reconstruire…
La guerre, au sens symbolique je veux dire. Tout était à inventer. Il y avait partout des lieux en déshérence laissés totalement à l’abandon, des friches en veux-tu en voilà, plus belles les unes que les autres.
À ma sortie de l’Insas, j’ai été… comment dit-on… Pas convoquée, mais, disons, invitée, par le Théâtre National et sa direction. J’avais déjà fait un spectacle, c’est pourquoi Jacques Huisman m’a dit: «Madame j’aimerais bien que… vous rentriez dans ma maison patati patata en tant que metteuse en scène…». Mais quand je suis arrivée là, rien que pousser la porte de derrière – c’était encore au centre Martini, ce bâtiment n’existe plus – et voir ce concierge derrière sa plaque de verre, et monter dans cet ascenseur… Je ruisselais de gouttes grosses comme des pièces de 5 francs. Je me sentais déjà très mal. Évidemment, je n’étais qu’une gamine, et je lui ai dit non.
Avec mes intestins dans un état! Je me disais: «Wijckaert tu commences ta jeune vie de travail à la scène, et tu scies déjà l’arbre sur lequel tu peux pousser!». C’était une démarche artistique entière qui m’animait. Tu as un univers dans ta tête et tu te dis: «Dans quel décor naturel je vais travailler et quel décor naturel je vais pouvoir commencer à hanter?» Toute ma démarche est fondée là-dessus.

Tu avais fait des créations dans différents lieux, mais qu’est-ce qui fait qu’à un moment, tu t’es sédentarisée?
PARCE QUE: ICI ! J’AI DIT: ICI! Ici, c’est une gigantesque cité de la fiction. Je peux me sédentariser sans être sédentaire. Il faut se rendre compte ce que c’était que cette caserne, il y avait un parc délirant ici au milieu, en herbes et en arbres sauvages, des bâtiments partout ouverts à tout vent avec des espaces plus improbables les uns que les autres.
Quand tu dis que tu es venue hanter ce lieu-ci, est-ce que tu trouves que ta démarche artistique personnelle, qui passe à travers le lieu, est la même que la direction de ce lieu? Est-ce que c’était deux projets distincts ou est-ce que ça s’est fondu?
Ça s’est fondu en un seul et même projet, parce que pour moi diriger un lieu ça ne signifiait rien. J’ai toujours été un peu… juste à côté du trottoir. Je me suis dit: «Ici il y a de la place, ouvrons les portes, travaillons avec les gens!» J’ai donné le premier coup de marteau pour défoncer un mur qui permettait d’avoir un accès vers des loges de fortune; quand je me suis retournée, il y avait quinze personnes derrière moi qui travaillaient.
Ça s’est fait comme ça. Je ne voulais pas dire «VOILÀ ICI C’EST CHEZ MOI JE FAIS CECI JE FAIS CELA» – Non. Groupons-nous. Travaillons, proposons des espaces, posons-nous des questions. Ça, ça a vraiment été la période de la Balsamine Sauvage.
Est-ce que tu trouves qu’elle est encore sauvage?
Elle ne peut plus être aussi sauvage qu’avant. D’abord parce que nous sommes devenus une institution qui est subventionnée, ensuite, des travaux ont eu lieu, et enfin, l’époque a changé. Avant, il y avait l’esprit de l’utopie.
Les gens venaient ici parce qu’ils savaient qu’ils allaient RUTSEPOTS, qu’il allait se passer un BROL ou je ne sais pas quoi. Cette époque de l’utopie, elle est morte, l’institution a très très bien fait son travail: les choses se récupèrent, se mettent dans des canaux, il faut se mettre dans des tiroirs.
Le monde est devenu ça: le cadre importe plus que la peinture.
Je lis un modèle de dossier CAPT, j’ai envie de hurler! Vous devez refuser, vous battre, parce que le modèle de questionnaire, ça induit déjà tout un processus qui n’a rien à voir avec l’art. C’est à dire que ceux qui vont réussir sont ceux qui sont capables de fournir un beau cadre, avec une pince qui va bien tenir au mur, des petits mouchoirs, et seulement après ils se disent: et qu’est-ce qu’on va peinnnndrrre? Et généralement, c’est le vide abyssal.
C’est structuré comme un produit, mais nous ne faisons pas des produits. Nous créons des espaces-temps d’échanges, de rencontres et d’interactivité, c’est ça faire de l’art. Créer des espaces-temps où des êtres qui ne se connaissent pas, même silencieux, qui ne se parleront jamais, vont pouvoir établir un terrain de réflexion à la fois individuel et collectif, donc c’est TOUT SAUF UN PRODUIT.
Et là je me dis: l’utopie, putain elle en a pris plein dans la gueule. Moi, je ne vais pas vivre éternellement, dans dix ans je ne suis plus là. Si maintenant, des gens de la jeune génération, ne se décident pas à mettre cette pyramide sur la pointe… NO FUTURE.
Donc, l’histoire qu’on a vécue, ça a été un peu l’histoire de la ré-invention de la RE -présentation du monde dans un espace-temps artistiquement travaillé, c’est un peu ça qu’on a vécu. Les temps étaient propices à ça.
C’est ça que tu ferais en tant que jeune créateur aujourd’hui? J’ai l’impression qu’ouvrir un lieu alternatif aujourd’hui…
Je ne sais pas ce que je ferais, mais je garderais très fort à l’esprit que – qui a dit ça? – que «la fonction crée l’organe». La fonction: notre art/l’organe: eh bien, c’est ce qui va se CRISTALLISER et se construire et outiller la chose. En sachant que des friches, ça n’existe plus, plus du tout. Ou alors…
Bah alors moi justement j’en ai trouvé une!
Oui, où?
Rue de l’Indépendance. À Molenbeek, regarde.
Attends mais on peut trouver ça sur le net? Ah oui beau, BEAU, TRÈS BEAU!
C’est une sorte de Caserne. Magnifique. Et t’as vu l’intérieur?
Non pas encore, mais regarde la vue au-dessus! Mais comment t’as fait toi? Tu as demandé à la commune?
Mais pas à la commune! PAS À LA COMMUNE! C’est la Société Nationale du Logement! C’était miraculeux, c’est ce qu’on appelait l’agent immobilier de l’ÉTAT. En fait, j’avais déjà joué un spectacle sur un monument 14-18, le monument des Grenadiers, dans la caserne Prince Baudouin qui se trouvait rue des Petit Carmes, c’est le fameux Leopold II.
Je m’étais demandé à qui ça appartenait. Les militaires, à ce moment-là, se débarrassaient de toutes leurs propriétés militaires sur la ville de Bruxelles.
Après Leopold II, je voulais monter Les Grâces et les épouvantails ou la pilule verte de Witkiewicz, et il me fallait une très grande profondeur, des enfilades. Et je demande à Mademoiselle Argot: est-ce que c’est la seule caserne? Ah bé non! Y a la caserne Dailly qui vient de se vider. Je demande si on peut la visiter, et elle: Ah oui oui, je viens avec vous…
On a passé UN jour dans ce lieu mais HALLUCINANT et AHHH mon enfilade magnifique était là, avec pièce à feu ouvert où tu pouvais encore faire du feu dedans, enfin tout, des cuisines, t’avais un truc qui faisait mais toute l’Avenue Charbeau, ça faisait 200m de profondeur, un point de vue… Et j’obtiens l’autorisation pour La Pilule Verte.
Et à ce moment-là, FIOU – mon dossier est refusé au ministère. Le dossier Les Grâces et les épouvantails est refusé. Je me retrouve donc avec un lieu gigantesque, un texte de Witkiewicz en main, et plus rien. Et j’ai commencé à écrire à partir de ça, j’ai convoqué Jean-Jacques Moreau, Alexandre von Sivers; j’ai dit: est-ce qu’on se lance dans cette aventure? Pouf. On a investi ce lieu sans pognon.
On travaille, on commence à jouer des mois durant à bureaux fermés, ça nous a permis de financer tous nos travaux et de nous payer. On vivait ici pour ainsi dire. On se chauffait avec du bois dans le feu ouvert, on chauffait nos marmites, notre soupe, une gamelle qu’on faisait réchauffer sur le feu qui servait pour le spectacle. Et par une belle nuit, il neigeait mais le dégel commençait à s’amorcer, on part avec torches électriques et tout le bazar. Et y’avait une porte sur le côté et puis on s’est dit merde, c’est fermé et puis Jean-Jacques a dit: écartez-vous… RATATATA PAAMMM!!! Il a fait voler cette porte en éclats. On est entrés là-dedans…
Et là, y avait une scène, et une salle à l’Élisabéthaine, avec des cartes d’état-major gigantesques qui flottaient dans le vent, une longue table de conférence, des sièges avec tablettes pour mettre des notes, en amphithéâtre et Tip Tip, les plafonds qui perçaient et qui faisaient des gouttes sur la scène élisabéthaine en chêne massif, et là j’ai eu un réflexe fatal – je dis toujours ça parce que ça a fondé tout – j’avais vu qu’il y avait des vieilles bassines dehors. Je me suis précipitée pour aller en chercher et j’ai placé des bassines sous toutes les fuites. Sans dire un mot. Et là on a pensé: c’est un théâtre ici.
Et c’était parti.
Comment ferais-tu pour qu’on puisse obtenir le lieu là, par exemple?
Bah déjà je me renseignerais. Est-ce que ça va être démoli, est-ce que c’est un bien communal? Si ça se trouve, c’est une propriété privée, qui appartient à quelqu’un, qui est en indivision! Va au cadastre de Molenbeek-Saint-Jean, tu commences par ça. Mais sache aussi que tout est compliqué.
Comment est-ce que tu chauffes ça, et attention acoustiquement, il faut inventer.
Et ensuite les mécanismes artistiques se mettront en place en fonction de cet édifice.
Il faut garder confiance en l’édifice, qui va te faire inventer la bonne chose…
C’est comme un peintre. Il sélectionne ses outils en fonction de ce qu’il est en train de
peindre.
Revenons-en à la Balsamine.
Bon, nous sommes devenus une institution subventionnée, patati patata. Mais la chose la plus importante est restée: le fait que c’est une maison ici. Il faut s’interroger sur l’esprit «maison». Une maison, c’est un endroit où tu peux t’asseoir, au chaud, ou au frais quand il fait chaud dehors, manger, cuisiner, te reposer, dormir, travailler, te croiser, passer du temps… Ce n’est pas un théâtre ici, c’est une maison.
Pendant les travaux de ré-aménagement, j’ai dit à l’architecte: «Le truc le plus important: les gens rentrent et ils doivent trouver un bar.» Parce que partout ailleurs tu arrives: «Oui, vous avez réservé?» HORREUR.
C’est très important cet aspect. Tu entres, tu as des cons qui boivent et t’as des culs sur les tabourets. Tu vois, pas de vestiaires, tu mets un porte-manteau d’école, c’est un vieux porte-manteau de la caserne, les gens se démerdent, y’a pas de places réservés, y’a pas de vestiaire, et quand tu entres tu tombes sur un bar, pas sur une caisse.
Il y a beaucoup de théâtres où les gens ne se croisent jamais! C’est monstrueux.
À la vieille Balsamine, tout communiquait ensemble: pour aller au bureau tu devais traverser les loges, une espèce de grand pentagone étiré, une espèce de local en long nez, donc tu allais à ton ordinateur pour faire ta compta, tu passais dans une loge, tu croisais un type à poil! Ou une femme, qu’importe! Ça, ça doit rester! Et ici, tu peux partir d’un point et sans jamais te retourner, tu peux faire le tour complet de tout le théâtre. Mais de tout! Petite salle, grande salle, cave, bazar et tout, sans jamais avoir à revenir sur tes pas. Ça pour nous c’était essentiel: les gens entrent et voient un bar.

Vous aimerez aussi

L'ouverture mythique de la Raffinerie du Plan K
Grand Angle10 juin 2021 | Lecture 3 min.

Diriger un théâtre: un geste politique
Grand Angle28 décembre 2021 | Lecture 2 min.

Gestionnaire le matin et artiste l'après-midi
Grand Angle9 mai 2022 | Lecture 1 min.

Le vent tourne II
Grand Angle29 décembre 2021 | Lecture 7 min.

Voir la mer et survivre
Émois8 juillet 2025 | Lecture 4 min.

Prix Maeterlinck: le retour
En ce moment27 juin 2025 | Lecture 4 min.

Trouble #13: Invocations et évocations
Grand Angle12 juin 2025 | Lecture 6 min.

Concret-abstrait, et vice-versa
Émois30 mai 2025 | Lecture 5 min.

KFDA, 30 ans
Grand Angle25 mai 2025 | Lecture 2 min.

De l’exil et de la censure
Grand Angle24 mai 2025 | Lecture 2 min.

Les désirs dans les mondes de l'art
En ce moment16 mai 2025 | Lecture 1 min.

La pratique de plumassière
En chantier21 avril 2025 | Lecture 2 min.

Louise Vanneste, de la boîte noire au plein jour
Au large14 avril 2025 | Lecture 7 min.

L’ombre des espèces
En ce moment28 mars 2025 | Lecture 2 min.

Puissances seules
En ce moment11 mars 2025 | Lecture 2 min.

RAGE
En ce moment7 mars 2025 | Lecture 2 min.

Décloisonner l’opéra
En chantier6 février 2025 | Lecture 1 min.

«Quelque chose de paisible, de tranquille et de beau»
En ce moment30 janvier 2025 | Lecture 1 min.
épisode 2/6

Poèmes et Tango
En chantier2 janvier 2025 | Lecture 3 min.
épisode 1/3

Le Pacha, ma mère et moi
Émois5 décembre 2024 | Lecture 3 min.
épisode 11/16

Les châteaux de mes tantes
En ce moment2 décembre 2024 | Lecture 2 min.

État du monde
En ce moment23 septembre 2024 | Lecture 2 min.

Brûler, autour de Lucy
En chantier12 septembre 2024 | Lecture 12 min.

Au Brass
En ce moment8 septembre 2024 | Lecture 3 min.

Art et migration
Grand Angle2 septembre 2024 | Lecture 2 min.

Sandrine Bergot, cap sur les Doms
Grand Angle25 juillet 2024 | Lecture 2 min.

Les hauts et les bas d’un théâtre de crise climatique à Avignon
Grand Angle22 juillet 2024 | Lecture 9 min.

Juana Ficción, chronique d’une disparition
Émois20 juillet 2024 | Lecture 4 min.

La petite fille sans nom
Au large17 juillet 2024 | Lecture 2 min.

Spoorloos/The Vanishing
En ce moment1 juillet 2024 | Lecture 2 min.
épisode 3/16

[PODCAST] Louise Baduel dans les paradoxes de l'écologisme
En chantier6 juin 2024 | Lecture 2 min.
épisode 10/10

Quelle place pour la culture dans les partis?
Grand Angle1 juin 2024 | Lecture 12 min.
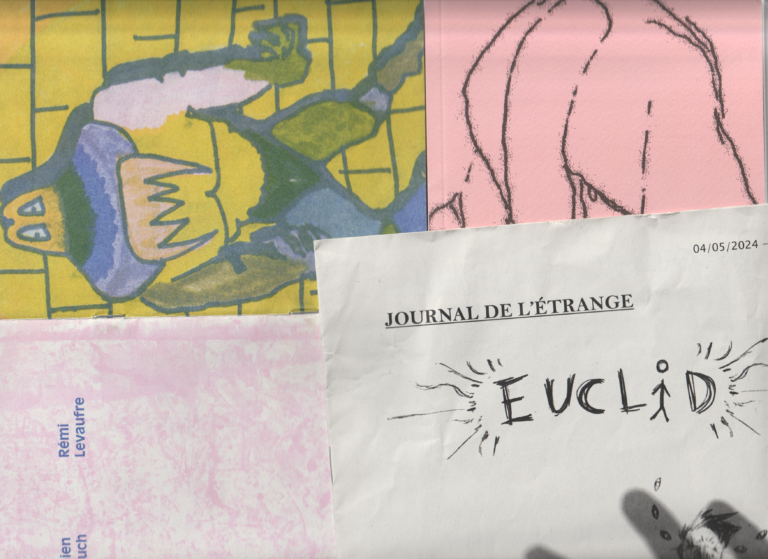
Entre Strasbourg et Liège, des livres inattendus
En chantier1 juin 2024 | Lecture 5 min.
épisode 8/9

Le festival TB²
En ce moment31 mai 2024 | Lecture 3 min.

Nacera Belaza
En chantier28 mai 2024 | Lecture 2 min.

Idio Chichava au KFDA: découverte majeure
Émois19 mai 2024 | Lecture 5 min.

[PODCAST] KFDA 2024 L'art public selon Anna Rispoli
En chantier18 mai 2024 | Lecture 2 min.
épisode 2/2

Orlando: ma biographie politique, et des lieux qu’on habite ensemble
Émois17 mai 2024 | Lecture 5 min.
épisode 4/5

[PODCAST] 13 ans de création aux Brigittines racontés dans un livre
En chantier3 mai 2024 | Lecture 1 min.
épisode 9/10

L’Oiseau que je vois
En chantier24 avril 2024 | Lecture 1 min.

Louise Baduel et Michèle Noiret
En ce moment23 avril 2024 | Lecture 2 min.

L'achronique de Karolina à Rile* Books: being iconic, clubbing et micropoèmes flamands
En chantier22 avril 2024 | Lecture 5 min.
épisode 7/9

Le zine s’institutionnalise-t-il? Interview avec Karolina Parzonko
En chantier22 avril 2024 | Lecture 7 min.
épisode 6/9

Second souffle
En chantier18 avril 2024 | Lecture 1 min.

Love Lies Bleeding
Émois15 avril 2024 | Lecture 4 min.

[VIDÉO] COLLEUSES FÉMINISTES ET COLÈRE DANS L’ESPACE PUBLIC AU THÉÂTRE VARIA
En chantier11 avril 2024 | Lecture 1 min.

Ma déficience visuelle ne devrait pas être un frein
Émois10 avril 2024 | Lecture 1 min.
épisode 1/1

À l’épreuve de la matière
En ce moment11 mars 2024 | Lecture 4 min.

Le Crazy Circle
Émois23 février 2024 | Lecture 6 min.
épisode 2/5

Mutualiser… une (nouvelle) politique culturelle?
Grand Angle18 février 2024 | Lecture 4 min.

[VIDÉO] Dans l'atelier grouillant de Julie Larrouy à Saint-Gilles
En chantier7 février 2024 | Lecture 1 min.
épisode 3/3

La Barakakings à Naast Monique
Émois27 janvier 2024 | Lecture 5 min.
épisode 1/5

La semaine du son
En ce moment21 janvier 2024 | Lecture 2 min.

Janine Godinas
Grand Angle18 janvier 2024 | Lecture 1 min.

Comment l'école broie les Kévin
Grand Angle13 décembre 2023 | Lecture 1 min.

«Plonger», ou l'éloge de la suspension
En ce moment12 décembre 2023 | Lecture 1 min.

cinemamed
En ce moment29 novembre 2023 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] Théâtre et quartiers populaires avec Yousra Dahry
Grand Angle16 novembre 2023 | Lecture 2 min.

[PODCAST] Arco Renz et Danielle Allouma en spirales hypnotiques
En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.
épisode 8/10

[PODCAST] Chloé Beillevaire et Sabina Scarlat, bouffonnes en collants
En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.
épisode 7/10

[PODCAST] Karine Ponties au confluent du réalisme et de l'abstraction
En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.
épisode 6/10

[PODCAST] Le pouvoir des ondes sonores avec Marielle Morales
En chantier8 novembre 2023 | Lecture 1 min.
épisode 5/10

Sur la vieillesse au théâtre
Grand Angle30 octobre 2023 | Lecture 11 min.

En écoutant Tous à poil! Histoire de la nudité
En ce moment30 octobre 2023 | Lecture 1 min.

Au pays de l’or blanc
En ce moment22 octobre 2023 | Lecture 4 min.
épisode 6/7

Macbeth au Shakespeare’s Globe
Au large17 octobre 2023 | Lecture 3 min.

Miroir Miroir
En ce moment16 octobre 2023 | Lecture 2 min.

L’Amour c’est pour du beurre
En ce moment16 octobre 2023 | Lecture 2 min.

L'appel des champignons
Au large9 octobre 2023 | Lecture 3 min.

Prendre soin, par le théâtre aussi
En ce moment4 octobre 2023 | Lecture 1 min.

Danse Avec les Foules
En ce moment2 octobre 2023 | Lecture 1 min.

Hippocampe
En ce moment29 septembre 2023 | Lecture 2 min.

La sentinelle du sens
Grand Angle29 août 2023 | Lecture 1 min.
épisode 3/10

Grande Fête Pointue
En ce moment24 août 2023 | Lecture 1 min.

Le vrai calme se trouve dans la tempête
Au large21 août 2023 | Lecture 5 min.

Théâtre au Vert: diversité, simplicité, sincérité
En ce moment19 août 2023 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] Lumière sur le vitrail dans l'atelier de François et Amélie
En chantier7 août 2023 | Lecture 1 min.
épisode 2/3

Réhabilitons Welfare, le spectacle mal-aimé d’Avignon 2023
Émois3 août 2023 | Lecture 11 min.

Violence symbolique et agressions réelles
Émois28 juillet 2023 | Lecture 6 min.

À Avignon, Julien Gosselin nous a percutés
Émois23 juillet 2023 | Lecture 8 min.

Drame familial sur fond d'imaginaire décolonisé
Grand Angle17 juillet 2023 | Lecture 1 min.

Place aux narrations féministes
En ce moment13 juillet 2023 | Lecture 12 min.

Retour sur l'Auberge Cabaret Bethléem
Émois10 juillet 2023 | Lecture 4 min.
épisode 1/1

Avignon, le festival, et moi
En ce moment4 juillet 2023 | Lecture 1 min.

L'Amphithéâtre Patrice Lumumba
Grand Angle27 juin 2023 | Lecture 1 min.
épisode 3/3

Échappées urbaines
En ce moment12 juin 2023 | Lecture 2 min.

[VIDÉO] Valse des matériaux dans l'atelier de Jacques Di Piazza
En chantier27 mai 2023 | Lecture 1 min.
épisode 1/3

Depuis que tu n’as pas tiré
En ce moment24 mai 2023 | Lecture 2 min.

Le Brussels Jazz week-end
En ce moment24 mai 2023 | Lecture 2 min.

«Collision» et ça repart!
En ce moment24 mai 2023 | Lecture 2 min.

Malaise dans la civilisation
Émois19 mai 2023 | Lecture 3 min.

Hormur: une plateforme pour créer dans des lieux insolites
En chantier15 mai 2023 | Lecture 1 min.

Le KFDA commence fort avec Angela, a strange loop
Émois13 mai 2023 | Lecture 4 min.

Serge Aimé Coulibaly, danser ici et ailleurs
Au large28 avril 2023 | Lecture 1 min.

Créer ensemble dans la ville
Au large24 avril 2023 | Lecture 0 min.
épisode 6/6

Des forêts et des sardines
Grand Angle21 avril 2023 | Lecture 7 min.

[VIDÉO] Boucles infinies avec Arco Renz et Danielle Allouma
En chantier18 avril 2023 | Lecture 1 min.

Le collectif suisse BPM déploie son irrésistible «Collection»
Émois17 avril 2023 | Lecture 5 min.

Brulex et Mathieu Desjardins
En ce moment17 avril 2023 | Lecture 2 min.

[VIDÉO] Chloé Beillevaire et Sabina Scarlat, étonnantes «folles du roi»
En chantier12 avril 2023 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] L'ART SUBTIL DE LA RELAX PERFORMANCE AVEC SIDE-SHOW
En chantier30 mars 2023 | Lecture 1 min.

Nedjma Hadj Benchelabi: programmatrice-dramaturge
Au large28 mars 2023 | Lecture 1 min.
épisode 5/6
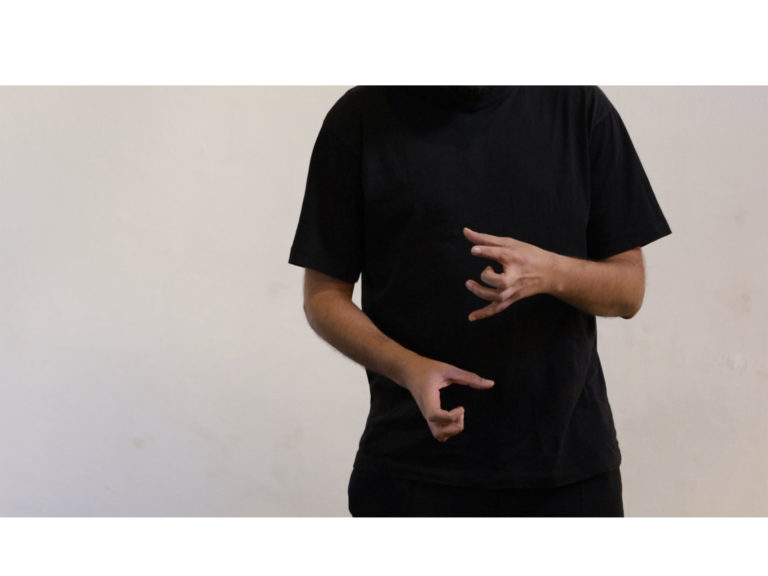
Abdel Mounim Elallami, un premier solo, un premier prix!
Au large27 mars 2023 | Lecture 0 min.
épisode 3/6

[VIDÉO] LE BANAL SUBLIMÉ AVEC KARINE PONTIES
En chantier20 mars 2023 | Lecture 2 min.

[VIDÉO] Entre l'audible et l'invisible avec Marielle Morales
En chantier15 mars 2023 | Lecture 1 min.

Ces paroles qui nous rassemblent
Grand Angle7 mars 2023 | Lecture 1 min.
épisode 2/10

Carte noire nommée désir
Émois20 février 2023 | Lecture 4 min.
épisode 7/15

Rabelais revient à la charge
Grand Angle18 février 2023 | Lecture 1 min.
épisode 1/10

Archipel_o
En ce moment13 février 2023 | Lecture 2 min.

Okraïna Records fête ses dix ans!
Grand Angle17 janvier 2023 | Lecture 1 min.

Tervuren
En chantier13 janvier 2023 | Lecture 4 min.

Philippe Grombeer et les Halles
En ce moment10 janvier 2023 | Lecture 4 min.

Morel, c’est quelqu’un!
Grand Angle10 janvier 2023 | Lecture 1 min.

Les murs ont la parole
Au large9 décembre 2022 | Lecture 10 min.

La très belle métamorphose d’une traduction des Métamorphoses
Grand Angle18 novembre 2022 | Lecture 1 min.

La puissance des langues vernaculaires
Au large15 novembre 2022 | Lecture 2 min.

Du théâtre malgré tout
Au large9 novembre 2022 | Lecture 2 min.

Que nos enfants soient des géants
Au large7 novembre 2022 | Lecture 1 min.

La puissance de Dionysos
Au large3 novembre 2022 | Lecture 5 min.

Créer pour faire advenir le female gaze
Grand Angle27 octobre 2022 | Lecture 6 min.
épisode 1/3

Déplacer l’espace du théâtre dans les cours familiales
Au large24 octobre 2022 | Lecture 1 min.

«Ça a commencé?»
Grand Angle19 octobre 2022 | Lecture 7 min.

[VIDÉO] Au fin fond des temps avec la compagnie Mossoux-Bonté
En chantier18 octobre 2022 | Lecture 1 min.

Cinéaste et thérapeute corporelle
Grand Angle14 octobre 2022 | Lecture 1 min.
épisode 18/18

Donner sa place au public
Au large12 octobre 2022 | Lecture 2 min.

Les Halles de Schaerbeek. Toute une histoire!
Émois5 octobre 2022 | Lecture 6 min.
épisode 4/4

Scénographe et maman
Grand Angle30 septembre 2022 | Lecture 2 min.
épisode 3/6

Un nouveau prix au Burkina Faso!
Au large28 septembre 2022 | Lecture 4 min.

La rétrospective Akira Kurozawa
En ce moment27 septembre 2022 | Lecture 1 min.

Il était une fois les effets spéciaux
Grand Angle20 septembre 2022 | Lecture 5 min.

Au festival Nourrir Bruxelles
18 septembre 2022 | Lecture 1 min.

Trouver un lieu pour y faire du théâtre
Grand Angle17 septembre 2022 | Lecture 1 min.

VIRUS-32. Les Variations Zombiques.
En ce moment10 septembre 2022 | Lecture 2 min.

Silent Night. Last Christmas?
En ce moment9 septembre 2022 | Lecture 2 min.

Éducatrice et maquilleuse
Grand Angle8 septembre 2022 | Lecture 1 min.
épisode 17/18

Megalomaniac. Vive l’enfer...
En ce moment3 septembre 2022 | Lecture 2 min.

Il est parti...
Émois31 août 2022 | Lecture 4 min.

Graphiste-illustratrice et plasticienne
Grand Angle14 août 2022 | Lecture 1 min.
épisode 16/18

Paradiso du Teatro delle Albe
Au large19 juillet 2022 | Lecture 4 min.

Accompagner plutôt que programmer
Grand Angle3 juillet 2022 | Lecture 7 min.

24h dans la vie du théâtre des Doms
En ce moment3 juillet 2022 | Lecture 3 min.

Circassienne, le saut dans le vide
Grand Angle3 juillet 2022 | Lecture 4 min.
épisode 3/3

Comédien et guide à l’Africa Museum de Tervuren
Grand Angle1 juillet 2022 | Lecture 1 min.
épisode 15/18

Un festival au grand jour
Au large5 juin 2022 | Lecture 3 min.

Compositrice-interprète et responsable de revue
Grand Angle1 juin 2022 | Lecture 1 min.
épisode 14/18

L'échec vu du public
En chantier28 mai 2022 | Lecture 3 min.
épisode 3/4

Même pas mort le répertoire
En ce moment2 mai 2022 | Lecture 2 min.

Amour et terreur
En ce moment1 mai 2022 | Lecture 1 min.

Fabienne Cresens
Grand Angle1 mai 2022 | Lecture 5 min.

De la musique à la danse de luttes
En ce moment21 avril 2022 | Lecture 1 min.

Marie Losier
18 avril 2022 | Lecture 1 min.

Les meilleurs sont les plus courts
18 avril 2022 | Lecture 1 min.

Comédienne et maman
Grand Angle15 avril 2022 | Lecture 1 min.
épisode 2/6

D'ici et d'ailleurs
En ce moment14 avril 2022 | Lecture 1 min.

Saxophoniste et importateur d'huile d'olive
Grand Angle11 avril 2022 | Lecture 2 min.
épisode 8/18

Aller au festival du podcast
4 avril 2022 | Lecture 2 min.

Comédien et formateur en entreprise
Grand Angle25 mars 2022 | Lecture 1 min.
épisode 7/18

Archipel
En ce moment23 mars 2022 | Lecture 4 min.

Une nuit à l'Union saint-gilloise
Émois7 mars 2022 | Lecture 13 min.
épisode 2/4

Les conditions extérieures à l’échec
En chantier1 mars 2022 | Lecture 4 min.
épisode 2/4

Échappatoire à la Saint Valentin
Émois14 février 2022 | Lecture 4 min.

Déboires assumés
En chantier31 janvier 2022 | Lecture 8 min.
épisode 1/4

Diriger un festival: à deux, c’est mieux
Grand Angle31 janvier 2022 | Lecture 7 min.

Un spectacle par ses costumes
En ce moment16 septembre 2021 | Lecture 5 min.