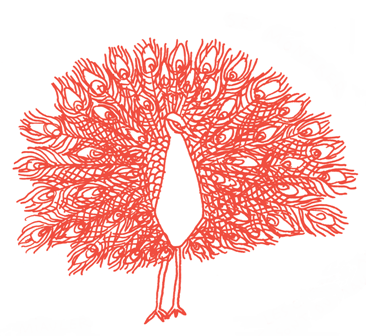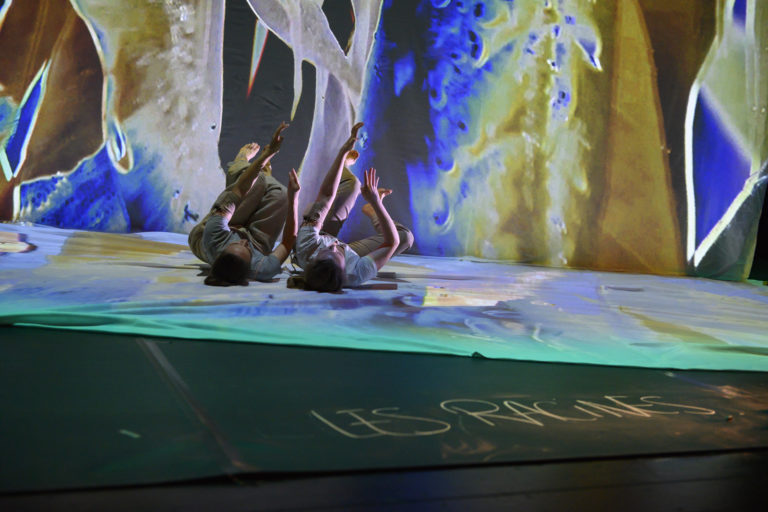Cinq spectacles québécois en rafale au FTA et au Carrefour
Au large30 juin 2023 | Lecture 13 min.
Il fut un temps lointain où l’on pouvait presque schématiser la scène québécoise en quelques traits. Un théâtre identitaire exaltant la langue française dans des écritures textocentristes aux dialogues ciselés, dans une langue vernaculaire locale rythmée. Un goût pour la narration et la pièce bien faite. Un jeu d’acteurs baignant dans une forte et sublime émotion. En danse, des chorégraphies conceptuelles et des corps virtuoses poussés à l’épuisement. Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts au fil des trois dernières décennies, mais peut-être atteignons-nous un point de diversité inégalé : la scène québécoise est plus multiple que jamais et résiste aux analyses croisées. C’est du moins le sentiment que j’ai eu en fréquentant cette année le FTA, à Montréal, et le Carrefour international de théâtre, à Québec.
À travers cinq spectacles, je remarque une diversité qui raconte la québécitude d’une manière ou d’une autre, et des formes théâtrales très distinctement populaires sur la scène québécoise, qui disent les épanchements esthétiques et les formes de récit chouchoutées par les artistes québécois, ainsi que quelques filiations et traditions locales réinventéees.
Quelles formes? Des narrations épiques et tragiques sur fond de symboles forestiers. Une pièce de Larry Tremblay sur le morcellement du corps – Tremblay en a fait un genre en soi! Du théâtre « neurodivergent » à la québécoise, dans la foulée du Back to Back theatre australien. Une pièce entièrement interprétée par une distribution noire, tendance actuelle de visibilisation des artistes afrodescendants. Et de la danse urbaine remixée à travers les codes de la danse contemporaine.
Anna, ces trains qui foncent sur moi, de Steve Gagnon

Commençons par ce spectacle certes très québécois, mais qui est aussi constitué d’une bonne dose de belgitude. La FACT Cie de Bruxelles – du comédien et metteur en scène Clément Goethals – est coproductrice de cette immense pièce de 3h50 pour 14 acteurs : des Québécois, des Français et des Belges (Salim Talbi, Julie Sommervogel et Clément Goethals lui-même). Vincent Goethals (le père de l’autre) est à la mise en scène. Il s’est d’ailleurs souvent mesuré à la dramaturgie de Steve Gagnon au Théâtre du Peuple de Bussang (dans les Vosges), ce théâtre populaire en plein-air qu’il a dirigé quelques années. Voilà pour les présentations.
Le nom de Steve Gagnon ne vous dit peut-être rien. Ou, si, peut-être avez-vous vu la pièce Ventre, mise en scène par Clément Goethals en 2019-2020 et présentée au Rideau de Bruxelles. Steve Gagnon, retenez-le, est un gros nom de la dramaturgie québécoise actuelle, dont les pièces racontent souvent un amour ardent et passionnel qui agit comme refuge, voire comme bouclier, devant un monde hostile et décevant. Au registre intimiste et romantique de ses pièces de jeunesse (Ventre en fait partie), il combine désormais des peintures sociales précises, racontant une certaine lutte des classes, tout en subtilités, souvent dans des décors sauvages qui se révèlent peu à peu chargés de symboles forestiers et d’onirisme. Une nature qui se réveille et qui révèle les personnages à eux-mêmes, les poussant à sortir de leur confort bourgeois.

Tous ces ingrédients sont présents dans Anna, ces trains qui foncent sur moi, une ambitieuse et très libre adaptation d’Anna Karénine, de Tolstoï. Gagnon y raconte la désillusion politique d’une certaine gauche caviar, campant les amours d’Anna au cœur d’un groupe de député.e.s idéalistes dont la politique a peu à peu usé les passions et les relations. Réunis à la campagne, ils et elles se confrontent à la résurgence de leurs conflits latents, puis peu à peu à une lutte des classes se jouant à l’intérieur de leur petit groupe. Et ce, sans négliger un propos fort sur l’amitié – houleuse mais tenace et sublime au fil des années qui passent et des crises qui la meurtrissent tout comme elles la renforcent.

Dans l’ampleur épique de la narration, il y a du Wajdi Mouawad. Dans la mise en scène qui réaménage souvent l’espace avec une seule table et quelque chaises, il y a des principes chers à Robert Lepage. Dans la poésie qui convoque forêts nordiques et animaux sauvages, il y a des traces d’autres auteurs dramatiques québécois, au premier rang l’incontournable Daniel Danis. Steve Gagnon est unique – mais il s’inscrit dans une forte filiation dramaturgique québécoise.
Des représentations en Belgique ne sont pas exclues au cours des prochaines saisons – même si rien d’officiel ne semble encore dessiné. Vous en aurez entendu parler ici en premier.
Tableau final de l’amour, de Larry Tremblay, mis en scène par Angela Konrad
Grand auteur dramatique québécois mais également romancier de réputation internationale, Larry Tremblay écrit depuis toujours sur le corps démembré et fragmenté, ou encore il invente des personnalités dédoublées ou démultipliées, lesquelles sont souvent métaphores d’une identité morcelée et fragile. Terrassés par une sexualité primitive et envahissante, ces corps sont aussi parfois triturés par les guerres qui font rage au dehors. Avec Tableau final de l’amour, c’est la première fois que l’une de ses œuvres est mise en scène par Angela Konrad, une artiste allemande qui a un peu pratiqué à Marseille avant de débarquer à Montréal au milieu des années 2000 pour y devenir une figure phare de la mise en scène québécoise. La rencontre est féconde.

Larry Tremblay écrit toujours sur le corps, disais-je. C’est manifeste dans cette pièce qui fut d’abord un roman, et qui fantasme la relation de Francis Bacon avec son amant George Dyer, modèle de ses peintures représentant des corps désarticulés, amas de viande tordue dans lesquels on reconnaît tout de même notre humanité profonde.

À travers leur relation crue et sauvage et par le prisme de cette vision du corps comme morceau de viande ou comme objet de désir animal, Larry Tremblay défend l’art de Bacon et dépeint comme sublime sa vision d’un art au-delà de toute morale, où la chair frissonnante et la violence du désir sont suprêmes.
Le corps est morceau de viande – mais l’auteur ne pose aucun jugement moral sur ces amas de chair putrides, vus comme purement jouissifs, et d’ailleurs racontés dans une langue d’une grande élégance.
La mise en scène d’Angela Konrad s’ancre dans ce même mouvement, insistant sur les mots délicieux de Tremblay en les faisant entendre dissociés du corps des acteurs Benoit McGinnis et Samuel Côté, en voix hors-champ enrobant leurs corps de plus en plus suants et emmêlés. Sur une scène qui restera presque toujours immaculée.

Voilà qui est important à une époque où l’art est de plus en plus souvent soumis à des regards moralisateurs, autant par des critiques de la droite religieuse que par une gauche radicale qui a le regard un peu tronqué (souvent pour de bonnes raisons, mais néanmoins avec des excès qui réduisent le champ des interprétations). Larry Tremblay a proposé à quelques reprises cette analyse dans les entrevues qu’il a accordées aux médias en marge des représentations. Cette vision m’est aussi apparue criante en tant que spectateur. Oui, se permettre encore aujourd’hui sur scène de représenter l’abject est important.

Le public belge s’est d’ailleurs posé des questions similaires au cours de la saison 2022-2023 en assistant à la mise en scène de Baal, de Berthold Brecht, par Armel Roussel. «À quoi sert-il de promouvoir sur scène les agissements d’un personnage qui se conduit à ce point comme un porc?», avaient demandé quelques militants et militantes le soir de la première au Varia. Parce que les porcs sont aussi des poètes et que le monde n’est pas si manichéen, avait-on envie de leur répondre. Le spectacle de Larry Tremblay et Angela Konrad vu à Montréal propose avec éloquence et sophistication une réponse proche.
Cispersonnages en quête d’auteurices, de Catherine Bourgeois

À Montréal, grâce à Catherine Bourgeois et à quelques autres artistes (par exemple Menka Nagrani) a émergé ces dernières années une fascinante génération d’acteurs et actrices neurodivergent.e.s, vivant avec des handicaps ou des déficiences intellectuelles. Depuis ses débuts, la metteuse en scène Catherine Bourgeois s’intéresse à la qualité de présence de ces acteurs et actrices et elle construit des pièces qui s’ancrent dans leur vision du monde, se positionnant en léger décalage avec les codes narratifs canoniques occidentaux.
La démarche peut s’apparenter à celle, bien connue, de l’Italien Pippo Delbono, mais le travail de Bourgeois n’en a pas l’emphase visuelle et préconise une approche davantage centrée sur la parole et sur une certaine simplicité au plateau. On pense aussi à l’Australien Bruce Gladwin, du Back to Back Theatre, avec qui le travail de Catherine Bourgeois est en véritable filiation. (La plus récente pièce de Gladwin était d’ailleurs également à l’affiche du FTA cette année, occasion pour le public de croiser les regards.)

Le FTA 2023 m’a permis de mesurer le chemin parcouru depuis quelques années par cette artiste dont le travail se complexifie. Dans Cispersonnages en quête d’auteurices, une adaptation très libre de Six personnages en quête d’auteur, de Pirandello, elle use de métathéâtralité pour plonger directement sa troupe dans des questionnements sur la notion de représentation, en confrontation avec leur handicap. Qui peut jouer qui? Peut-on tout dire? Est-ce éthique pour un acteur «traditionnel» de jouer un neuroatypique? Toutes les grandes questions éthiques de notre époque y passent : la notion de privilège, l’inclusivité, la cancel culture, l’appropriation culturelle. De la bonne matière à penser.
Cabaret Noir, de Mélanie Demers

L’an dernier, j’avais raté au FTA un événement majeur : M’appelle Mohamed Ali, la toute première production québécoise francophone entièrement interprétée par une distribution afrodescendante. Comme ça a été le cas dans d’autres sociétés occidentales, le Québec a pris conscience en accéléré ces dernières années du manque de représentativité de son théâtre et a pris les moyens de renverser la tendance, entrant dans l’ère de la visibilisation. Ça ne s’est pas fait sans cris et douleurs, notamment lors d’une polémique d’appropriation culturelle autour de SLAV, un spectacle de Robert Lepage et Betty Bonifassi sur les slave songs. Mais force est aujourd’hui de constater que la controverse a finalement positivement servi de prise de conscience et enclenché des actions concrètes pour visibiliser les acteurs afrodescendants et mieux raconter leurs histoires. Le quotidien Le Devoir nous apprenait ainsi cette semaine que sur l’ensemble du territoire québécois, « 21 % des metteurs en scène, auteurs et interprètes étaient issus de minorités visibles pour la saison 2022-2023. Cette proportion était de 14 % en 2018-2019 et de 9 % en 2017-2018. »
Certes, il reste encore du chemin à parcourir. Mais l’observateur de bonne foi n’a pas le choix de constater que le milieu des arts de la scène au Québec s’est emparé de cet enjeu avec promptitude. Ainsi, si j’avais raté à mon grand désarroi l’an dernier M’appelle Mohamed Ali, j’ai pu voir cette année au Carrefour international de théâtre de Québec ce qui constitue, sauf erreur, la deuxième pièce québécoise francophone entièrement interprétée par une distribution afrodescendante : Cabaret noir. Je précise « québécoise francophone », car les Anglo-Montréalais, eux, font depuis des décennies du théâtre avec des distributions noires, notamment des mises en scène de Shakespeare par le Black Theatre Workshop. C’est vraiment du côté francophone que le bât blessait…

Cabaret noir est d’ailleurs tout imprégné de culture québécoise, empruntant son titre et sa structure à une pièce légendaire du répertoire québécois des années 80, Cabaret Neiges Noires, qui édifiait une forme fragmentée et festive pour raconter une identité québécoise francophone en crise après le référendum perdu de 1980. L’intelligence de Mélanie Demers, mieux connue comme chorégraphe mais qui se risque à un spectacle purement théâtral cette fois-ci, est de proposer un miroir à cette identité blanche québécoise qui se disait malmenée en 1980, lui montrant qu’aujourd’hui, elle est bel et bien dominante devant des minorités visibles qui ont envie de raconter enfin leur point de vue et leurs histoires.

Tout autant célébration d’écrits glorifiant l’identité noire que représentation ironique de textes racistes ou d’œuvres parcourues de visions caricaturales de l’identité afro, Cabaret noir oscille entre fierté affichée et violence subie. James Baldwin et Aimé Césaire côtoient Othello et Tintin au Congo. Le résultat est inégal, mais nécessaire.
In My Body, de Crazy Smooth

Conjuguer danse urbaine et danse contemporaine : voilà une tendance qui est de moins en moins neuve et que l’on voit sur les scènes belges (notamment dans le travail de Julien Carlier) autant que sur les scènes québécoises, où, par exemple, le Rubberbanddance Group s’y consacre depuis plusieurs années. Le travail du chorégraphe Crazy Smooth est à ranger dans cette catégorie, certes, mais au contraire des autres qui, il faut bien l’avouer, travaillent davantage les codes du contemporain que ceux du breakdance, il m’a semblé que son spectacle In My Body avait réussi le contraire : amener les codes du battle de break dance sur une scène contemporaine sans trop les asservir ou les dompter.
Sur la scène du Monument-National de Montréal, c’est bien à un battle que nous assistons. La foule crie pour encourager son danseur préféré. Les interprètes rivalisent d’entrain à chaque nouvel émoi du public. Les chorégraphies sont serrées mais des moments d’improvisation percent souvent le ballet chronométré des corps virtuoses.

Et c’est à travers cette forme classique de breakdance, très peu trafiquée, que le spectacle érige doucement une réflexion sur le corps vieillissant du danseur bboy, pointant et questionnant une culture de performativité extrême qui survalorise la jeunesse dans le monde du breakdance. Nul besoin, pour Crazy Smooth, de surligner le propos : la simple cohabitation de danseurs jeunes et vieux est éloquente.
Un spectacle de bboying rafraîchissant.
Ainsi constatons-nous que la scène québécoise contemporaine, lieu de multiplicité, résiste à toute catégorisation. On ira voir à nouveau l’an prochain si la température de l’eau aura un peu changé.
Vous aimerez aussi

Comment j’ai renoué avec la scène québécoise en trois spectacles événementiels
Émois17 juin 2022 | Lecture 9 min.

Malaise dans la civilisation
Émois19 mai 2023 | Lecture 3 min.

Diriger un festival: à deux, c’est mieux
Grand Angle31 janvier 2022 | Lecture 7 min.

Trouble #13: Invocations et évocations
Grand Angle12 juin 2025 | Lecture 6 min.
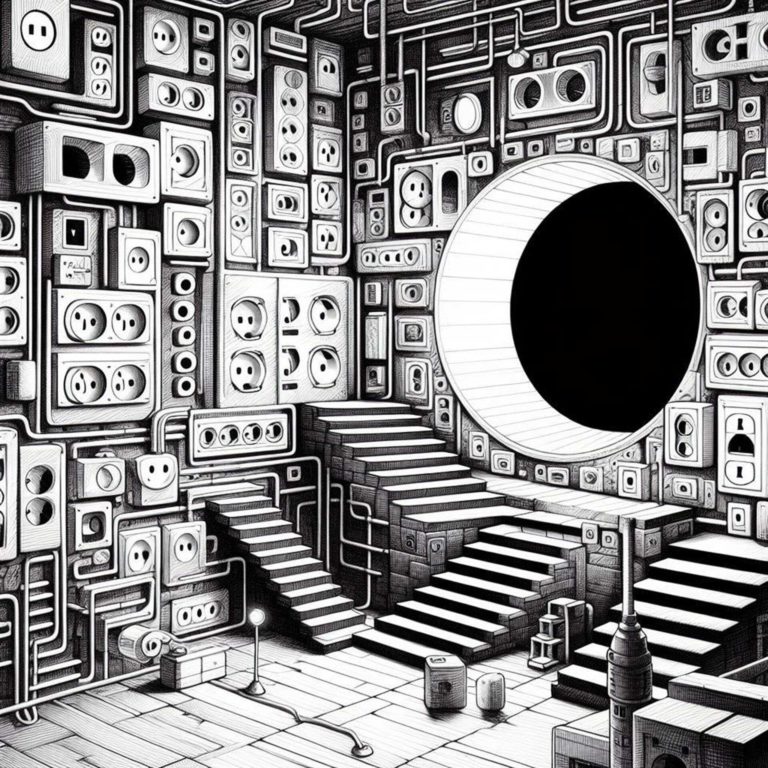
Simon Thomas & David Berliner
Grand Angle2 juin 2025 | Lecture 2 min.
épisode 5/5

KFDA, 30 ans
Grand Angle25 mai 2025 | Lecture 2 min.

Louise Vanneste, de la boîte noire au plein jour
Au large14 avril 2025 | Lecture 7 min.

Puissances seules
En ce moment11 mars 2025 | Lecture 2 min.

RAGE
En ce moment7 mars 2025 | Lecture 2 min.

Salutations Mistinguettes
En ce moment7 mars 2025 | Lecture 2 min.

Laurence Rosier et Emilienne Flagothier
Grand Angle12 février 2025 | Lecture 2 min.
épisode 3/5

Décloisonner l’opéra
En chantier6 février 2025 | Lecture 1 min.

Pierre Lannoy et Claude Schmitz
Grand Angle26 janvier 2025 | Lecture 2 min.
épisode 2/5

Les châteaux de mes tantes
En ce moment2 décembre 2024 | Lecture 2 min.

État du monde
En ce moment23 septembre 2024 | Lecture 2 min.

Brûler, autour de Lucy
En chantier12 septembre 2024 | Lecture 12 min.

Au Brass
En ce moment8 septembre 2024 | Lecture 3 min.

Extimité.s par Zéphyr
Émois20 août 2024 | Lecture 3 min.
épisode 3/4

Et si Hansel avait consenti à être cuit vivant
Émois11 août 2024 | Lecture 5 min.
épisode 2/4

Sandrine Bergot, cap sur les Doms
Grand Angle25 juillet 2024 | Lecture 2 min.

Les hauts et les bas d’un théâtre de crise climatique à Avignon
Grand Angle22 juillet 2024 | Lecture 9 min.

Juana Ficción, chronique d’une disparition
Émois20 juillet 2024 | Lecture 4 min.

[PODCAST] Louise Baduel dans les paradoxes de l'écologisme
En chantier6 juin 2024 | Lecture 2 min.
épisode 10/10

Quelle place pour la culture dans les partis?
Grand Angle1 juin 2024 | Lecture 12 min.

Le festival TB²
En ce moment31 mai 2024 | Lecture 3 min.

Théâtre au Vert
En ce moment31 mai 2024 | Lecture 2 min.

Nacera Belaza
En chantier28 mai 2024 | Lecture 2 min.

Idio Chichava au KFDA: découverte majeure
Émois19 mai 2024 | Lecture 5 min.

[PODCAST] KFDA 2024 L'art public selon Anna Rispoli
En chantier18 mai 2024 | Lecture 2 min.
épisode 2/2

[PODCAST] 13 ans de création aux Brigittines racontés dans un livre
En chantier3 mai 2024 | Lecture 1 min.
épisode 9/10

Louise Baduel et Michèle Noiret
En ce moment23 avril 2024 | Lecture 2 min.

[VIDÉO] COLLEUSES FÉMINISTES ET COLÈRE DANS L’ESPACE PUBLIC AU THÉÂTRE VARIA
En chantier11 avril 2024 | Lecture 1 min.

Tu l'as trouvé où, ce spectacle?
En ce moment19 février 2024 | Lecture 2 min.

Mutualiser… une (nouvelle) politique culturelle?
Grand Angle18 février 2024 | Lecture 4 min.

Janine Godinas
Grand Angle18 janvier 2024 | Lecture 1 min.

Cherche employé·e de bureau
Grand Angle19 décembre 2023 | Lecture 12 min.

Comment l'école broie les Kévin
Grand Angle13 décembre 2023 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] Théâtre et quartiers populaires avec Yousra Dahry
Grand Angle16 novembre 2023 | Lecture 2 min.

[PODCAST] Arco Renz et Danielle Allouma en spirales hypnotiques
En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.
épisode 8/10

[PODCAST] Chloé Beillevaire et Sabina Scarlat, bouffonnes en collants
En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.
épisode 7/10

[PODCAST] Karine Ponties au confluent du réalisme et de l'abstraction
En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.
épisode 6/10

[PODCAST] Le pouvoir des ondes sonores avec Marielle Morales
En chantier8 novembre 2023 | Lecture 1 min.
épisode 5/10

Sur la vieillesse au théâtre
Grand Angle30 octobre 2023 | Lecture 11 min.

Macbeth au Shakespeare’s Globe
Au large17 octobre 2023 | Lecture 3 min.

L’Amour c’est pour du beurre
En ce moment16 octobre 2023 | Lecture 2 min.

Prendre soin, par le théâtre aussi
En ce moment4 octobre 2023 | Lecture 1 min.

Danse Avec les Foules
En ce moment2 octobre 2023 | Lecture 1 min.

Hippocampe
En ce moment29 septembre 2023 | Lecture 2 min.

La sentinelle du sens
Grand Angle29 août 2023 | Lecture 1 min.
épisode 3/10

Théâtre au Vert: diversité, simplicité, sincérité
En ce moment19 août 2023 | Lecture 1 min.

Réhabilitons Welfare, le spectacle mal-aimé d’Avignon 2023
Émois3 août 2023 | Lecture 11 min.

Violence symbolique et agressions réelles
Émois28 juillet 2023 | Lecture 6 min.

À Avignon, Julien Gosselin nous a percutés
Émois23 juillet 2023 | Lecture 8 min.

Drame familial sur fond d'imaginaire décolonisé
Grand Angle17 juillet 2023 | Lecture 1 min.

Place aux narrations féministes
En ce moment13 juillet 2023 | Lecture 12 min.

Échappées urbaines
En ce moment12 juin 2023 | Lecture 2 min.

Garder l'enfance allumée
Grand Angle15 mai 2023 | Lecture 7 min.

Le KFDA commence fort avec Angela, a strange loop
Émois13 mai 2023 | Lecture 4 min.

Serge Aimé Coulibaly, danser ici et ailleurs
Au large28 avril 2023 | Lecture 1 min.

Créer ensemble dans la ville
Au large24 avril 2023 | Lecture 0 min.
épisode 6/6

Des forêts et des sardines
Grand Angle21 avril 2023 | Lecture 7 min.

[VIDÉO] Boucles infinies avec Arco Renz et Danielle Allouma
En chantier18 avril 2023 | Lecture 1 min.

Le collectif suisse BPM déploie son irrésistible «Collection»
Émois17 avril 2023 | Lecture 5 min.

[VIDÉO] Chloé Beillevaire et Sabina Scarlat, étonnantes «folles du roi»
En chantier12 avril 2023 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] L'ART SUBTIL DE LA RELAX PERFORMANCE AVEC SIDE-SHOW
En chantier30 mars 2023 | Lecture 1 min.

Indiscipline à Knokke!
En ce moment29 mars 2023 | Lecture 2 min.

[VIDÉO] LE BANAL SUBLIMÉ AVEC KARINE PONTIES
En chantier20 mars 2023 | Lecture 2 min.

[VIDÉO] Entre l'audible et l'invisible avec Marielle Morales
En chantier15 mars 2023 | Lecture 1 min.

Ces paroles qui nous rassemblent
Grand Angle7 mars 2023 | Lecture 1 min.
épisode 2/10

Carte noire nommée désir
Émois20 février 2023 | Lecture 4 min.
épisode 7/15

Rabelais revient à la charge
Grand Angle18 février 2023 | Lecture 1 min.
épisode 1/10

Tervuren
En chantier13 janvier 2023 | Lecture 4 min.

La puissance des langues vernaculaires
Au large15 novembre 2022 | Lecture 2 min.

Méduse.s par le collectif La Gang
Grand Angle11 novembre 2022 | Lecture 10 min.
épisode 2/3

Que nos enfants soient des géants
Au large7 novembre 2022 | Lecture 1 min.

Créer pour faire advenir le female gaze
Grand Angle27 octobre 2022 | Lecture 6 min.
épisode 1/3

Déplacer l’espace du théâtre dans les cours familiales
Au large24 octobre 2022 | Lecture 1 min.

Donner sa place au public
Au large12 octobre 2022 | Lecture 2 min.

[VIDÉO] En immersion avec Tumbleweed aux Brigittines
En chantier1 octobre 2022 | Lecture 1 min.

Un nouveau prix au Burkina Faso!
Au large28 septembre 2022 | Lecture 4 min.

Trouver un lieu pour y faire du théâtre
Grand Angle17 septembre 2022 | Lecture 1 min.

Still Life fait régner le théâtre sans paroles à Avignon
Grand Angle23 juillet 2022 | Lecture 1 min.

Koulounisation de Salim Djaferi
En ce moment16 juillet 2022 | Lecture 1 min.

Circassienne, le saut dans le vide
Grand Angle3 juillet 2022 | Lecture 4 min.
épisode 3/3

Un festival au grand jour
Au large5 juin 2022 | Lecture 3 min.

«T’inquiète pas, je te rattrape»
Grand Angle30 mai 2022 | Lecture 4 min.
épisode 2/3

L'échec vu du public
En chantier28 mai 2022 | Lecture 3 min.
épisode 3/4

Démontage du chapiteau patriarcal
Grand Angle10 mai 2022 | Lecture 6 min.
épisode 1/3

Gestionnaire le matin et artiste l'après-midi
Grand Angle9 mai 2022 | Lecture 1 min.

La fascination du mal
En ce moment1 mai 2022 | Lecture 1 min.

Guyane, Liban, Iran, Japon...
En ce moment1 mai 2022 | Lecture 1 min.

Archipel
En ce moment23 mars 2022 | Lecture 4 min.

Acteur et plombier/chauffagiste
Grand Angle28 décembre 2021 | Lecture 1 min.
épisode 2/18

Diriger un théâtre: un geste politique
Grand Angle28 décembre 2021 | Lecture 2 min.

Un spectacle par ses costumes
En ce moment16 septembre 2021 | Lecture 5 min.