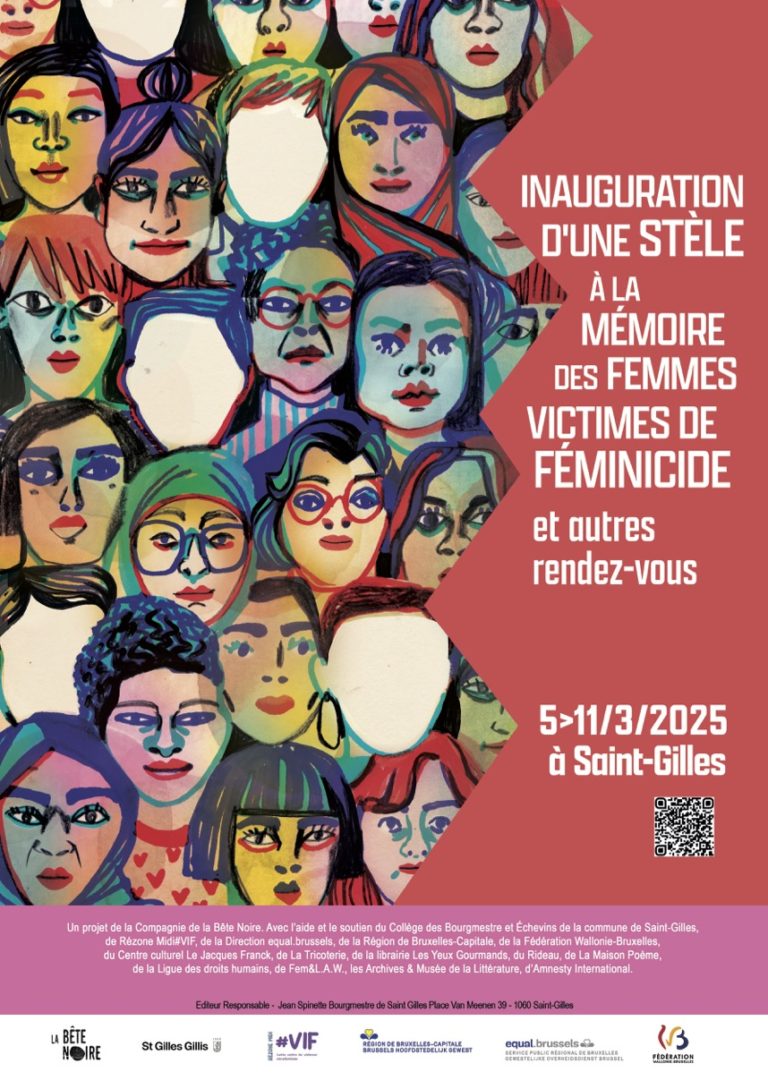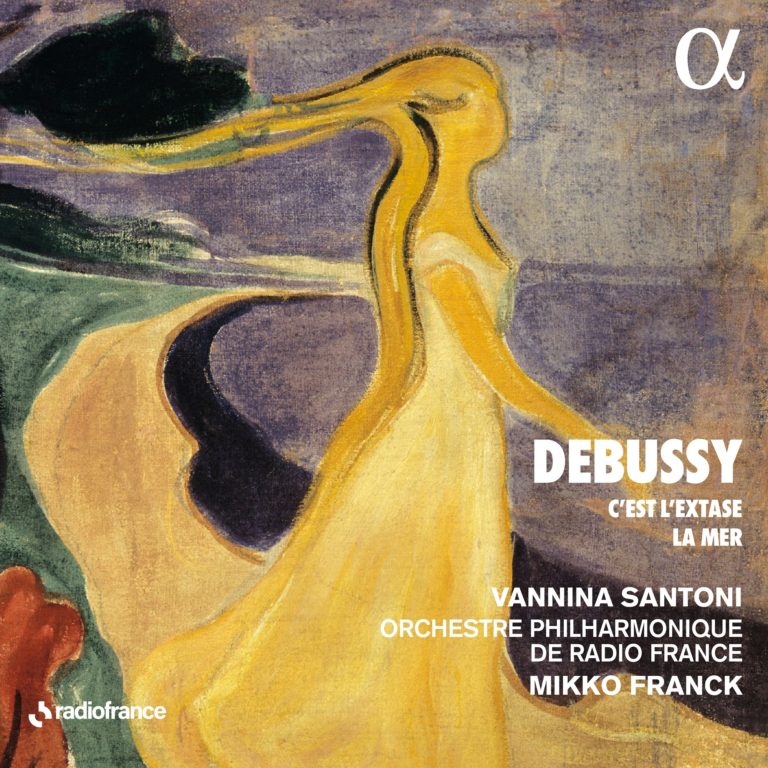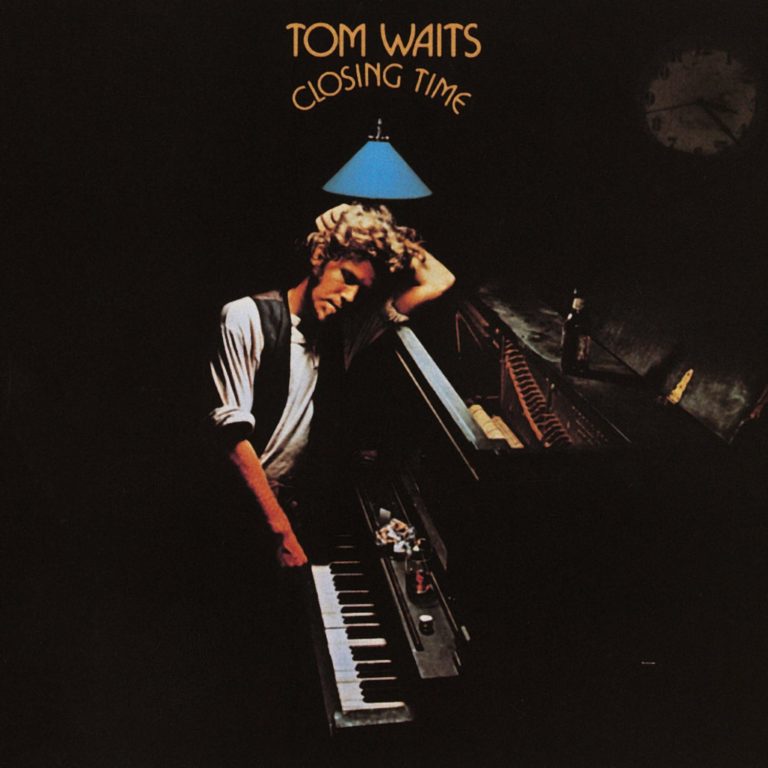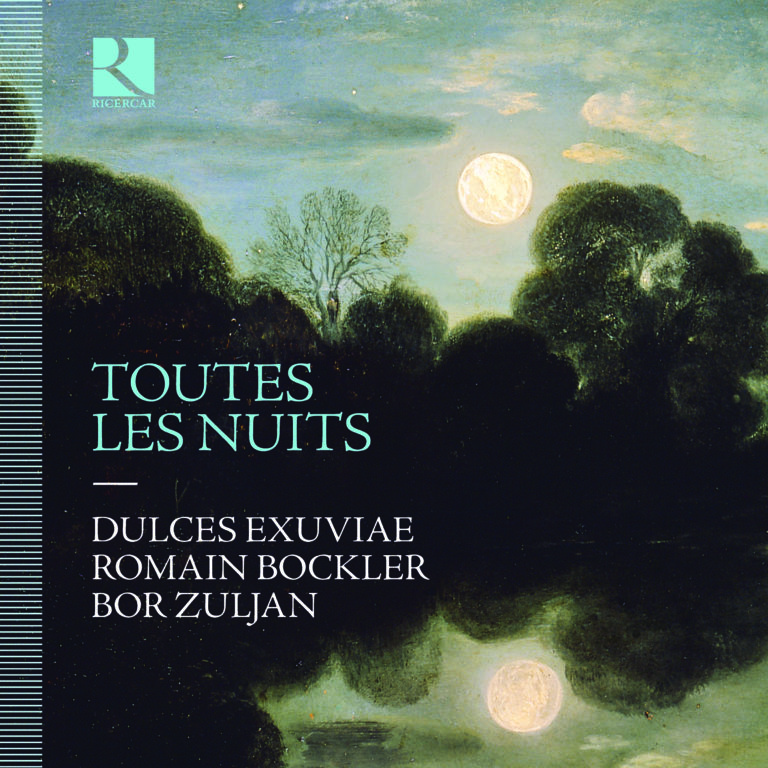Dadastrof, une aventure musicale dadaïste
Grand Angle20 juin 2023 | Lecture 6 min.
Shaya Feldman a d’abord fait les choses sérieusement: il a commencé la contrebasse, un instrument sérieux, à douze ans. Il a poursuivi ses études dans des écoles sérieuses: la prestigieuse Jerusalem Academy of Musice and Dance, où il a obtenu son diplôme de licence. À dix-neuf ans, au cours de son master au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, il a découvert le mouvement Dada, et il s’est demandé si, en fin de compte, il n’était pas temps d’envoyer un peu valser tout ce sérieux. «Quand le prof a parlé des Dadaïstes», raconte-t-il, «c’est comme s’il parlait de moi».
La rencontre avec Dada et les avant-gardes du début du XXᵉ siècle a été «une libération»: d’abord en ouvrant une brèche dans les codes sociaux si sérieux du monde de la musique classique, les Dadaïstes ayant cultivé le goût du jeu, de la provocation et de la dérision. Un «état d’esprit» qui a fortement résonné avec les interrogations du musicien – et l’ennui qui le guettait dans le monde classique.
Car même au sein des orchestres les plus prestigieux – il a joué, entre autres, avec l’Opéra de Paris –, il ne s’est jamais tout à fait trouvé à sa place: pourquoi une telle hiérarchie entre les musiciens de l’orchestre? Pourquoi faudrait-il forcément porter des cravates à l’opéra? «Le jeu, c’est quelque chose qu’on a un peu oublié dans la musique classique», regrette-t-il: «jouer de la musique, jouer comme des enfants, jouer du théâtre, c’est le même mot. À l’origine de l’opéra, par exemple, tout le monde chantait avec les solistes, c’était un peu la telenovela d’aujourd’hui. Il n’y avait pas la télé, les gens applaudissaient quand ils le voulaient parce que c’était tellement naturel. Alors que maintenant, il ne faut plus applaudir entre les mouvements, il faut être habillé d’une certaine manière…».
Révélation Dada
Si la révélation Dada a incité Shaya Feldman à briser les codes, elle a aussi ouvert une infinité de fenêtres pour sa création. Car à la manière dont Marcel Duchamp a fait trembler la définition de l’art en exposant un trivial urinoir au musée, d’autres artistes ont, à la même époque, questionné les limites de la musique. Plusieurs décennies avant John Cage, rappelle Shaya, Alphonse Allais ou Erwin Schulhoff ont ainsi chacun écrit des pièces musicales silencieuses, Marche funèbre pour les funérailles d’un grand homme sourd (1897) et In Futurum (1919).
Et bien avant la musique dite concrète, poursuit-il, quand Pierre Henry s’exerçait à jouer de la porte, les avant-gardes du début du XXᵉ siècle ont cherché à rendre compte musicalement de la vie quotidienne, matérielle, corporelle: par exemple, dans la Sonata Erotica d’Erwin Schulhoff, composée en 1919, une femme chante un orgasme. Éric Satie qui annote ses compositions avec des commentaires du type «à jouer comme chez le dentiste», Picabia qui brouille les limites entre le spectacle et la pause avec Entr’acte, film de René Clair diffusé pendant l’entracte de son ballet Relâche: tous ces artistes, pas tous musiciens, passionnent Shaya parce qu’ils ont révolutionné la musique dans toutes ses dimensions – de sa production à sa réception. Éric Satie, particulièrement cher à son cœur, est selon lui le «père de la musique d’ascenseur, la musique que tu entends mais que tu n’écoutes pas. Avant la radio, quand quelqu’un écoutait de la musique, il l’écoutait vraiment.», note-t-il. Et de conclure: «Finalement, se poser la question: qu’est-ce que la musique dada, c’est se demander: qu’est- ce que la musique ?».
S’inspirer des Dadaïstes, c’est plonger au moyen de la musique au ras du monde, épouser son mouvement désordonné, tout en se libérant des contraintes qui régissent la composition et la narration musicale. Shaya Feldman l’admet volontiers: «C’était mon point faible quand je composais pendant mes études: les profs me complimentaient sur les sujets que je proposais, mais je ne les menais pas jusqu’au bout. Je bifurquais, il manquait le développement. Grâce à Dada, par exemple avec Kurt Schwitters, je me suis rendu compte que je pouvais procéder par collage: une sorte de flux des idées où il n’y a pas toujours une structure, début, milieu, fin. Comme dans la vie.»
L’énergie de l’urgence
De retour en Israël après son passage à Paris, en 2011, le musicien a très vite partagé son éblouissement dadaïste en fondant Dadastrof, un collectif interdisciplinaire, à mi-chemin entre la musique, la performance et le théâtre – les Dadaistes eux aussi existaient par le groupe et par le mélange des pratiques, tout comme d’autres artistes du XXᵉ siècle qu’il trouve inspirants. Mauricio Kagel, par exemple, «chez qui il y a un mélangeartistique, entre le théâtre et la musique,la musique devenant le sujet théâtral», s’enthousiasme-t-il.
On sent bien, en l’écoutant, qu’avec Dadastrof, ils se sont beaucoup amusés. La spontanéité de Dada, l’élan des possibles qui en découle – «Ils étaient dans le café en train d’écrire sur un bout de mouchoir et le lendemain ils jouaient ça au Cabaret Voltaire» –, tout cela résonne particulièrement en Israël, analyse Shaya Feldman. Une société marquée, comme l’époque dadaïste, par une conscience aiguë de l’imprévisible, menacée par la possibilité que tout explose ou s’arrête soudain: «En Israël, où on pourrait dire en exagérant qu’on ne sait jamais qui va mourir et comment, tout est plus immédiat.»
Imprégnés par cette énergie de l’urgence, les membres de Dadastrof (Eynat Mazor, Elika Lascar Feldman, Mario Bitencourt, Ayala Shamir, Gal Levi, Myriam Ron Roth) ont beaucoup joué – le contrebassiste, qui a grandi entre trois langues, aime ce double sens de «play», où la musique rencontre le plaisir de l’enfance.
Et d’ailleurs, l’aventure du collectif a commencé comme une blague: Shaya Feldman a contacté, Honi HaMe’agel, un performeur connu du micro univers dadaïste en Israël, qui lui a demandé s’il avait un projet à présenter pour un festival. «Oui bien sûr, j’ai un groupe» a répondu Shaya Feldman – qui n’en avait pas, mais s’est empressé de réunir autour de lui des amis pour créer en une ou deux semaines le spectacle de ce groupe déjà annoncé. «Ne pas avoir peur du mensonge», encore une leçon de Dada: eux qui, se souvient le contrebassiste, avaient fait croire à la présence de Charlie Chaplin à une soirée du Salon des Indépendants pour faire salle comble, un jour de février 1920.
La collaboration avec Honi HaMe’agel a mené le groupe à se produire dans des salles importantes et à se rapprocher du monde du théâtre, moins connu de Shaya Feldman. Trois ans d’inventivité débridée, traversés par le plaisir de la transformation et du faire-semblant: «je préfère le masque au maquillage», dit timidement Shaya, pour qui la scène a été l’espace où dépasser ses limites – oser jouer nu, en robe, masqué, travesti. Une audace alliée à une volonté de transgresser et de subvertir, dans une société et surtout une ville – Jérusalem – très imprégnées de conservatisme et de tabous, notamment religieux. «Évidemment, ça n’a pas le même sens de jouer nu à Jérusalem, où il n’y a pas de représentation de nus humains, pas de statue de nus, où les images de nudité auxquelles ont accès les gens viennent principalement du porno».

L’arrivée en Belgique en 2015, où la présence des corps nus sur scène est presque un cliché de la danse ou du théâtre contemporains, a quelque peu atténué cette nécessité de la provocation. Mais elle n’a en rien altéré l’envie de jouer, au contraire. À Bruxelles, cette année, Shaya a retrouvé Myriam Ron Roth, qu’il connaît depuis la petite enfance – c’est la meilleure amie de sa mère.
Si elle chante depuis longtemps, Myriam vient plutôt du monde du théâtre. Dès la première expérience de Dadastrof en Israël, elle a aimé le mélange de jeu et de rigueur, de liberté et de construction. À Bruxelles, où elle est revenue récemment, elle a retrouvé avec bonheur son compagnon de jeu. Ensemble, ils ont remonté Dadastrof, sous la forme d’un duo chant-contrebasse, proche de l’esprit du cabaret, qui creuse encore le sillon dadaïste. L’expérimentation est au cœur du travail, et Myriam se plaît à parler de ce qui n’est pas décidé, ce qui hésite encore, ce qui se cherche au fil des répétitions et des concerts.
L’expérimentation est au cœur du travail, et Myriam se plaît à parler de ce qui n’est pas décidé, ce qui hésite encore, ce qui se cherche au fil des répétitions et des concerts. Dans leurs morceaux et leurs performances, à la mise en scène travaillée, on retrouve l’art du collage, l’attachement au bizarre et à l’absurde, combinés à une générosité et une curiosité sans borne qui les pousse à explorer sans entrave la matérialité du son et des instruments. Dadastrof fait ce qu’il veut, toujours, avec une fantaisie poétique qui évite la posture d’artiste-expérimental-sophistiqué-pour-niche-initiée. Qu’ils interprètent des poèmes de Hezy Leskly, poète israélien mort dans les années 1990, ou que Shaya fasse résonner le nom des intervalles musicaux tout en les jouant, dans un puissant flot d’onomatopées qui nous happe, on n’a pas besoin de comprendre pour être touché.
L’amour du charabia
Car Myriam, qui chante, a certes un talent unique pour l’interprétation et la narration, mais aussi pour imiter des accents et des langues. Et si on ne comprend pas, c’est parce que Myriam et Shaya chantent essentiellement en charabia – gibberish ou gibbering, en anglais – l’une des passions de Shaya. Le charabia, là encore, c’est la zone où le sérieux – la langue, avec sa rigueur, sa structure, ses règles – glisse vers le jeu, vers le faux, vers le n’importe quoi, attrapant la question du sens par le non-sens. Le charabia est double, à l’instar des deux mots qui le désignent en anglais: d’un côté, le gibbering, qui vient de gibber (parler de manière inarticulée) ou de jabber (parler rapidement), ce sont des sons indéfinis, qui «émergent de l’intuition et opèrent sans filtre, parfois même hors du contrôle».
En ce sens, il précède le langage, en tant qu’organisation logique de mots et de pensées, explique Shaya Feldman, expert en charabia – il a même commencé une thèse de doctorat en recherche artistique sur ce sujet à l’Université de Leiden. D’un autre côté, le gibberish, c’est le produit de cette performance parlée qu’est le gibbering: un langage imaginaire, où le non-sens vocalisé se mue en illusion de discours cohérent. Un «trompe l’oreille», pour reprendre le mot de Michel de Certeau, qui va du sindarin de Tolkien au faux allemand de Chaplin dans Le dictateur. Ce qui fascine Shaya Feldman dans le charabia, c’est cette zone floue qui va du non langage au langage alternatif, et de la blague au mystère mystique – le «parler en langues» biblique, c’est bel et bien du charabia.
Les Dadaistes, encore eux, ont aussi aimé le charabia, à l’instar de Kurt Schwitters, avec son Ursonate: une sonate d’une vingtaine de minutes, composée selon les règles du genre, mais avec du charabia plutôt qu’avec des notes. «Essayer de l’apprendre par cœur», se souvient Shaya, «c’était une challenge et je me suis rendu compte que pour moi, c’était beaucoup plus facile de parler en charabia qu’en langue normale. C’est comme un masque, et quand tu as un masque tu peux être beaucoup plus libre, beaucoup plus ridicule et te donner à fond.».
Écrire en charabia renvoie à l’expérience primitive du son dont nous sommes tous, même avec nos langages appris et sophistiqués, des praticiens instinctifs. «En s’affranchissant du sens, la langue devient une pure matière sonore», décrit-il: le charabia élargit le champ de la musique et du son, dans le sillage des avant-gardes qui ont approfondi l’expérience de la musique en s’intéressant au silence ou au bruit.
Ni tout à fait soi, ni tout à fait un autre

Et le choix de ces langues impossibles, inventées, approximatives, trace un chemin vers l’inaccessible accessible qu’est le monde mental de celui qui ne parle pas notre langue. Accessible parce qu’on peut l’imiter, l’approcher, en toute liberté, comme un autre praticien du son:» Avec les fausses langues, on peut imaginer qu’on parle plein de langues, ça devient un voyage». «Les gens comprennent, acceptent, apprécient le mélange de langues», constate Myriam: «ils y croient», parce que «quand tu fais quelque chose à fond, les gens y croient».
Jouer, faire semblant, pour devenir un peu l’autre, en n’étant ni tout à fait soi, ni tout à faut un autre: un déplacement salutaire à l’époque où il semble si sensible, voire parfois si menaçant de sortir de l’»identité» supposée être la nôtre. Car le charabia, les accents, dit Myriam, interrogent précisément tout cela: «c’est quoi l’identité, c’est quoi parler une langue, être citoyen d’un pays ?». La fluidité imaginaire de Dadastrof vient aussi d’une expérience de l’altérité en soi, peut-être proprement juive: «mon père parle sept langues et ses parents étaient sourds», raconte Shaya – en Israël, il est fréquent d’être ainsi lié à plusieurs langues.
Se mettre à l’écoute des éclats sonores du monde
Composer, chanter en charabia, c’est ainsi se mettre à l’écoute des éclats sonores du monde, ceux qu’on ne comprendra jamais, mais qui nous racontent mystérieusement des choses que l’on saisit en secret. À un endroit de soi qu’on partage avec d’autres, comme dans la performance de Dadastrof à la Vieille Chéchette, à Saint-Gilles, en mars dernier. Une fois la porte poussée, c’est d’abord un univers déroutant qui se déploie: à quel repère nous accrocher entre ces langues inconnues, ces jeux sonores étranges? On reste un instant sur le bord, jusqu’à ce que la musique et le monde de Dadastrof nous enveloppent et nous baignent. Alors nous y flottons, bienheureux, et ensemble. Car sans saisir le sens de ce qui se raconte, le public attentif rit aux mêmes moments, comme s’il comprenait. Par quel mystère magique? On ne sait pas bien, mais dans l’intimité du bar, un drôle de murmure commun passe entre les gens, et nous réchauffe.
Vous aimerez aussi

«Jouez, jouez, jouez!»
Au large30 janvier 2022 | Lecture 10 min.

Même pas mort le répertoire
En ce moment2 mai 2022 | Lecture 2 min.

Hormur: une plateforme pour créer dans des lieux insolites
En chantier15 mai 2023 | Lecture 1 min.

Diriger un festival: à deux, c’est mieux
Grand Angle31 janvier 2022 | Lecture 7 min.

Mohamed El Khatib & Nathalie Zaccaï-Reyners
Grand Angle16 juillet 2025 | Lecture 2 min.
épisode 6/7

Voir la mer et survivre
Émois8 juillet 2025 | Lecture 4 min.

Toute une ville captivée
Au large5 juillet 2025 | Lecture 1 min.

De l’exil et de la censure
Grand Angle24 mai 2025 | Lecture 2 min.

Décloisonner l’opéra
En chantier6 février 2025 | Lecture 1 min.

Féeriques marionnettes
En ce moment7 janvier 2025 | Lecture 2 min.

Musique Femmes Festival
En ce moment9 octobre 2024 | Lecture 2 min.

Brûler, autour de Lucy
En chantier12 septembre 2024 | Lecture 12 min.

Au Brass
En ce moment8 septembre 2024 | Lecture 3 min.

Art et migration
Grand Angle2 septembre 2024 | Lecture 2 min.

Saravah
En ce moment21 août 2024 | Lecture 2 min.
épisode 5/16

Les Rencontres Inattendues
En ce moment1 août 2024 | Lecture 2 min.

Sandrine Bergot, cap sur les Doms
Grand Angle25 juillet 2024 | Lecture 2 min.

Juana Ficción, chronique d’une disparition
Émois20 juillet 2024 | Lecture 4 min.

La Llorona
En ce moment15 juillet 2024 | Lecture 1 min.

Second souffle
En chantier18 avril 2024 | Lecture 1 min.

La semaine du son
En ce moment21 janvier 2024 | Lecture 2 min.

Danse Avec les Foules
En ce moment2 octobre 2023 | Lecture 1 min.

Initier au matrimoine littéraire
En chantier25 août 2023 | Lecture 5 min.

Depuis que tu n’as pas tiré
En ce moment24 mai 2023 | Lecture 2 min.

Le Brussels Jazz week-end
En ce moment24 mai 2023 | Lecture 2 min.

«Collision» et ça repart!
En ce moment24 mai 2023 | Lecture 2 min.

Des forêts et des sardines
Grand Angle21 avril 2023 | Lecture 7 min.

Guitariste et maman
Grand Angle8 avril 2023 | Lecture 2 min.
épisode 4/6

Okraïna Records fête ses dix ans!
Grand Angle17 janvier 2023 | Lecture 1 min.

Okraïna Records 10 years party
En ce moment17 janvier 2023 | Lecture 1 min.

Morel, c’est quelqu’un!
Grand Angle10 janvier 2023 | Lecture 1 min.

IL ÉTAIT UNE FOIS LES EFFETS SPÉCIAUX
Grand Angle23 décembre 2022 | Lecture 10 min.

Les Blackout sessions
En ce moment27 septembre 2022 | Lecture 1 min.

Compositrice-interprète et responsable de revue
Grand Angle1 juin 2022 | Lecture 1 min.
épisode 14/18

«Désir ou amour, tu le sauras un jour.»
Émois18 mai 2022 | Lecture 1 min.
épisode 3/3

Rockeur et traducteur
Grand Angle13 mai 2022 | Lecture 1 min.
épisode 11/18

«Faut pas dire à qui je ressemble, faut dire qui je suis.»
Émois21 avril 2022 | Lecture 1 min.
épisode 2/3

Exercice d’admiration
Émois3 avril 2022 | Lecture 1 min.

Archipel
En ce moment23 mars 2022 | Lecture 4 min.

Quand la musique enterre le bruit des bombes
Au large21 mars 2022 | Lecture 10 min.

Une nuit à l'Union saint-gilloise
Émois7 mars 2022 | Lecture 13 min.
épisode 2/4

Les conditions extérieures à l’échec
En chantier1 mars 2022 | Lecture 4 min.
épisode 2/4
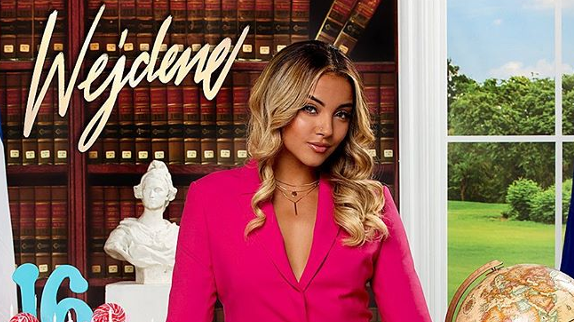
«L'amour c'est compliqué, les sentiments sont profonds.»
Émois14 février 2022 | Lecture 1 min.
épisode 1/3

Déboires assumés
En chantier31 janvier 2022 | Lecture 8 min.
épisode 1/4

À l’ami à la vie !
Grand Angle25 janvier 2022 | Lecture 2 min.