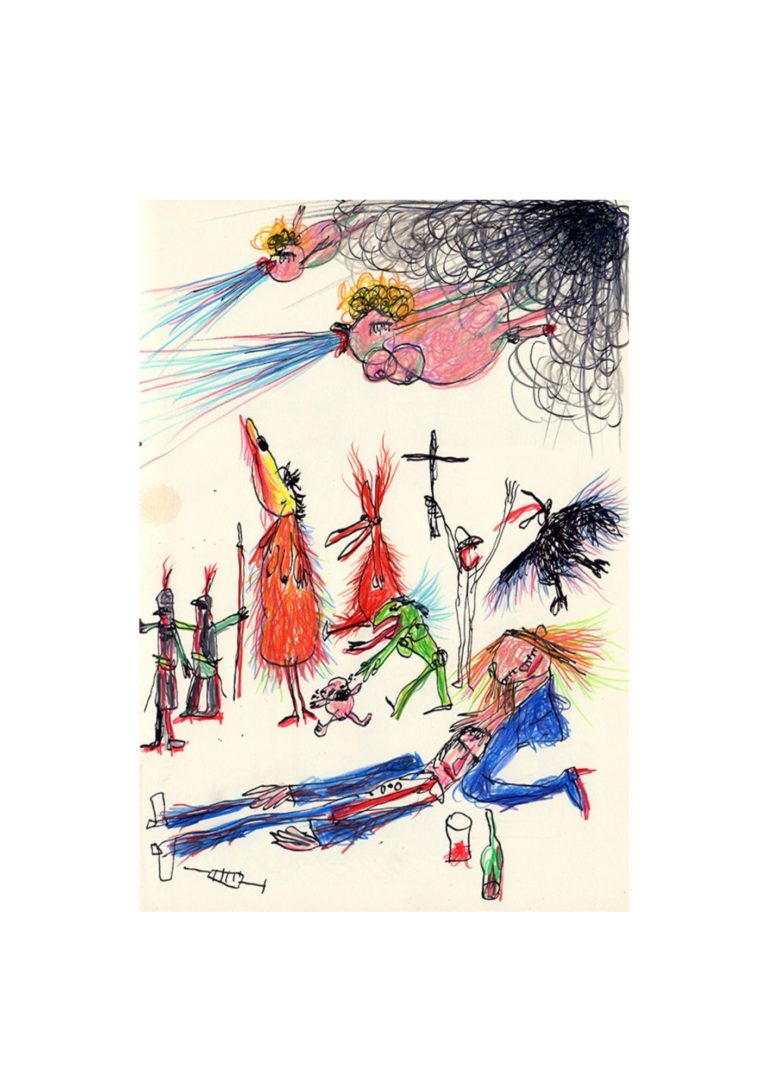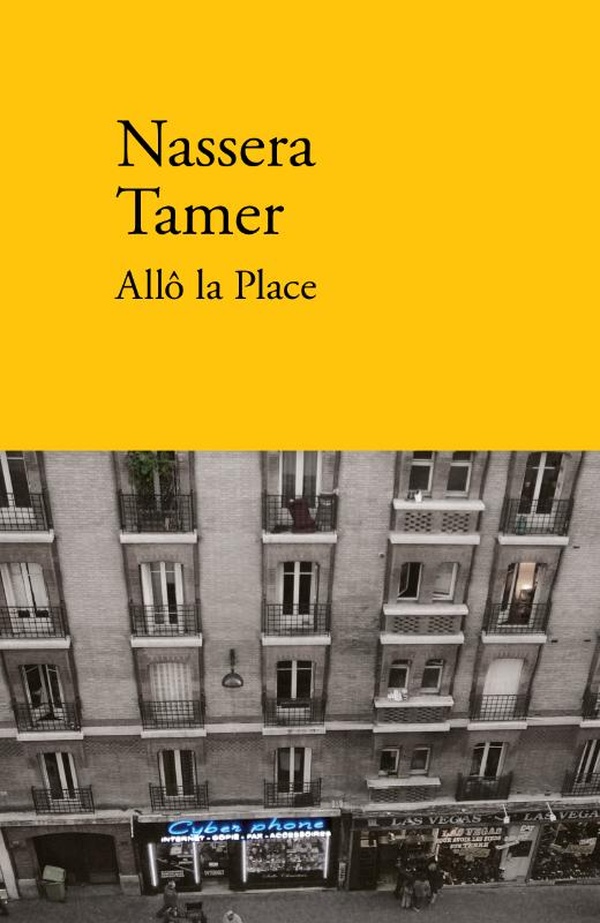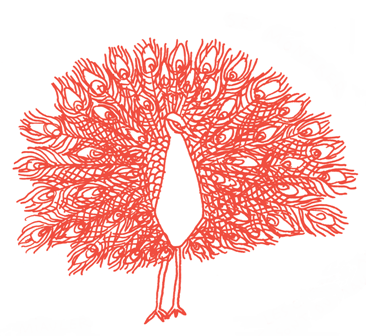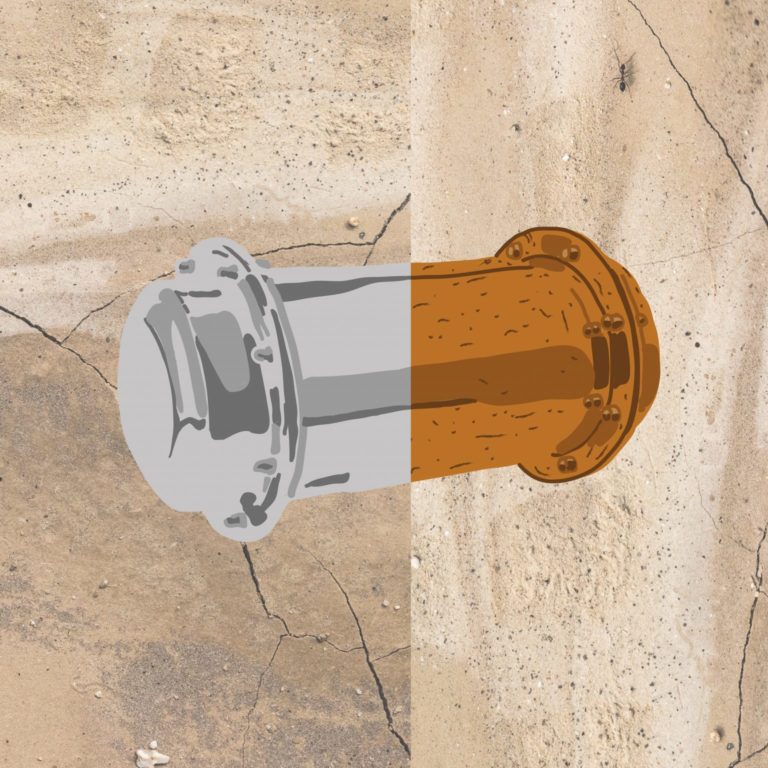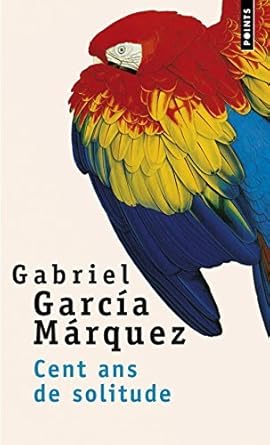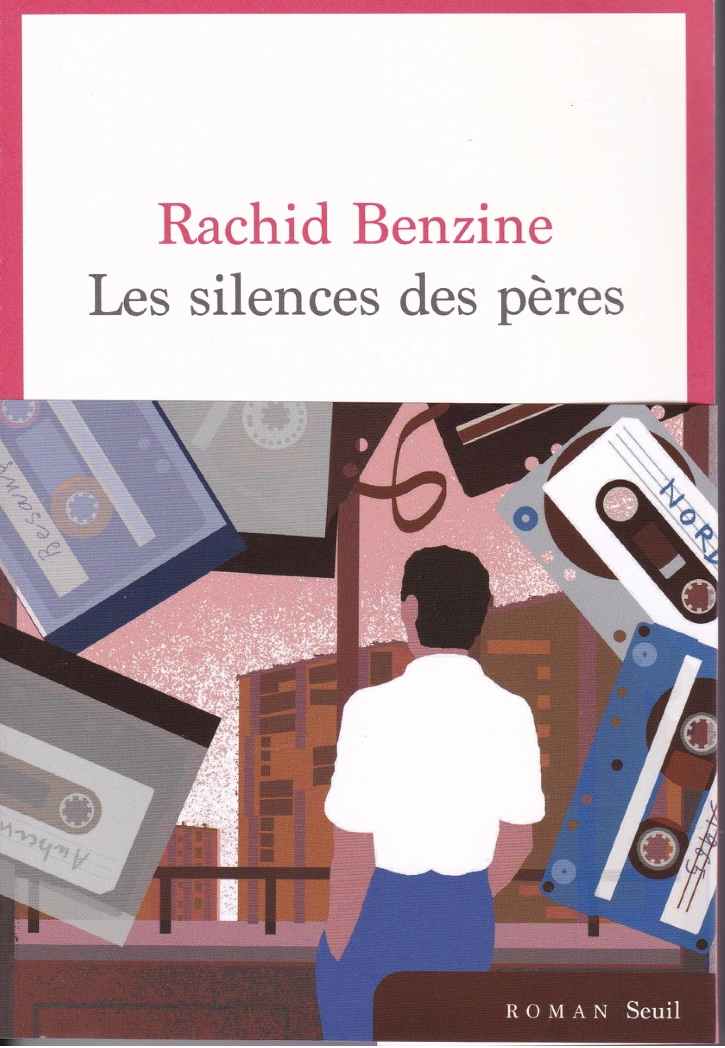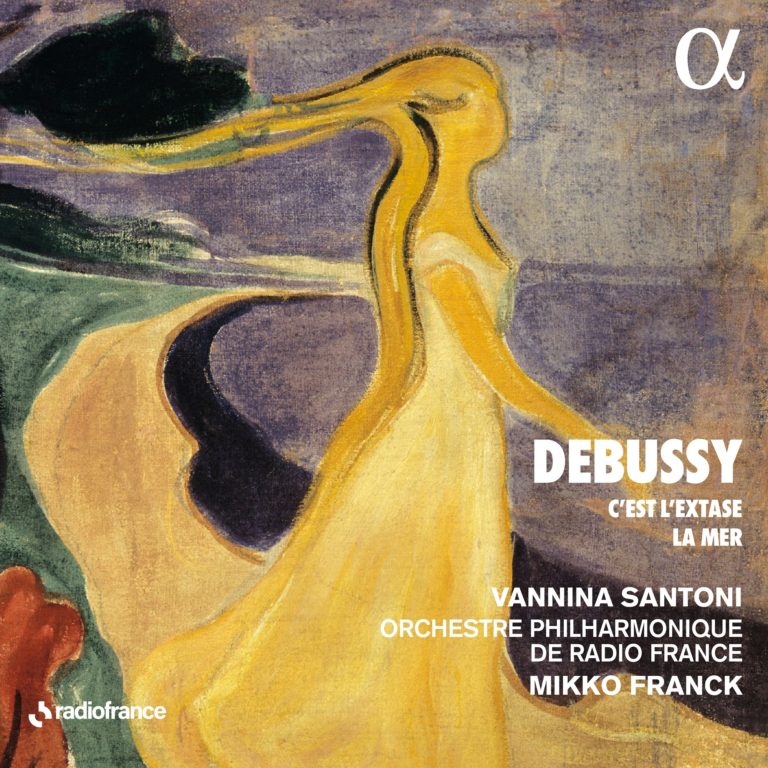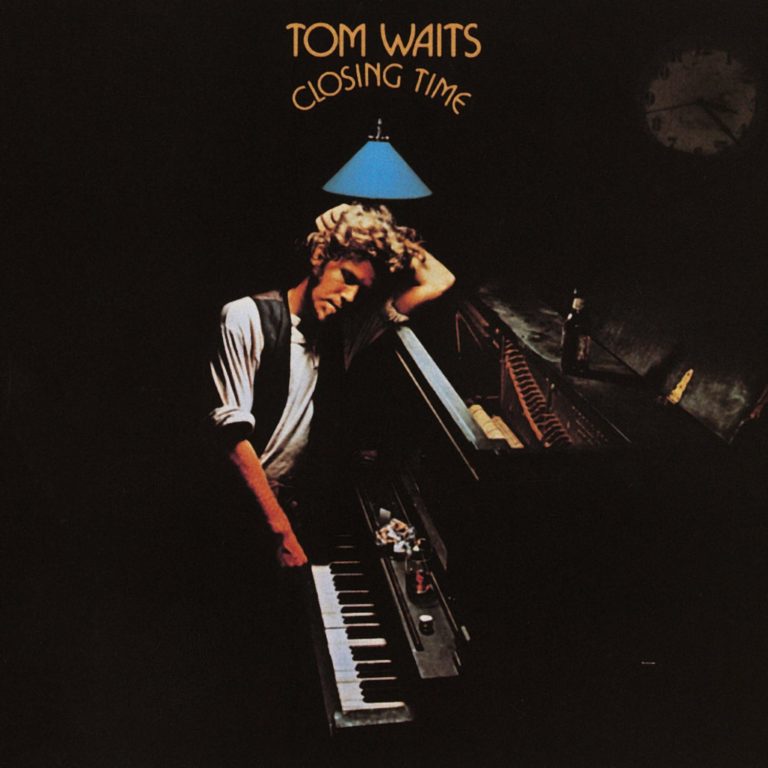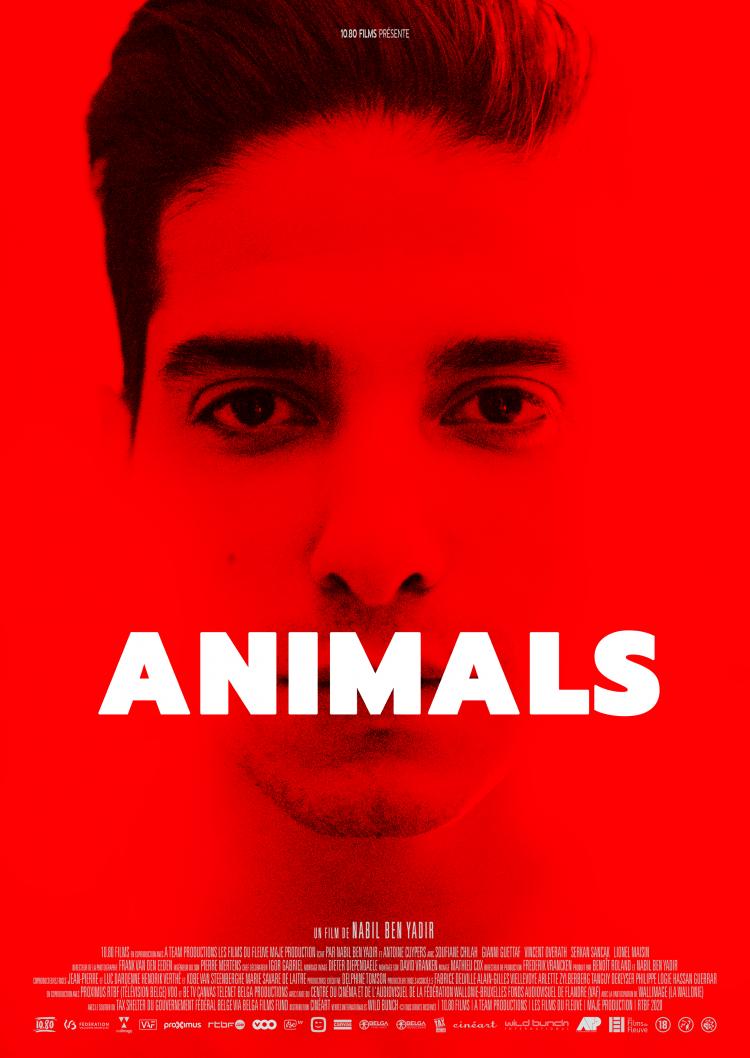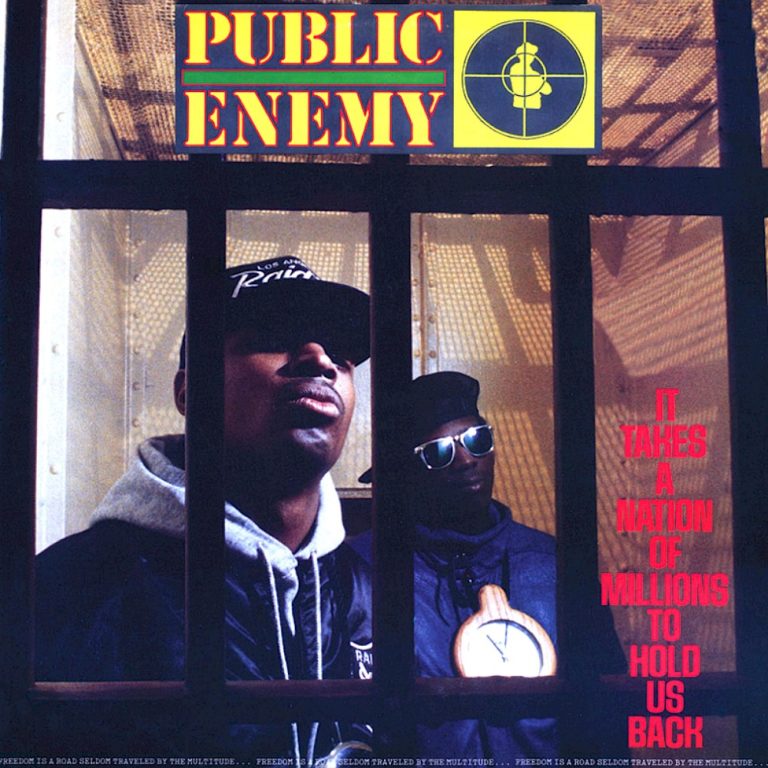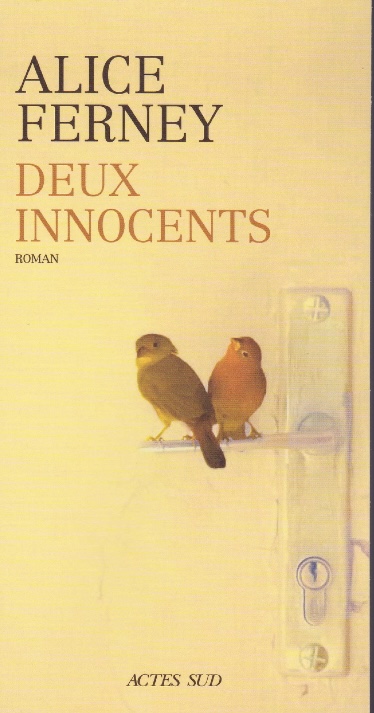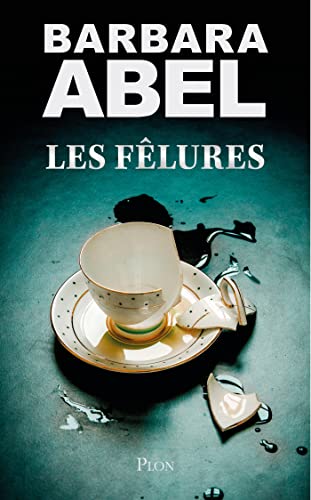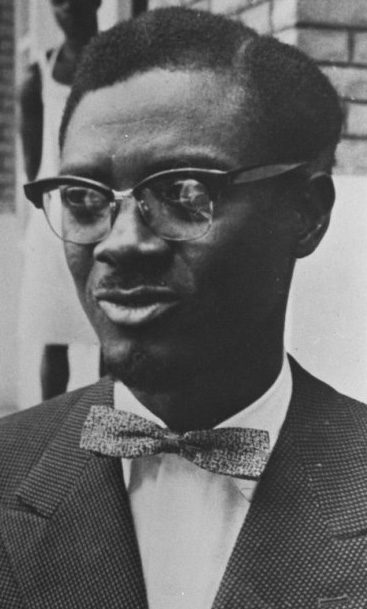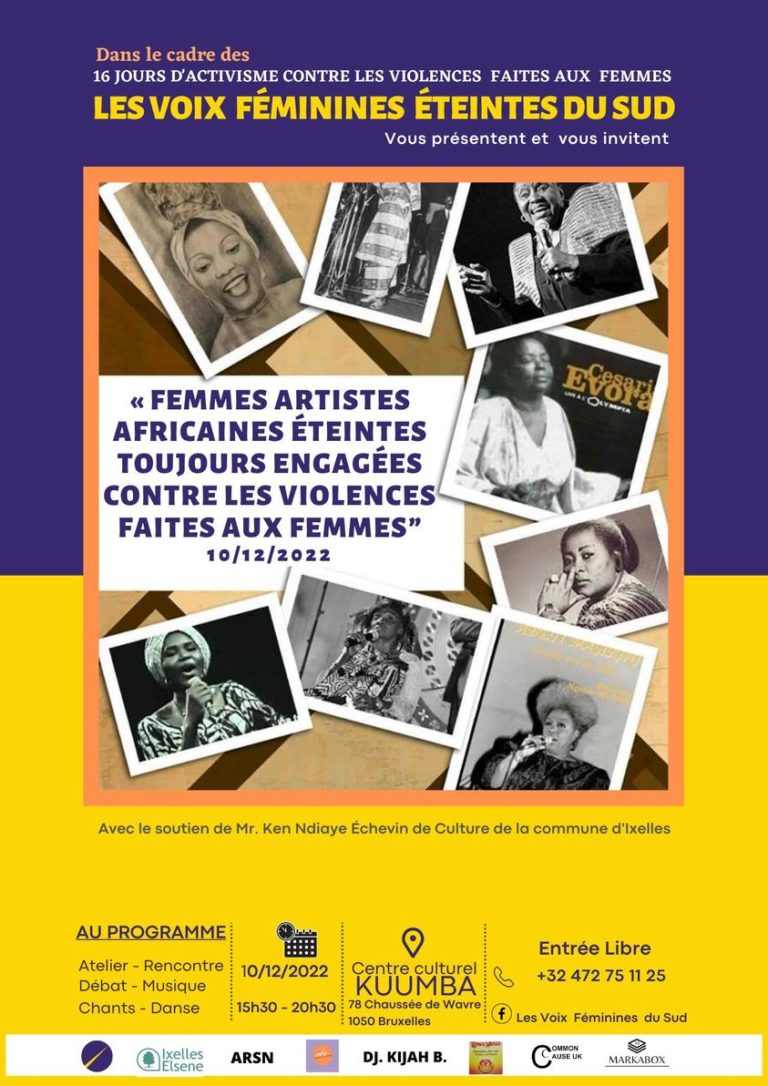Nosferatu de Robert Eggers
En ce moment12 janvier 2025 | Lecture 5 min.
!Attention, cette critique contient des spoilers!
N’hésitez pas à y revenir une fois que vous aurez vu le film si vous ne souhaitez pas vous gâcher la surprise de la découverte.
Deuxième remake du film muet signé F. W. Murnau en 1922 après la version de Werner Herzog de 1979, Nosferatu est un projet de cœur pour son réalisateur et scénariste Robert Eggers, à qui l’on doit The Witch (2015), The Lighthouse (2019) et The Northman (2022). C’est en partie la découverte du classique expressionniste qui a encouragé Eggers à poursuivre une carrière artistique. Il avait même dirigé sa propre pièce tirée de l’œuvre à l’école, interprétant le rôle du Comte Orlok. Son nouveau film témoigne de sa révérence pour l’original, notamment dans le respect de sa trame narrative et de certains de ses codes stylistiques.
Nosferatu – Eine Symphonie des Grauensest (Une symphonie d’horreur), pour en donner le titre complet, est une sorte de palimpseste de Dracula de Bram Stoker, dont l’adaptation filmique n’avait pas été autorisée. Après un procès intenté par les ayants droits de l’auteur, la majorité des copies du film avaient d’ailleurs été détruites. Le scénario de Murnau suit principalement celui du roman, à quelques exceptions près, comme les noms des personnages, la relocalisation en Allemagne, l’absence de transformation vampirique des victimes du Comte, tout simplement assassinées, etc. Ces changements tenaient autant de la licence artistique pour correspondre aux attentes du public visé que de la roublardise afin d’éviter, sans succès, des poursuites judiciaires.
1838 en Allemagne. Récemment mariés, Ellen (Lily-Rose Depp) et Thomas Hutter (Nicholas Hoult) voient leur destin bousculé quand le jeune clerc accepte de se rendre en Transylvanie pour son employeur Herr Knock (Simon McBurney). Après avoir confié Ellen à de riches amis, Friedrich (Aaron Taylor-Johnson) et Anna Harding (Emma Corrin), Thomas voyage jusqu’au sinistre château du Comte Orlok (Bill Skarsgård). Pendant son séjour, il est tombe sous l’emprise de son hôte. À Wisborg, Ellen subit de violentes crises de somnambulisme. Son docteur (Ralph Ineson) fait appel au professeur Von Franz (Willem Dafoe), un scientifique ostracisé pour ses croyances occultes…
S’ensuit une cavalcade de scènes horrifiques de possession, de meurtres sanglants, de vagues de rats et de tragédies intimes semant le chaos dans toute la ville. En conservant l’intrigue de Nosferatu dans l’Allemagne du début du XIXᵉ siècle, Eggers fait plus que respecter les changements de Murnau. Il capitalise, consciemment ou non, sur la teneur romantique (au sens artistique du terme) de ce cadre narratif. D’abord pour donner du crédit à l’exubérance de l’intrigue et de ses dialogues, lourds et sans reliefs. Ensuite, pour aborder facilement, grâce à une forme de distanciation imposée par les films en costumes, la dichotomie séduction-répulsion (thématique traditionnelle du vampirisme), sous un angle plus extrême et plus risqué: la relation victime-bourreau dans le cadre de violences sexuelles. Lors d’un entretien avec Deadline, il a d’ailleurs précisé: «In doing the research to write this script, I needed to be disciplined to forget what I knew. And then, you start looking at the really early vampire accounts, and you’re like, “They’re not even drinking blood, they’re just strangling people, or suffocating people, or fucking them to death.” And that was really interesting».
Pour mener à bien une telle proposition sans manquer le coche, il aurait fallu engager un·e scénariste capable d’une immense subtilité, ce dont Robert Eggers est dépourvu. En voulant doter son héroïne, sa victime, d’une forme de pouvoir ou d’influence sur les événements pour la rendre moins passive, il la transforme en Pandore corsetée, il l’hypersexualise et lui fait endosser au moins implicitement une responsabilité dans les crimes de son bourreau, avant de la sacrifier de manière très graphique. Si mécaniquement, la trame fonctionne, tient en haleine, amuse même parfois en rappelant l’excentricité outrageuse des films de la Hammer, le fond n’en reste pas moins éminemment problématique. Ce n’est pas tant le respect de l’histoire de base, et des codes sociaux qu’elle comporte, qui dérange; mais plutôt l’ajout de cette nouvelle couche d’ambiguïté superflue couplée avec la répétition, la longueur et la brutalité (parfois gratuites) des scènes de violences sexuelles (physiques ou psychologiques) envers les femmes. La barbarie avec laquelle Eggers montre, par exemple, le Comte dévorer les petites jumelles Harding me semble si peu nécessaire que je la qualifierais sans détour d’inadmissible.
Mais qu’en est-t-il du reste? Comme pour ses deux prédécesseurs, Nosferatu fait triompher les membres de la direction artistique. Les décors de Craig Lathrop et Beatrice Brentnerova et les costumes de Linda Muir nous transportent parfaitement dans l’univers gothique de l’histoire, faisant la part belle aux textures de roche, de bois, de briques et de pavés d’un côté, et à la caractérisation des personnages par le choix des tissus, des motifs et des coutures de l’autre. Le château du Comte Orlok vibre comme une entité mystique à part entière, le prolongement architectural froid et dangereux de son propriétaire.
La photographie de Jarin Blaschke est étourdissante de beauté. Presque monochrome, amenant les bleus et les marrons vers leurs tonalités les plus sombres, jouant habilement des éclairages pour créer des effets d’ombres saisissants, cadrant les plans avec une précisions picturale, cachant ou révélant les présences ou les absences situées en hors-champ à l’aide de fluides et longs mouvements de caméra, l’imagerie de cette nouvelle adaptation risque bien de remporter des prix prestigieux dans les mois à venir. L’arrivée de Thomas chez le Comte, presque entièrement sans dialogue, est la plus grande réussite du film. A contrario, la réalisation et le montage de Eggers manquent parfois de dynamisme et de verve. Quand il ne succombe pas à la contemplation jubilatoire de la splendeur visuelle de son film, le cinéaste cède à la tentation du jump scare facile, le fameux «chut chut chut chut chut chut BOUH!» qui ne surprend plus, ou se perd dans des champs et contre-champs éculés.
Dans ses moments les plus aboutis, la partition du jeune compositeur Robin Carolan évoque les tensions dissonantes et la profondeur ethnomusicologique de Béla Bartók, dans ses moments les moins accomplis, elle s’apparente à un concours de décibels. Agrémentée d’une orchestration pléthorique (60 cordes!) et élégante, de quelques motifs diablement efficaces et de sonorités postindustrielles innovantes, cette bande sonore regorge de bonnes idées (l’utilisation des chœurs, de la boîte à musique ou de percussions telluriques). Malheureusement, elle peine à éviter certains clichés musicaux de films d’horreur comme les aigus stridents ou les sforzati intempestifs, et elle s’estompe très rapidement dans notre mémoire auditive tant sa fonction est d’appuyer l’ambiance de ce qu’elle illustre, plutôt que de la sublimer.
C’est peut-être la science du détail amenée dans l’enveloppe charnelle de Nosferatu qui a empiété sur le temps accordé pendant le tournage à la direction des acteurs et des actrices. Le travail de la distribution manque de cohérence. Quand son personnage parle, Lily-Rose Depp pousse au maximum la théâtralité de ses inflexions. Le résultat est rarement convainquant et, sur la longueur, émotionnellement anesthésiant. En revanche, son engagement corporel lors des scènes de somnambulisme ne manque pas d’intensité, s’inspirant des prouesses d’Isabelle Adjani dans la version de Werner Herzog et dans Possession (1981) d’Andrzej Żuławski. De même, la composition de Bill Skarsgård en vampire est à son meilleur quand son rôle se limite à une présence physique. Pour dire ses répliques, l’acteur a transformé sa voix en une monodie caverneuse extrêmement lente, dotée d’un accent roumain frôlant le ridicule. En Herr Knock, Simon McBurney cabotine de façon granguignolesque pour le meilleur et pour le pire. Willem Dafoe interprète Von Franz en mode pilote automatique, de manière compétente mais sans surprise.[1][1] Pour les fans de trivia, William Dafoe a incarné Max Schreck, le Comte Orlok du Nosferatu de 1922, dans Shadow of the Vampire (2000) de E. Elias Merhige, un compte rendu fictionnalisé de la création du film.
Ralph Ineson peine à exister en docteur Sievers tant l’écriture de son personnage est restreinte. Il en va de même pour Emma Corrin dans le rôle d’Anna Harding. L’acteur·rice non-binaire n’a rien d’intéressant à incarner, le personnage passant juste d’un extrême cliché féminin à un autre, de l’ingénuité à l’hystérie. Corrin n’est pas aidé·e par le carambolage de jeu de son principal partenaire: Aaron Taylor-Johnson, tout simplement catastrophique en Friedrich. Le comédien lutte avec la caractérisation de son personnage à la moindre réplique, au point qu’il ne semble pas véritablement habiter l’univers du film. C’est finalement Nicholas Hoult qui s’en sort le mieux, avec une performance habitée, des ajustements de posture et des subtiles modulations de voix. Il présente son Thomas Hutter en innocent perverti lors d’un macabre rite de passage, sans avoir peur du premier degré.
Au bout du compte, si ce nouveau Nosferatu s’inscrit dans le canon du cinéma de vampires avec un panache esthétique indiscutable, il s’embourbe dans une thématique trop sensible et trop ambitieuse pour ses capacités au point de, au mieux, la trivialiser, au pire, la sacrifier. Cette adaptation ravive aussi, une fois de plus, à mon esprit la notion d’économie de la nostalgie qui gangrène le septième art du XXIᵉ siècle. À quand la fin des pastiches et des films de fan? Quel est l’intérêt de recycler ad nauseam les trésors du passé, au lieu d’écrire de nouvelles histoires capables de nous mener vers quelque chose de magique: l’inexploré?
Vous aimerez aussi

Sound of falling, de Mascha Schilinski
En ce moment11 février 2026 | Lecture 2 min.

Danse jeune public
En ce moment20 janvier 2026 | Lecture 3 min.

Un film monde
En ce moment16 janvier 2026 | Lecture 5 min.

David Murgia & Odile Gilon
Grand Angle21 décembre 2025 | Lecture 2 min.
épisode 9/9

Réinventer... soi, sa production, son projet
Grand Angle12 décembre 2025 | Lecture 8 min.
épisode 3/4

Nos errances: histoire de persévérances
En chantier13 novembre 2025 | Lecture 2 min.

Du design plus féministe
En ce moment2 novembre 2025 | Lecture 1 min.

Kassia Undead
En ce moment2 novembre 2025 | Lecture 3 min.

Créer toujours plus… Avec toujours moins?
Grand Angle29 octobre 2025 | Lecture 7 min.
épisode 2/4

Día de Muertos
En ce moment24 octobre 2025 | Lecture 2 min.

Nouvelle Vague
Émois17 octobre 2025 | Lecture 4 min.

Un retour en Yougoslavie
En ce moment10 octobre 2025 | Lecture 2 min.

Les étincelles de la saison 24-25
En ce moment6 octobre 2025 | Lecture 4 min.

Sortir du cadre... Pour mieux créer?
Grand Angle29 septembre 2025 | Lecture 8 min.
épisode 1/4

Soutenir les désirs artistiques, à quel prix?
Grand Angle26 septembre 2025 | Lecture 2 min.

Bruxelles, la Congolaise
En ce moment12 septembre 2025 | Lecture 2 min.

Le Piège
En ce moment20 juillet 2025 | Lecture 2 min.

Dalloway ouvre le Nifff!
En ce moment6 juillet 2025 | Lecture 3 min.

Trouble #13: Invocations et évocations
Grand Angle12 juin 2025 | Lecture 6 min.

La Maison Gertrude
En ce moment16 mai 2025 | Lecture 2 min.

Les désirs dans les mondes de l'art
En ce moment16 mai 2025 | Lecture 1 min.

Journée de la Mémoire, de la Vérité et de la Justice en Argentine
En ce moment27 mars 2025 | Lecture 2 min.

Tac au tac
En ce moment15 mars 2025 | Lecture 2 min.

Puissances seules
En ce moment11 mars 2025 | Lecture 2 min.

RAGE
En ce moment7 mars 2025 | Lecture 2 min.

Salutations Mistinguettes
En ce moment7 mars 2025 | Lecture 2 min.

Laurence Rosier & Emilienne Flagothier
Grand Angle12 février 2025 | Lecture 2 min.
épisode 3/9

«Des Teufels Bad» de Veronika Franz et Severin Fiala
En ce moment30 janvier 2025 | Lecture 4 min.
épisode 3/6

«Quelque chose de paisible, de tranquille et de beau»
En ce moment30 janvier 2025 | Lecture 1 min.
épisode 2/6

Féeriques marionnettes
En ce moment7 janvier 2025 | Lecture 2 min.

Vingt Dieux
Émois2 janvier 2025 | Lecture 3 min.
épisode 13/16

L’histoire de Souleymane
Émois15 décembre 2024 | Lecture 3 min.
épisode 12/16

Le Pacha, ma mère et moi
Émois5 décembre 2024 | Lecture 3 min.
épisode 11/16

Les châteaux de mes tantes
En ce moment2 décembre 2024 | Lecture 2 min.

The Substance
Émois22 novembre 2024 | Lecture 3 min.
épisode 9/16

Don’t expect too much...
Émois3 novembre 2024 | Lecture 5 min.
épisode 7/16

Musique Femmes Festival
En ce moment9 octobre 2024 | Lecture 2 min.

État du monde
En ce moment23 septembre 2024 | Lecture 2 min.

Strange Darling
En ce moment22 septembre 2024 | Lecture 1 min.
épisode 6/16

Au Brass
En ce moment8 septembre 2024 | Lecture 3 min.

Art et migration
Grand Angle2 septembre 2024 | Lecture 2 min.

Saravah
En ce moment21 août 2024 | Lecture 2 min.
épisode 5/16

Les Rencontres Inattendues
En ce moment1 août 2024 | Lecture 2 min.

Sandrine Bergot, cap sur les Doms
Grand Angle25 juillet 2024 | Lecture 2 min.

Emilia Perez
En ce moment15 juillet 2024 | Lecture 1 min.
épisode 4/16

La fille de son père
Émois3 juillet 2024 | Lecture 2 min.
épisode 2/4

Le successeur
Émois3 juillet 2024 | Lecture 3 min.
épisode 1/4

Spoorloos/The Vanishing
En ce moment1 juillet 2024 | Lecture 2 min.
épisode 3/16

Vice-Versa 2
En ce moment26 juin 2024 | Lecture 2 min.
épisode 2/16

Knit’s Island
En ce moment26 juin 2024 | Lecture 3 min.
épisode 1/16

Quelle place pour la culture dans les partis?
Grand Angle1 juin 2024 | Lecture 12 min.

Le festival TB²
En ce moment31 mai 2024 | Lecture 3 min.

Théâtre au Vert
En ce moment31 mai 2024 | Lecture 2 min.

Orlando: ma biographie politique, et des lieux qu’on habite ensemble
Émois17 mai 2024 | Lecture 5 min.
épisode 4/5

L’IA dans les séries télé: finis les discours alarmistes
Grand Angle10 mai 2024 | Lecture 8 min.

Laura Mulvey
En ce moment23 avril 2024 | Lecture 1 min.

Louise Baduel et Michèle Noiret
En ce moment23 avril 2024 | Lecture 2 min.

Love Lies Bleeding
Émois15 avril 2024 | Lecture 4 min.

Ma déficience visuelle ne devrait pas être un frein
Émois10 avril 2024 | Lecture 1 min.
épisode 1/1

Tu l'as trouvé où, ce spectacle?
En ce moment19 février 2024 | Lecture 2 min.

Mutualiser… une (nouvelle) politique culturelle?
Grand Angle18 février 2024 | Lecture 4 min.

La semaine du son
En ce moment21 janvier 2024 | Lecture 2 min.

Poor Things
Émois16 janvier 2024 | Lecture 5 min.
épisode 13/15

Priscilla
En ce moment7 janvier 2024 | Lecture 6 min.

007 à l’opéra
Émois4 janvier 2024 | Lecture 3 min.
épisode 3/6

cinemamed
En ce moment29 novembre 2023 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] Théâtre et quartiers populaires avec Yousra Dahry
Grand Angle16 novembre 2023 | Lecture 2 min.

Sur la vieillesse au théâtre
Grand Angle30 octobre 2023 | Lecture 11 min.

Miroir Miroir
En ce moment16 octobre 2023 | Lecture 2 min.

L’Amour c’est pour du beurre
En ce moment16 octobre 2023 | Lecture 2 min.

Prendre soin, par le théâtre aussi
En ce moment4 octobre 2023 | Lecture 1 min.

Hippocampe
En ce moment29 septembre 2023 | Lecture 2 min.

Initier au matrimoine littéraire
En chantier25 août 2023 | Lecture 5 min.

Le vrai calme se trouve dans la tempête
Au large21 août 2023 | Lecture 5 min.

[VIDÉO] Lumière sur le vitrail dans l'atelier de François et Amélie
En chantier7 août 2023 | Lecture 1 min.
épisode 2/3

Réhabilitons Welfare, le spectacle mal-aimé d’Avignon 2023
Émois3 août 2023 | Lecture 11 min.

Drame familial sur fond d'imaginaire décolonisé
Grand Angle17 juillet 2023 | Lecture 1 min.

Place aux narrations féministes
En ce moment13 juillet 2023 | Lecture 12 min.

Échappées urbaines
En ce moment12 juin 2023 | Lecture 2 min.

La condition pavillonnaire ou la terreur du quotidien
Émois1 juin 2023 | Lecture 4 min.
épisode 10/15

Depuis que tu n’as pas tiré
En ce moment24 mai 2023 | Lecture 2 min.

Le Brussels Jazz week-end
En ce moment24 mai 2023 | Lecture 2 min.

«Collision» et ça repart!
En ce moment24 mai 2023 | Lecture 2 min.

Un retour aux sources pour ne plus manquer de repères
Grand Angle15 mai 2023 | Lecture 5 min.

Foncez vers l’extase, avant qu’il ne soit trop tard!
En ce moment15 mai 2023 | Lecture 2 min.

Family Matters
En ce moment25 avril 2023 | Lecture 4 min.

Le collectif suisse BPM déploie son irrésistible «Collection»
Émois17 avril 2023 | Lecture 5 min.

Brulex et Mathieu Desjardins
En ce moment17 avril 2023 | Lecture 2 min.

Le collectif Barra dans le Pavillon des Passions Humaines
En ce moment17 avril 2023 | Lecture 2 min.

Indiscipline à Knokke!
En ce moment29 mars 2023 | Lecture 2 min.

Nedjma Hadj Benchelabi: programmatrice-dramaturge
Au large28 mars 2023 | Lecture 1 min.
épisode 5/6

Fancy Legs
En ce moment21 mars 2023 | Lecture 2 min.

Chryséléphantine
En ce moment6 mars 2023 | Lecture 1 min.

Rabelais revient à la charge
Grand Angle18 février 2023 | Lecture 1 min.
épisode 1/10

Archipel_o
En ce moment13 février 2023 | Lecture 2 min.

Les dents de Lumumba
Grand Angle25 janvier 2023 | Lecture 2 min.
épisode 2/3

IL ÉTAIT UNE FOIS LES EFFETS SPÉCIAUX
Grand Angle23 décembre 2022 | Lecture 10 min.

Les murs ont la parole
Au large9 décembre 2022 | Lecture 10 min.

Créer pour faire advenir le female gaze
Grand Angle27 octobre 2022 | Lecture 6 min.
épisode 1/3

«Ça a commencé?»
Grand Angle19 octobre 2022 | Lecture 7 min.

Cinéaste et thérapeute corporelle
Grand Angle14 octobre 2022 | Lecture 1 min.
épisode 18/18

Scénographe et maman
Grand Angle30 septembre 2022 | Lecture 2 min.
épisode 3/6

Il était une fois les effets spéciaux
Grand Angle20 septembre 2022 | Lecture 5 min.

VIRUS-32. Les Variations Zombiques.
En ce moment10 septembre 2022 | Lecture 2 min.

Megalomaniac. Vive l’enfer...
En ce moment3 septembre 2022 | Lecture 2 min.

Circassienne, le saut dans le vide
Grand Angle3 juillet 2022 | Lecture 4 min.
épisode 3/3

Comédien et guide à l’Africa Museum de Tervuren
Grand Angle1 juillet 2022 | Lecture 1 min.
épisode 15/18

«T’inquiète pas, je te rattrape»
Grand Angle30 mai 2022 | Lecture 4 min.
épisode 2/3

L'échec vu du public
En chantier28 mai 2022 | Lecture 3 min.
épisode 3/4

Bob Morane
Émois28 mai 2022 | Lecture 3 min.
épisode 3/15

«Désir ou amour, tu le sauras un jour.»
Émois18 mai 2022 | Lecture 1 min.
épisode 3/3

Rockeur et traducteur
Grand Angle13 mai 2022 | Lecture 1 min.
épisode 11/18

Démontage du chapiteau patriarcal
Grand Angle10 mai 2022 | Lecture 6 min.
épisode 1/3

Gestionnaire le matin et artiste l'après-midi
Grand Angle9 mai 2022 | Lecture 1 min.

«Faut pas dire à qui je ressemble, faut dire qui je suis.»
Émois21 avril 2022 | Lecture 1 min.
épisode 2/3

Marie Losier
18 avril 2022 | Lecture 1 min.

Les meilleurs sont les plus courts
18 avril 2022 | Lecture 1 min.

Saxophoniste et importateur d'huile d'olive
Grand Angle11 avril 2022 | Lecture 2 min.
épisode 8/18

Juwaa
14 mars 2022 | Lecture 1 min.

Les conditions extérieures à l’échec
En chantier1 mars 2022 | Lecture 4 min.
épisode 2/4
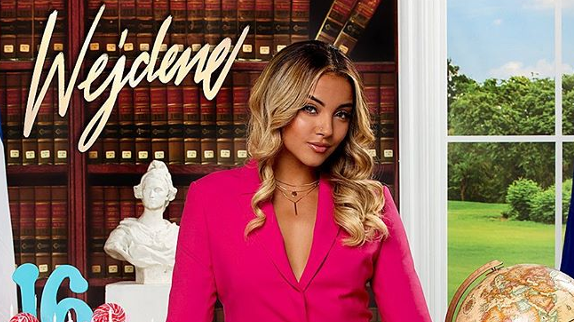
«L'amour c'est compliqué, les sentiments sont profonds.»
Émois14 février 2022 | Lecture 1 min.
épisode 1/3

Germaine Acogny, in(c)lassable reine de la danse
En ce moment13 février 2022 | Lecture 1 min.

«Jouez, jouez, jouez!»
Au large30 janvier 2022 | Lecture 10 min.

À l’ami à la vie !
Grand Angle25 janvier 2022 | Lecture 2 min.

Acteur et plombier/chauffagiste
Grand Angle28 décembre 2021 | Lecture 1 min.
épisode 2/18

Diriger un théâtre: un geste politique
Grand Angle28 décembre 2021 | Lecture 2 min.

Vieilles peaux
Émois12 mars 2021 | Lecture 5 min.