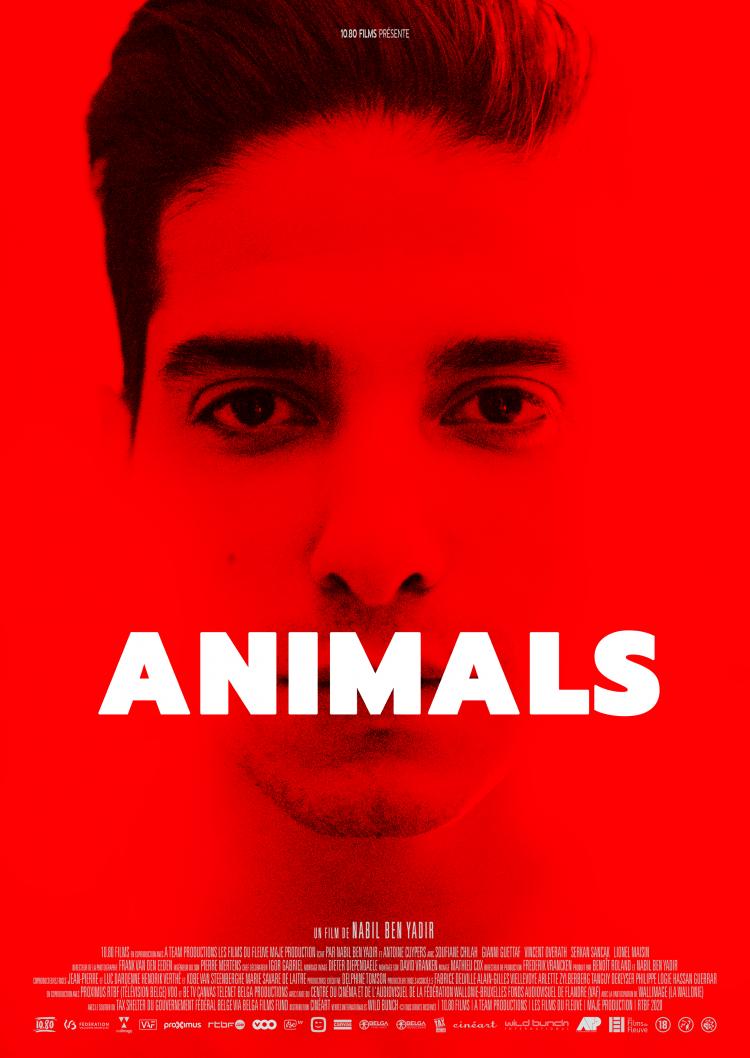IL ÉTAIT UNE FOIS LES EFFETS SPÉCIAUX
Grand Angle23 décembre 2022 | Lecture 10 min.
Des inventions sur le pouce
Les années 1910 voient le cinéma entrer dans son adolescence, passant de nouveauté stimulante et d’attraction circassienne à une entreprise lucrative qui se structure petit à petit. Outre l’émergence de nombreuses compagnies de production et des premières salles entièrement dédiées aux projections, la réalisation continue de se développer en tant qu’art, notamment grâce à plusieurs pionnier·ères dont le cinéaste, aujourd’hui très (justement) controversé, D. W. Griffith. Loin d’être un innovateur technique, le réalisateur américain a surtout révolutionné la grammaire cinématographique à travers sa maîtrise du montage, du cadrage, de la composition des plans, du mouvement et de l’éclairage.
Dans ses œuvres, les effets visuels n’attirent pas l’attention des spectateur·ices, mais participent pleinement à la narration, comme l’utilisation de fondus ou de fondus enchaînés pour dénoter une ellipse entre deux scènes. Ceux-ci sont créés en cours de tournage en contrôlant l’exposition lumineuse de la pellicule par ouverture ou fermeture du diaphragme de la caméra. Pour les fondus effectués en post-production, le négatif est lentement plongé dans une solution liquide oxydante jusqu’au point souhaité avant de le retirer. À la même période, l’emploi d’une ouverture en iris, appliquée directement sur l’objectif de la caméra, permet de diriger l’attention sur un détail particulier de l’image. On peut d’ailleurs y voir une version archaïque du zoom tel qu’il existe de nos jours.

Bénéficiant de la clémence météorologique californienne, et suite à l’effondrement de l’industrie cinématographique européenne pendant la Première Guerre mondiale, Hollywood impose rapidement la suprématie de ses productions. La majorité des équipes sont constituées d’hommes et de femmes polyvalent·es. À l’époque, ce sont surtout des cameramen qui réalisent des effets visuels en manipulant leur appareil, comme par exemple la vitesse d’enregistrement des images, pour créer ralentis et accélérations, une méthode particulièrement prisée dans les comédies dites slapstick.
Les scènes en split screen et autres fantômes en surimpressions se démultiplient avec la fabrication de la caméra Bell and Howell 2709. Entièrement métallique, elle a la particularité de pouvoir maintenir fixement la pellicule devant l’objectif durant toute son exposition. Pour les effets spéciaux plus complexes, la responsabilité incombe aux plus débrouillards capables de trouver une solution pratique aux problèmes rencontrés. Graduellement, certain·es se spécialisent tant et si bien qu’iels se constituent une réputation professionnelle. Ce fut le cas de Norman O. Dawn, le premier homme officiellement reconnu comme un créateur d’effets spéciaux. On lui doit notamment l’utilisation de peintures sur verre extrêmement détaillées (matte paintings) susceptibles de compléter ou de modifier n’importe quel arrière-plan. Dans le même ordre d’idée, Franck Williams développe en 1916 une méthode permettant de filmer des acteur·ices devant un fond noir, remplacé ensuite par des images tournées n’importe où et n’importe quand (l’ancêtre du green screen, employé souvent à tort et à travers dans le cinéma hollywoodien actuel).[1][1] Un matte ou un cache est procédé de trucage sur pellicule combinant des images de deux prises de vues différentes en une image composite. Un cache simple est un décor peint sur vitre en trompe-l’œil inséré entre la caméra et la scène filmée. Le cache mobile (travelling matte) est effectué après coup en laboratoire pour obtenir l’incrustation d’un objet mobile, personnage ou autre, à l’intérieur d’une scène.
Deutsche Qualität
Avec son industrie de plus en plus florissante, le cinéma s’est émancipé esthétiquement de ses pionnier·ères. Les films, toujours plus ambitieux, exigent une rigueur nouvelle, de l’efficacité, de la rationalisation, et des effets spéciaux plus convaincants. Les années 1920 voient l’apparition de départements spécifiquement dédiés à tel ou tel aspect d’une production, des scénarios aux costumes, en passant par la musique, le montage, les accessoires, etc. S’il est impossible de savoir exactement quand et quel grand studio hollywoodien a devancé les autres en créant son propre département special effects, le premier film à les créditer officiellement, What Price Glory? de Fox Pictures, sort en salle en 1926.
Les technologies de la décennie précédente profitent rapidement de l’amélioration constante du matériel, qu’il s’agisse des éclairages, des caméras ou d’une pellicule plus fine, autorisant les cinéastes à voir les choses en (très) grand. L’augmentation radicale des budgets à la même période trahit cette tendance, surtout dans la construction de décors gigantesques ou de maquettes et modèles réduits d’une incomparable minutie. Grâce au flair esthétique de ses cinéastes et de leur prédilection pour les contes de fées, le cinéma allemand exerce une influence majeure sur l’ensemble du domaine. Considéré comme le père des films d’horreur, le réalisateur et acteur Paul Wegener s’en est fait l’avocat dès 1916, prophétisant le développement d’un «cinéma synthétique» où des scènes totalement artificielles seraient fabriquées au seul moyen des paramètres techniques. En 1925, dans son religieusement méditatif Lebende Buddhas, dont il ne subsiste que cinq minutes, un matte très sophistiqué représente un Bouddha dans le ciel guidant un navire perdu en mer.
Le principal studio allemand, UFA, produit les œuvres les plus spectaculaires de l’époque, presque toutes dirigées par l’incontournable Fritz Lang. Son épique Die Niebelung (1924) combine des décors faramineux (dont un dragon mécanique de 18 mètres) à d’autres prouesses optiques comme le procédé Schüfftan: un miroir semi-réfléchissant incliné mélangeant, dans une même prise de vue, des éléments de taille réelle et des maquettes pour donner l’illusion d’un décor continu, par perspective forcée. Visionnaire fable de science-fiction et chef-d’œuvre incontesté de Fritz Lang, Metropolis (1926) s’impose comme un état des lieux des effets spéciaux à cette période avec des maquettes animées, des matte paintings, des effets mécaniques et, parmi les premières transparences, où des images projetées sur un écran depuis l’arrière de celui-ci permettant la vision de celles-ci par l’avant, et donc d’associer (ou de superposer) deux espaces en une seule prise de vue, par exemple, un paysage lointain et des acteur·ices en studio.
La cimentation d’un métier
Malgré tous ces perfectionnements, le plus grand séisme technologique au cinéma est l’avènement du son synchronisé avec le succès de The Jazz Singer en 1927. Dans les facteurs ayant favorisé l’émergence, puis l’hégémonie du cinéma dit «parlant», on peut citer l’apparition de l’amplification électrique et la popularisation des haut-parleurs comme système de diffusion musicale. La nouveauté du son privilégie une bande sonore spectaculaire marquée par l’interdisciplinarité entre musique, cinéma et danse, à travers une célébration du rythme. Avec ce nouveau paramètre esthétique, les studios investissent dans de nouveaux plateaux insonorisés. En raison de leur bruit, les caméras devaient être placées dans des cabines limitant drastiquement leurs possibilités en termes de mouvements. Des années 1930 aux années 1950, l’impossibilité d’enregistrer convenablement du son en extérieur impose aux productions hollywoodiennes de tout réaliser en studio. Cela offre aux équipes chargées des effets spéciaux de nouveaux défis, comme la création de lieux exotiques en combinant des décors avec des projections en transparence.
Également dans les années 1930, le développement de l’imprimante optique, un appareil constitué d’un ou plusieurs projecteurs de film reliés mécaniquement à une caméra argentique, favorise l’utilisation de fondus enchaînés, du ralenti ou la combinaison de plans par dizaines au sein de flamboyantes séquences de comédies musicales. Les avancées techniques s’accélérant, et la dépendance des cinéastes envers les effets spéciaux grandissant (pas seulement pour matérialiser l’impossible mais aussi par souci d’économie de temps et d’argent), les départements qui leur étaient consacrés se subdivisent et se spécialisent. À la MGM, le special effects department s’occupe des projections en transparence, des maquettes, des effets physiques et mécaniques, tandis que l’optical department se charge des matte paintings et de l’impression optique.
En 1932, le producteur Carl Laemmie demande la construction à Universal du premier plateau entièrement dévoué au tournage d’effets spéciaux. Inauguré pour l’exécution des maquettes d’avions d’Air Mail (1932), il profite à plusieurs classiques de la décennie comme The Invisible Man (1934) et The Bride of Frankenstein (1935), tous les deux signés James Whale qui donne ses lettres de noblesse aux films d’horreur étatsuniens. Certaines compagnies, comme la RKO, se spécialisent d’ailleurs dans la production de monster movies autour de figures iconiques comme Dracula, le Loup Garou, la Momie ou bien évidemment King Kong (1933), triomphe populaire porté par d’impressionnantes illusions optiques et des maquettes dernier cri. Si iels ont à présent le respect artistique de leurs pairs, les créateur·ices des effets participant à la réussite des œuvres sont volontairement gardé·es dans l’ombre par les producteurs qui craignent un désaveu du public envers les films si on lui en dévoile les trucages. Il faut d’ailleurs attendre la fin de la décennie pour que ces artisans bénéficient enfin de leur propre catégorie aux Oscars. Une première statuette récompense en 1939 Fred Sersen pour The Rains Came et sa séquence d’inondation aux proportions bibliques.
Quand la couleur s’en mêle
La majorité des facteurs participant à l’élaboration d’un film ont été partiellement révolutionnés en 1941 par Citizen Kane d’Orson Welles, et les effets spéciaux ne font pas exception.
Aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands chefs-d’œuvre du septième art, c’est un tour de force en termes de matte paintings, de maquettes, d’animation et de techniques optiques, avec des effets d’une telle finesse et d’une telle subtilité, parfois imperceptibles, que l’équipe n’obtient paradoxalement pas de nomination aux Oscars dans la catégorie si récemment instaurée. À présent indispensable à la majorité des productions, le domaine est peuplé de spécialistes compétent·es et expérimenté·es, la majorité des techniques employées atteignant un plateau technologique. Une petite révolution va pourtant bouleverser toute l’industrie: la photographie couleur.
Dans le cinéma «primitif», les pellicules étaient peintes ou teintées à la main, image par image. Dès 1917, la compagnie Technicolor développe un procédé de synthèse additive bichrome pour le court métrage The Gulf Between, dont il ne reste que des fragments. Le fondateur de l’entreprise, Herbert Kalmus, présente un autre système dans les années 1920: une synthèse soustractive où l’on colle dos à dos deux positifs préalablement virés en rouge et en vert. À partir de 1928 et tout au long des années 1930, le bichrome est remplacé par une caméra chargée de trois négatifs noir et blanc en synchronisme parfait, l’un sensible au rouge, l’autre au vert et le dernier au bleu. Chacun des négatifs noir et blanc donne un positif noir et blanc qui, enduit d’une fine couche d’encre de la couleur correspondante, dépose ensuite cette encre par contact sur une pellicule totalement transparente, permettant la reconstitution d’une image colorée. Le dispositif est très lourd, le processus onéreux, nécessitant par exemple le double ou le triple de lumière d’un tournage «normal», et les résultats varient du prodigieusement beau (on pense à Gone with the Wind en 1939) à la patine granuleuse. Ce n’est qu’à partir des années 1940, grâce à divers perfectionnements techniques de la caméra, que tourner en Technicolor se répand comme une option concrète pour produire des films entièrement colorisés.
Pour les créateur·ices d’effets spéciaux, cela signifie de réapprendre certains aspects de leur métier. La peinture sur verre demande à présent une précision colorimétrique exceptionnelle afin de correspondre aux costumes et aux décors qu’elle venait agrémenter.
La décennie sera également marquée par deux autres changements radicaux. L’éclatement de la Seconde Guerre mondiale marque une forte diminution du nombre de productions annuelles et une réorientation de leur contenu. Les films de guerre concentrent l’essentiel des budgets, provoquant une évolution significative de la pyrotechnie, mais aussi de maquettes aux proportions gargantuesques lors de la reconstitution d’impressionnantes batailles aériennes ou navales. La MGM ordonne l’édification d’un aquarium de 92 mètres carrés, mais les vaisseaux construits sont parfois si énormes qu’ils y semblent à l’étroit, nécessitant le pompage de l’eau pour conférer aux maquettes une impression de mouvement et de vitesse, comme on peut le voir dans Thirty Seconds over Tokyo (1944). Les combats aériens nécessitent des escadrons entiers manipulés par un système élaboré de fils et de poulies, dont l’efficacité est par exemple démontrée dans les plans de décollage en formation brillamment exécutés de Mrs Miniver (1942). Après une certaine période d’euphorie au niveau du box-office pendant le conflit, la fin de ce dernier s’accompagne d’une baisse de revenus pour les studios. En cause, le développement des banlieues, loin des salles de cinéma, et l’arrivée d’un concurrent redoutable aux salles obscures: la télévision. Au sein de cette nouvelle conjoncture socio-économique et culturelle, les prouesses techniques des effets spéciaux vont une fois de plus devenir le nerf de la guerre à Hollywood…
Vous aimerez aussi

Il était une fois les effets spéciaux
Grand Angle20 septembre 2022 | Lecture 5 min.

Silent Night. Last Christmas?
En ce moment9 septembre 2022 | Lecture 2 min.

Une nuit au Styx
Émois28 avril 2022 | Lecture 7 min.
épisode 3/4

Sound of falling, de Mascha Schilinski
En ce moment11 février 2026 | Lecture 2 min.

Un film monde
En ce moment16 janvier 2026 | Lecture 5 min.

Nos errances: histoire de persévérances
En chantier13 novembre 2025 | Lecture 2 min.

Créer toujours plus… Avec toujours moins?
Grand Angle29 octobre 2025 | Lecture 7 min.
épisode 2/4

Nouvelle Vague
Émois17 octobre 2025 | Lecture 4 min.

Un retour en Yougoslavie
En ce moment10 octobre 2025 | Lecture 2 min.

Sortir du cadre... Pour mieux créer?
Grand Angle29 septembre 2025 | Lecture 8 min.
épisode 1/4

Mohamed El Khatib & Nathalie Zaccaï-Reyners
Grand Angle16 juillet 2025 | Lecture 2 min.
épisode 6/9

Dalloway ouvre le Nifff!
En ce moment6 juillet 2025 | Lecture 3 min.

De l’exil et de la censure
Grand Angle24 mai 2025 | Lecture 2 min.

«Des Teufels Bad» de Veronika Franz et Severin Fiala
En ce moment30 janvier 2025 | Lecture 4 min.
épisode 3/6

Vingt Dieux
Émois2 janvier 2025 | Lecture 3 min.
épisode 13/16

L’histoire de Souleymane
Émois15 décembre 2024 | Lecture 3 min.
épisode 12/16

Le Pacha, ma mère et moi
Émois5 décembre 2024 | Lecture 3 min.
épisode 11/16

The Substance
Émois22 novembre 2024 | Lecture 3 min.
épisode 9/16

Don’t expect too much...
Émois3 novembre 2024 | Lecture 5 min.
épisode 7/16

Strange Darling
En ce moment22 septembre 2024 | Lecture 1 min.
épisode 6/16

Art et migration
Grand Angle2 septembre 2024 | Lecture 2 min.

Saravah
En ce moment21 août 2024 | Lecture 2 min.
épisode 5/16

Sandrine Bergot, cap sur les Doms
Grand Angle25 juillet 2024 | Lecture 2 min.

Emilia Perez
En ce moment15 juillet 2024 | Lecture 1 min.
épisode 4/16

La fille de son père
Émois3 juillet 2024 | Lecture 2 min.
épisode 2/4

Le successeur
Émois3 juillet 2024 | Lecture 3 min.
épisode 1/4

Spoorloos/The Vanishing
En ce moment1 juillet 2024 | Lecture 2 min.
épisode 3/16

Vice-Versa 2
En ce moment26 juin 2024 | Lecture 2 min.
épisode 2/16

Knit’s Island
En ce moment26 juin 2024 | Lecture 3 min.
épisode 1/16

Quelle place pour la culture dans les partis?
Grand Angle1 juin 2024 | Lecture 12 min.

Orlando: ma biographie politique, et des lieux qu’on habite ensemble
Émois17 mai 2024 | Lecture 5 min.
épisode 4/5

L’IA dans les séries télé: finis les discours alarmistes
Grand Angle10 mai 2024 | Lecture 8 min.

Laura Mulvey
En ce moment23 avril 2024 | Lecture 1 min.

Love Lies Bleeding
Émois15 avril 2024 | Lecture 4 min.

Poor Things
Émois16 janvier 2024 | Lecture 5 min.
épisode 13/15

Priscilla
En ce moment7 janvier 2024 | Lecture 6 min.

007 à l’opéra
Émois4 janvier 2024 | Lecture 3 min.
épisode 3/6

cinemamed
En ce moment29 novembre 2023 | Lecture 1 min.

Initier au matrimoine littéraire
En chantier25 août 2023 | Lecture 5 min.

Drame familial sur fond d'imaginaire décolonisé
Grand Angle17 juillet 2023 | Lecture 1 min.

Un retour aux sources pour ne plus manquer de repères
Grand Angle15 mai 2023 | Lecture 5 min.

Des forêts et des sardines
Grand Angle21 avril 2023 | Lecture 7 min.

Cinéaste et thérapeute corporelle
Grand Angle14 octobre 2022 | Lecture 1 min.
épisode 18/18

VIRUS-32. Les Variations Zombiques.
En ce moment10 septembre 2022 | Lecture 2 min.

Éducatrice et maquilleuse
Grand Angle8 septembre 2022 | Lecture 1 min.
épisode 17/18

Megalomaniac. Vive l’enfer...
En ce moment3 septembre 2022 | Lecture 2 min.

Comédien et guide à l’Africa Museum de Tervuren
Grand Angle1 juillet 2022 | Lecture 1 min.
épisode 15/18

Marie Losier
18 avril 2022 | Lecture 1 min.

Les meilleurs sont les plus courts
18 avril 2022 | Lecture 1 min.

Juwaa
14 mars 2022 | Lecture 1 min.

«Jouez, jouez, jouez!»
Au large30 janvier 2022 | Lecture 10 min.

À l’ami à la vie !
Grand Angle25 janvier 2022 | Lecture 2 min.

Acteur et plombier/chauffagiste
Grand Angle28 décembre 2021 | Lecture 1 min.
épisode 2/18