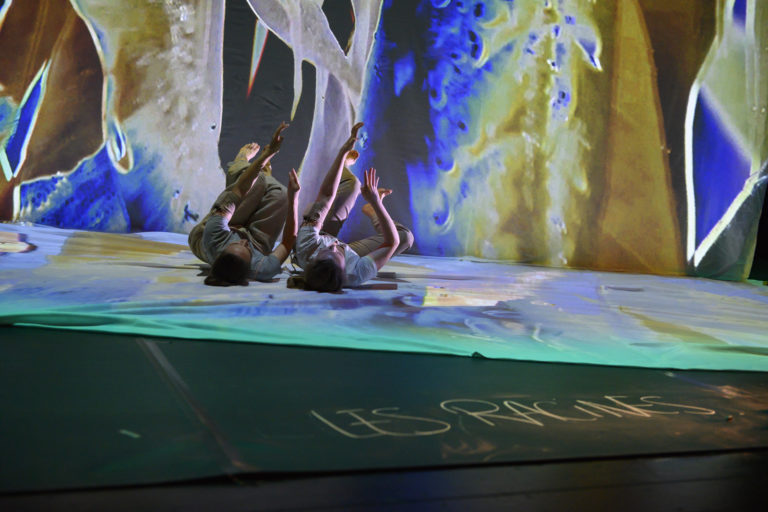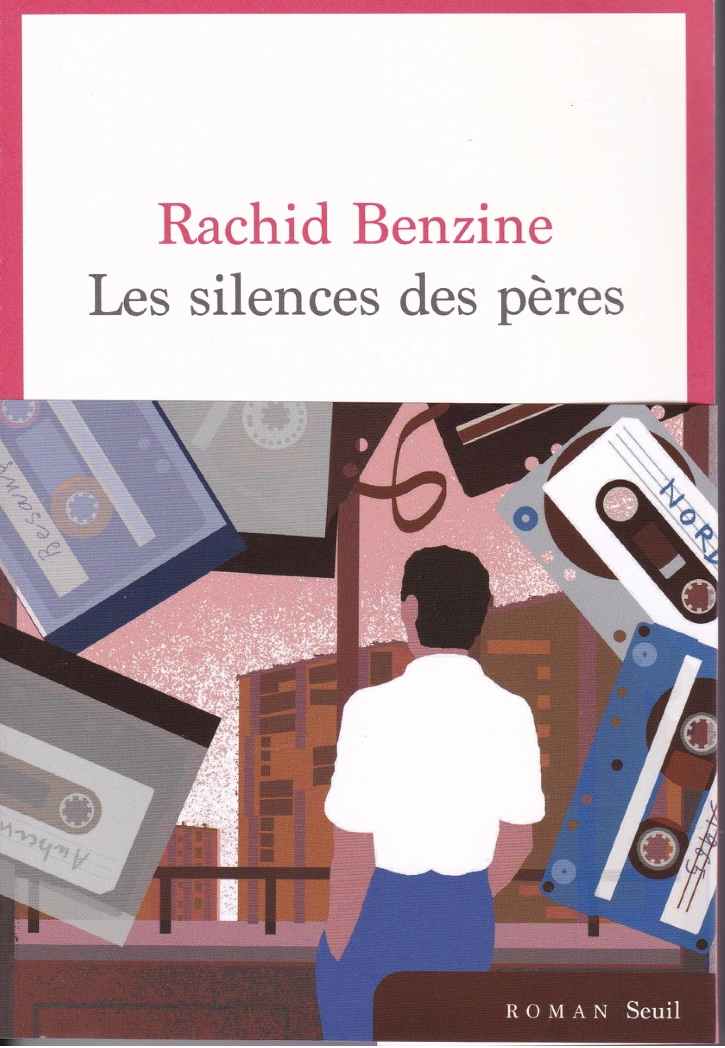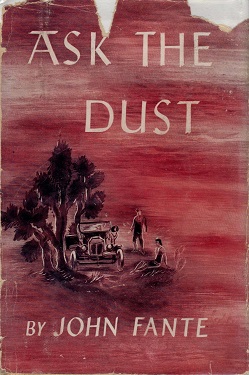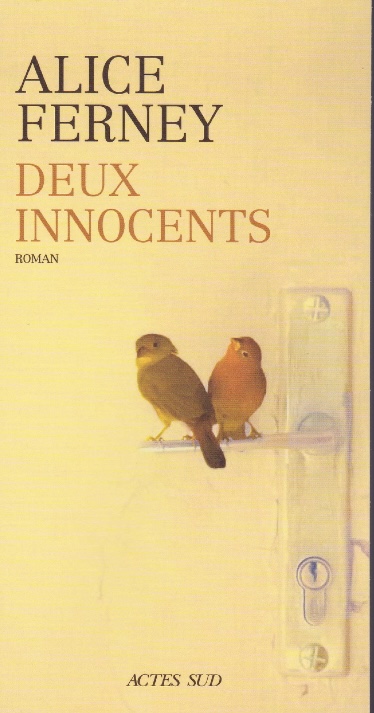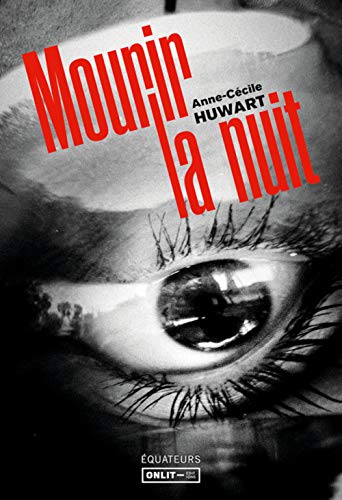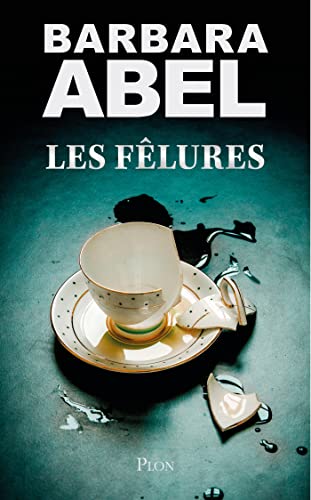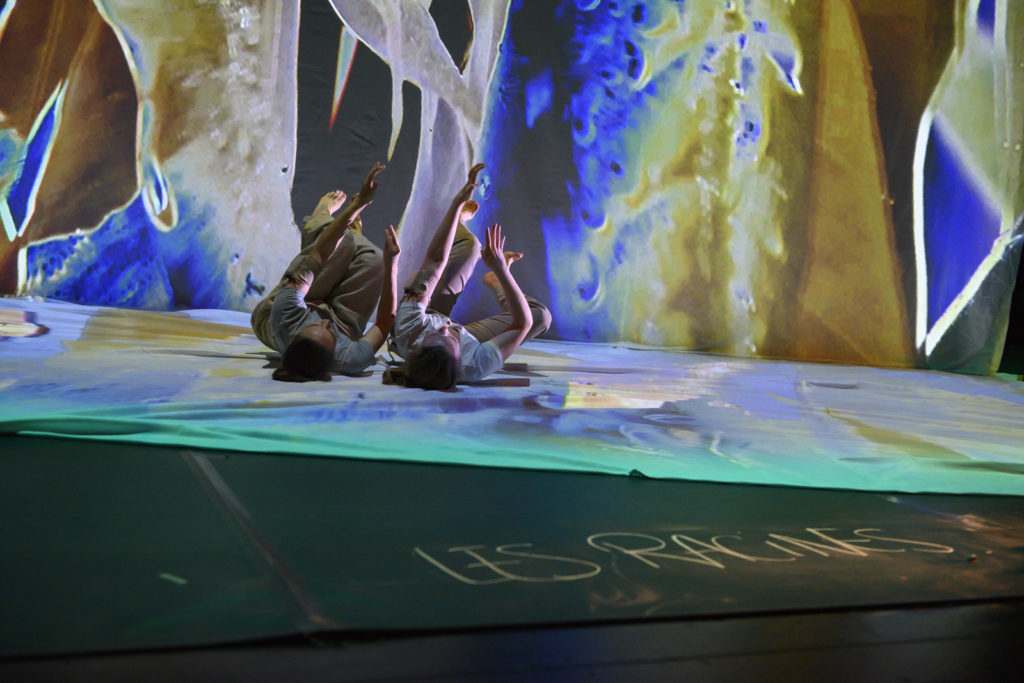
Se relever du fiasco
En chantier2 juillet 2022 | Lecture 6 min.
épisode 4/4
Françoise Berlanger me parle d’un de ses spectacles, qui a été un triomphe. Elle l’a joué en anglais à Londres, ce qui l’a menée à travailler à Rio de Janeiro. Encore aujourd’hui, elle n’est pas sûre d’avoir tout compris: «Y a des moments dans la vie où tout dit oui, blam. Impossible d’analyser pourquoi ça a si bien marché. Y a toujours un moment où tu te dis quand même, ça m’échappe.»
Par contre, quand il s’agit d’échecs, certains artistes analysent les raisons qui y ont mené de manière très lucide.
Analyser les raisons de l’échec
Coralie Vanderlinden a porté deux spectacles qui n’ont pas tourné, au milieu d’autres spectacles qui ont été des succès. Elle voit dans ces deux cas isolés un problème de fond, de thématiques très vastes, dont il a été difficile de tirer le fil. «Ce sont des spectacles d’écriture plateau, qui commencent par des intuitions, des envies d’artistes pas forcément expert·es du sujet…». Elle ajoute que certains compromis affaiblissent les ambitions de base: pour le spectacle adulte, «On a voulu mélanger la marionnette, le texte, la musique, le corps, le jeu, petit à petit tout ça faisait que c’était trop. On avait deux personnes à l’extérieur: une chorégraphe et un metteur en scène, deux façons différentes d’envisager la scène, le plateau, le jeu…» Le fonctionnement interne de l’équipe a également une grande importance: est-ce que les rôles sont bien définis, est-ce que tout le monde se fait confiance à 100%? Si ce n’est pas le cas, ça influence forcément le résultat final. Et enfin, pour les deux créations, elle se trouvait dans des moments compliqués de sa vie privée. Elle me dit que cette fragilité qu’elle vivait l’a peut-être empêchée de se battre davantage et qu’elle a laissé passer des mauvais choix.
Le plus douloureux pour elle, c’est de ne pas avoir réussi après à partager le ressenti collectif par rapport à cette expérience. Dans le premier cas, elle a l’impression que le spectacle a été vite mis «sous le tapis». Dans le deuxième, lorsque l’équipe de base s’est réunie pour faire le bilan, il a très vite été décidé de ne pas reprendre le spectacle: «On s’est dit qu’on n’avait plus envie de se remettre tous ensemble autour de cet objet. Humainement, ça nous paraissait trop difficile.» Mais une fois cette décision prise, il n’y a pas eu de discussion plus profonde sur les vécus de chacun·e, ce que la comédienne regrette.
Elle conclut en disant: «C’est tellement dommage qu’on parle pas des spectacles qui ne fonctionnent pas. Parce que ça nous aiderait. On est toujours tout seuls la première fois qu’on rate, mais s’inspirer des compagnies où ça n’a pas marché, ce serait super intéressant.»
Recycler – apprendre
Françoise Berlanger a mis très longtemps à se remettre de son spectacle avorté [lire: Les Conditions extérieures à l’échec]. Elle qualifie cet événement de «plaie ouverte». Pour transformer la douleur, elle a écrit un autre spectacle, Les lianes. D’abord une petite forme créée au Senghor, le spectacle est maintenant une forme longue et sera jouée en novembre prochain à la Balsamine. «J’étais super heureuse. Je suis sortie de là avec plein d’énergie et contente de moi». Les lianes l’ont guéri…
D’autres processus de «ratages» mènent à des apprentissages rétrospectivement riches. Stéphanie Goemaere a tourné son premier court-métrage il y a trois ans. Aujourd’hui, après un processus de deuil assez douloureux, elle accepte sereinement qu’elle ne parviendra peut-être jamais à le monter avec une qualité professionnelle: «J’y ai mis beaucoup de temps, d’énergie et d’argent et je sais que je n’aurai pas le résultat voulu. J’ai eu un gros problème de scénario, de base, que j’ai pas pu rattraper.» Après avoir analysé ce qui n’a pas marché, elle prépare deux autres courts-métrages. Cette fois-ci, elle attend d’avoir des scénarios béton avant de tourner. Elle le voit avec le recul comme une expérience réussie: «Rien d’autre n’aurait pu me donner ce que j’ai appris là».
Pareillement, Aylin Manco me parle de son premier texte fini comme d’un douloureux échec esthétique, mais «d’un sentiment de succès parce que j’avais au moins fini un truc. Mais à l’époque, je me souviens que j’ai pleuré.» «Le texte», me dit-elle, «est nul.» Mais avec le recul, elle y voit le premier embryon de ce qui sera son deuxième roman. Elle ajoute: «Je ne sais pas si on peut faire un lien de cause à effet […] Ça, ce serait la manière américaine de le voir… Je sais pas si j’y crois. En tout cas, ce que je trouve nul maintenant va peut-être plus tard ré-émerger, et je pourrai en faire quelque chose d’intéressant.»
Se foutre de l’échec
Mickey Boccar, lui, me parle de l’échec comme d’un moteur, notamment dans le cadre de l’improvisation théâtrale qu’il pratique régulièrement. Il me dit qu’en impro, l’échec est tout à fait permis. Il va même plus loin car il pense que les gens paient leur place pour le frisson: il est possible de voir un spectacle «rater en direct»: «En impro, on essaie de déprogrammer dans le cerveau la case “bien faire”. Le cerveau met plein de mécanismes en place pour qu’on se plante pas, qu’on ait la bonne répartie, mais en fait quand on se prend les pieds dans le tapis, on tombe et… on découvre le tapis. Et c’est super intéressant, on emprunte d’autres chemins.» Marion Levesque relate quelque chose de similaire: «Un pédagogue m’a dit pendant mes études: vas-y, n’aie pas peur de faire des trucs parce que de toutes façons, 93% de ce que tu feras sera de la merde, mais le reste sera hyper intéressant et pour y avoir accès on est obligé·e de faire tout ce 93% de merde.» Malika El Barkani me donne ce conseil qui va dans le même sens: «Il faut se lancer, tu t’amélioreras que si tu fais devant des gens. Si tu restes chez toi, et que t’attends d’être prête, tu ne le seras jamais. Le jour où j’ai progressé, c’est quand j’ai joué avec des pros, je savais même pas ce que c’était une tierce mineure, je savais rien, je jouais de la guitare et de la basse comme ça.»
Même si elle juge son parcours jalonné d’échecs, «ça m’a jamais découragée, parce que je le fais par amour. J’aimerais tellement faire un tabac, mais je le fais pas pour ça du tout. Je veux raconter des histoires!»
Bref, il faut se lancer, et pour cela, il faut accepter la possibilité de produire du contenu «raté».
L’échec: un mythe relatif
Au final, je me rends compte que l’échec comme la réussite sont des critères binaires artificiels. Il y a toujours des circonstances autour d’un succès, ou d’un échec. Ne serait-ce que l’époque dans laquelle on vit et les conditions de production actuelles, qui ne correspondent pas à tous les types d’œuvres. De plus, la perception de la réussite ou de son contraire dépend des ambitions qu’on s’est fixé·e au départ. Car même l’argent et le succès ne suffisent pas pour définir un succès absolu. Pour finir, certains projets échoués portent par la suite de belles fleurs, qu’ils se recyclent ailleurs ou qu’ils soient sources d’apprentissage et de remise en question. Même s’ils sont douloureux au moment même. Les parcours sont rarement linéaires et seul le recul permet une réelle prise de conscience des enchaînements qui ont eu lieu.
Pourtant, ces critères «construits» influencent les carrières. Beaucoup me disent qu’il leur a fallu «réussir» socialement, c’est-à-dire être produit·e et reconnu·e, pour trouver l’énergie de continuer dans un milieu où les conditions de travail ne sont pas toujours bonnes (voire même franchement mauvaises). De plus, c’est souvent compliqué de parler de ce qui n’a pas réussi. Stéphanie Goemaere me parle même de stratégie: raconter ses réussites crée le désir chez les autres, alors que raconter ses échecs peut mettre inconsciemment à distance. Et dans un métier où l’on dépend beaucoup du désir des autres, mieux vaut faire envie que pitié, ou encore fake it till you make it.
Et puis, on parle peu d’argent, alors que plusieurs artistes m’ont confié que, pour eux, réussir, c’était aussi toucher le chômage via le «statut d’artiste»[1]. Donc pouvoir exercer leur métier sans devoir jongler avec des boulots alimentaires.
En réalité, l’échec semble inévitable à un endroit ou à un autre, surtout dans un domaine où l’on cherche sans savoir parfois la direction précise. Vouloir l’éviter à tout prix peut conduire à abandonner, ou à produire uniquement des œuvres formatées qui correspondent plus à du divertissement qu’à de l’art. Chaque artiste affrontera des ratés, qui le.la toucheront plus ou moins, chaque être humain aussi, sans doute. Et on en revient à ce que disait Eno Krojanker: «l’échec, c’est toujours un peu ce que t’en fais.»
Et vous, vous faites quoi de vos échecs?
[1] Le «statut d’artiste» est une appellation abusive puisque les artistes en Belgique sont soit salarié·es, soit indépendant·es. Il s’agit en réalité des aménagements des règles de l’assurance chômage qui permettent la non-dégressivité des allocations pour les artistes et leur assurent un revenu minimum décent même les mois où iels ne travaillent pas. Pour obtenir cela, il faut prouver beaucoup de jours de travail artistiques en une certaine durée et tous les artistes n’y parviennent pas. Or, sans l’assurance-chômage, le métier est très précaire puisqu’il est composé de courts contrats et d’énormément de travail non rémunéré. Dès lors, certain·es sont contraint·es de se réorienter.
Dans la même série

L'échec vu du public
En chantier28 mai 2022 | Lecture 3 min.
épisode 3/4

Les conditions extérieures à l’échec
En chantier1 mars 2022 | Lecture 4 min.
épisode 2/4

Déboires assumés
En chantier31 janvier 2022 | Lecture 8 min.
épisode 1/4
Vous aimerez aussi

Déboires assumés
En chantier31 janvier 2022 | Lecture 8 min.
épisode 1/4

Les conditions extérieures à l’échec
En chantier1 mars 2022 | Lecture 4 min.
épisode 2/4

L'échec vu du public
En chantier28 mai 2022 | Lecture 3 min.
épisode 3/4

Louise Baduel et Michèle Noiret
En ce moment23 avril 2024 | Lecture 2 min.

[VIDÉO] COLLEUSES FÉMINISTES ET COLÈRE DANS L’ESPACE PUBLIC AU THÉÂTRE VARIA
En chantier11 avril 2024 | Lecture 1 min.

Tu l'as trouvé où, ce spectacle?
En ce moment19 février 2024 | Lecture 2 min.

Mutualiser… une (nouvelle) politique culturelle?
Grand Angle18 février 2024 | Lecture 4 min.

Janine Godinas
Grand Angle18 janvier 2024 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] Science-fiction contemplative avec la bédéiste Lisa Blumen
En chantier14 janvier 2024 | Lecture 2 min.

Cherche employé·e de bureau
Grand Angle19 décembre 2023 | Lecture 12 min.

Comment l'école broie les Kévin
Grand Angle13 décembre 2023 | Lecture 1 min.

«Plonger», ou l'éloge de la suspension
En ce moment12 décembre 2023 | Lecture 1 min.

Faire parler les littératures sous-exposées
En chantier18 novembre 2023 | Lecture 3 min.
épisode 1/5

[VIDÉO] Théâtre et quartiers populaires avec Yousra Dahry
Grand Angle16 novembre 2023 | Lecture 2 min.

[PODCAST] Arco Renz et Danielle Allouma en spirales hypnotiques
En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.
épisode 8/8

[PODCAST] Chloé Beillevaire et Sabina Scarlat, bouffonnes en collants
En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.
épisode 7/8

[PODCAST] Karine Ponties au confluent du réalisme et de l'abstraction
En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.
épisode 6/8

[PODCAST] Le pouvoir des ondes sonores avec Marielle Morales
En chantier8 novembre 2023 | Lecture 1 min.
épisode 5/8

Sur la vieillesse au théâtre
Grand Angle30 octobre 2023 | Lecture 11 min.

Macbeth au Shakespeare’s Globe
Au large17 octobre 2023 | Lecture 3 min.

L’Amour c’est pour du beurre
En ce moment16 octobre 2023 | Lecture 2 min.

Prendre soin, par le théâtre aussi
En ce moment4 octobre 2023 | Lecture 1 min.

Danse Avec les Foules
En ce moment2 octobre 2023 | Lecture 1 min.

Hippocampe
En ce moment29 septembre 2023 | Lecture 2 min.

«C'est quoi ta kouleur préférée?»
Émois17 septembre 2023 | Lecture 4 min.

La sentinelle du sens
Grand Angle29 août 2023 | Lecture 1 min.
épisode 3/10

Initier au matrimoine littéraire
En chantier25 août 2023 | Lecture 5 min.

Le vrai calme se trouve dans la tempête
Au large21 août 2023 | Lecture 5 min.

Théâtre au Vert: diversité, simplicité, sincérité
En ce moment19 août 2023 | Lecture 1 min.

Réhabilitons Welfare, le spectacle mal-aimé d’Avignon 2023
Émois3 août 2023 | Lecture 11 min.

Violence symbolique et agressions réelles
Émois28 juillet 2023 | Lecture 6 min.

À Avignon, Julien Gosselin nous a percutés
Émois23 juillet 2023 | Lecture 8 min.

Drame familial sur fond d'imaginaire décolonisé
Grand Angle17 juillet 2023 | Lecture 1 min.

Place aux narrations féministes
En ce moment13 juillet 2023 | Lecture 12 min.

Cinq spectacles québécois en rafale au FTA et au Carrefour
Au large30 juin 2023 | Lecture 13 min.

Échappées urbaines
En ce moment12 juin 2023 | Lecture 2 min.

La condition pavillonnaire ou la terreur du quotidien
Émois1 juin 2023 | Lecture 4 min.
épisode 10/14

Depuis que tu n’as pas tiré
En ce moment24 mai 2023 | Lecture 2 min.

Malaise dans la civilisation
Émois19 mai 2023 | Lecture 3 min.

Garder l'enfance allumée
Grand Angle15 mai 2023 | Lecture 7 min.

Hormur: une plateforme pour créer dans des lieux insolites
En chantier15 mai 2023 | Lecture 1 min.

Un retour aux sources pour ne plus manquer de repères
Grand Angle15 mai 2023 | Lecture 5 min.

Le KFDA commence fort avec Angela, a strange loop
Émois13 mai 2023 | Lecture 4 min.

Serge Aimé Coulibaly, danser ici et ailleurs
Au large28 avril 2023 | Lecture 1 min.

Créer ensemble dans la ville
Au large24 avril 2023 | Lecture 0 min.
épisode 6/6

Des forêts et des sardines
Grand Angle21 avril 2023 | Lecture 7 min.

[VIDÉO] Boucles infinies avec Arco Renz et Danielle Allouma
En chantier18 avril 2023 | Lecture 1 min.

Le collectif suisse BPM déploie son irrésistible «Collection»
Émois17 avril 2023 | Lecture 5 min.

[VIDÉO] Chloé Beillevaire et Sabina Scarlat, étonnantes «folles du roi»
En chantier12 avril 2023 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] L'ART SUBTIL DE LA RELAX PERFORMANCE AVEC SIDE-SHOW
En chantier30 mars 2023 | Lecture 1 min.

Indiscipline à Knokke!
En ce moment29 mars 2023 | Lecture 2 min.

[VIDÉO] LE BANAL SUBLIMÉ AVEC KARINE PONTIES
En chantier20 mars 2023 | Lecture 2 min.

[VIDÉO] Entre l'audible et l'invisible avec Marielle Morales
En chantier15 mars 2023 | Lecture 1 min.

Ces paroles qui nous rassemblent
Grand Angle7 mars 2023 | Lecture 1 min.
épisode 2/10

Carte noire nommée désir
Émois20 février 2023 | Lecture 4 min.
épisode 7/14

Rabelais revient à la charge
Grand Angle18 février 2023 | Lecture 1 min.
épisode 1/10

Les dents de Lumumba
Grand Angle25 janvier 2023 | Lecture 2 min.
épisode 2/3

Tervuren
En chantier13 janvier 2023 | Lecture 4 min.

Philippe Grombeer et les Halles
En ce moment10 janvier 2023 | Lecture 4 min.

Morel, c’est quelqu’un!
Grand Angle10 janvier 2023 | Lecture 1 min.

La très belle métamorphose d’une traduction des Métamorphoses
Grand Angle18 novembre 2022 | Lecture 1 min.

La puissance des langues vernaculaires
Au large15 novembre 2022 | Lecture 2 min.

Méduse.s par le collectif La Gang
Grand Angle11 novembre 2022 | Lecture 10 min.
épisode 2/3

Du théâtre malgré tout
Au large9 novembre 2022 | Lecture 2 min.

Que nos enfants soient des géants
Au large7 novembre 2022 | Lecture 1 min.

La puissance de Dionysos
Au large3 novembre 2022 | Lecture 5 min.

Créer pour faire advenir le female gaze
Grand Angle27 octobre 2022 | Lecture 6 min.
épisode 1/3

Déplacer l’espace du théâtre dans les cours familiales
Au large24 octobre 2022 | Lecture 1 min.

«Ça a commencé?»
Grand Angle19 octobre 2022 | Lecture 7 min.

Donner sa place au public
Au large12 octobre 2022 | Lecture 2 min.

[VIDÉO] En immersion avec Tumbleweed aux Brigittines
En chantier1 octobre 2022 | Lecture 1 min.

Un nouveau prix au Burkina Faso!
Au large28 septembre 2022 | Lecture 4 min.

Au festival Nourrir Bruxelles
18 septembre 2022 | Lecture 1 min.

Trouver un lieu pour y faire du théâtre
Grand Angle17 septembre 2022 | Lecture 1 min.

Éducatrice et maquilleuse
Grand Angle8 septembre 2022 | Lecture 1 min.
épisode 17/18

Il est parti...
Émois31 août 2022 | Lecture 4 min.

Still Life fait régner le théâtre sans paroles à Avignon
Grand Angle23 juillet 2022 | Lecture 1 min.

Paradiso du Teatro delle Albe
Au large19 juillet 2022 | Lecture 4 min.

Koulounisation de Salim Djaferi
En ce moment16 juillet 2022 | Lecture 1 min.

Accompagner plutôt que programmer
Grand Angle3 juillet 2022 | Lecture 7 min.

24h dans la vie du théâtre des Doms
En ce moment3 juillet 2022 | Lecture 3 min.

Circassienne, le saut dans le vide
Grand Angle3 juillet 2022 | Lecture 4 min.
épisode 3/3

Comédien et guide à l’Africa Museum de Tervuren
Grand Angle1 juillet 2022 | Lecture 1 min.
épisode 15/18

Un festival au grand jour
Au large5 juin 2022 | Lecture 3 min.

Compositrice-interprète et responsable de revue
Grand Angle1 juin 2022 | Lecture 1 min.
épisode 14/18

«T’inquiète pas, je te rattrape»
Grand Angle30 mai 2022 | Lecture 4 min.
épisode 2/3

Entrer et voir le bar
Grand Angle30 mai 2022 | Lecture 1 min.

Démontage du chapiteau patriarcal
Grand Angle10 mai 2022 | Lecture 6 min.
épisode 1/3

Gestionnaire le matin et artiste l'après-midi
Grand Angle9 mai 2022 | Lecture 1 min.

Même pas mort le répertoire
En ce moment2 mai 2022 | Lecture 2 min.

La fascination du mal
En ce moment1 mai 2022 | Lecture 1 min.

Guyane, Liban, Iran, Japon...
En ce moment1 mai 2022 | Lecture 1 min.

De la musique à la danse de luttes
En ce moment21 avril 2022 | Lecture 1 min.

Comédienne et maman
Grand Angle15 avril 2022 | Lecture 1 min.
épisode 2/6
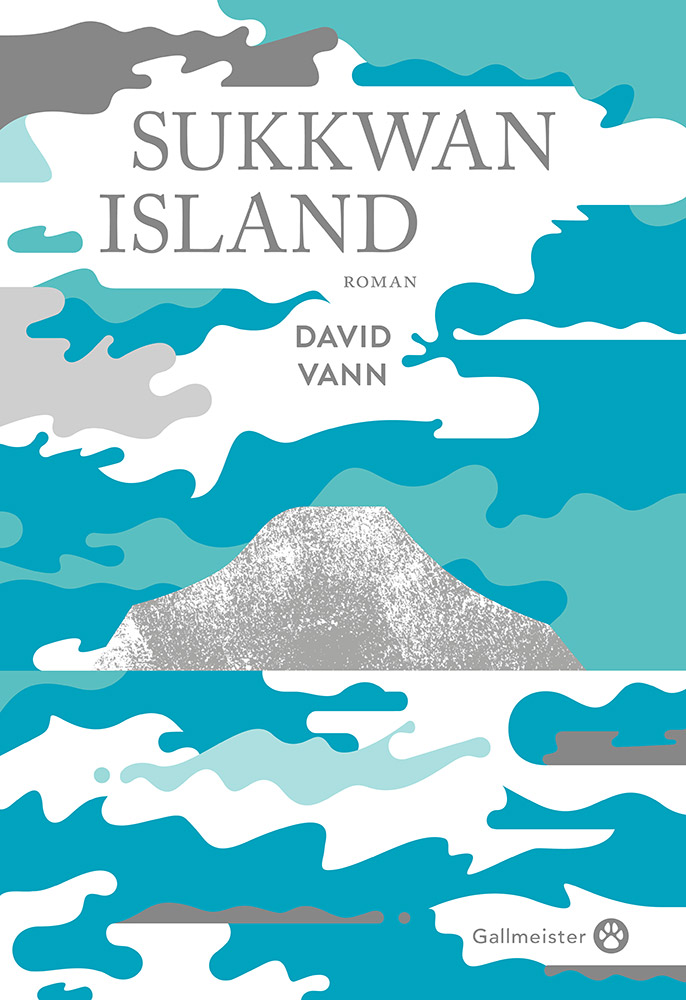
David Vann
Émois3 avril 2022 | Lecture 3 min.
épisode 2/14

Comédien et formateur en entreprise
Grand Angle25 mars 2022 | Lecture 1 min.
épisode 7/18

Archipel
En ce moment23 mars 2022 | Lecture 4 min.

Échappatoire à la Saint Valentin
Émois14 février 2022 | Lecture 4 min.

Diriger un festival: à deux, c’est mieux
Grand Angle31 janvier 2022 | Lecture 7 min.

Le vent tourne II
Grand Angle29 décembre 2021 | Lecture 7 min.

Acteur et plombier/chauffagiste
Grand Angle28 décembre 2021 | Lecture 1 min.
épisode 2/18

Diriger un théâtre: un geste politique
Grand Angle28 décembre 2021 | Lecture 2 min.

Un spectacle par ses costumes
En ce moment16 septembre 2021 | Lecture 5 min.

L'ouverture mythique de la Raffinerie du Plan K
Grand Angle10 juin 2021 | Lecture 3 min.

Vieilles peaux
Émois12 mars 2021 | Lecture 5 min.
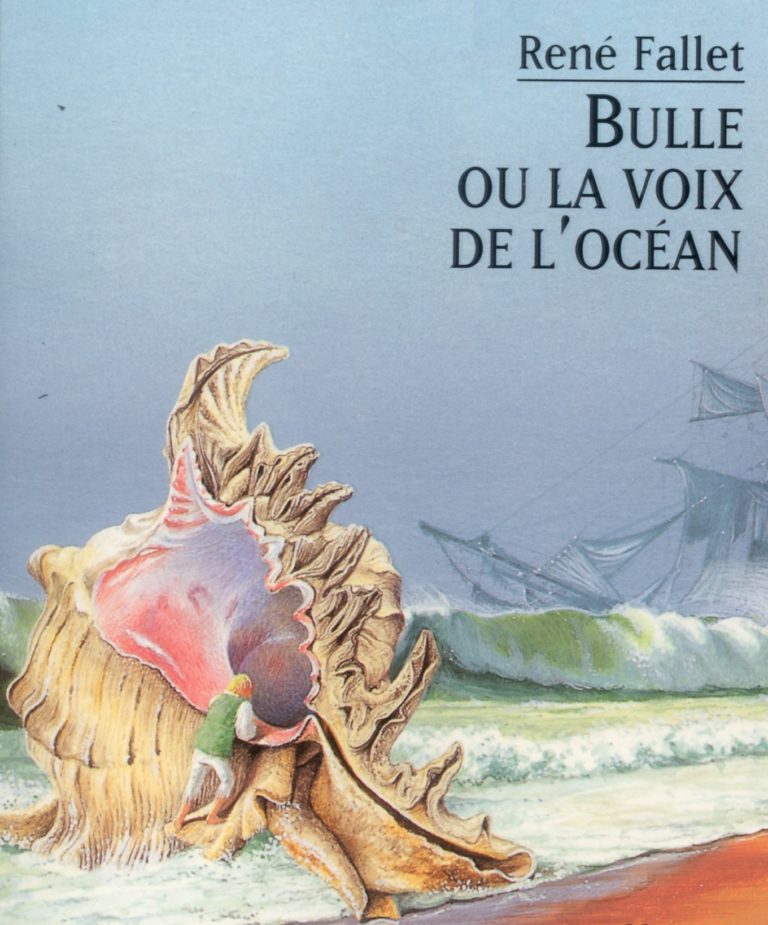
Le charme des titres avec un «ou» dedans
Émois9 décembre 2020 | Lecture 5 min.